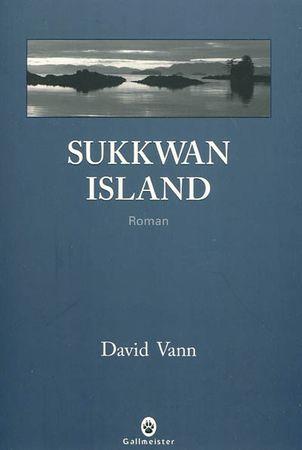 Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laura DERAKINSKI Collection Nature Writing, 200 pages
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laura DERAKINSKI Collection Nature Writing, 200 pages
Gallmeister
Dos de l’ouvrage : Une île sauvage du Sud de l’Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, tout en forêts humides et montagnes escarpées. C’est dans ce décor que Jim décide d’emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane isolée, une année durant. Après une succession d’échecs personnels, il voit là l’occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu’il connaît si mal.
La rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar, et la situation devient vite incontrôlable. Jusqu’au drame violent et imprévisible qui scellera leur destin.
"Sukkwan Island" est une histoire au suspense insoutenable. Avec ce roman qui nous entraîne au cœur des ténèbres de l’âme humaine, David Vann s’installe d’emblée parmi les jeunes auteurs américains de tout premier plan.
DAVID VANN est né sur l’île Adak, en Alaska. Après avoir parcouru plus de 40 000 milles sur les océans, il travaille actuellement à la construction d’un catamaran avec lequel il s’apprête à effectuer un tour du monde à la voile en solitaire. Auteur de plusieurs livres, il vit en Californie.Il enseigne également à l’Université de San Francisco. "Sukkwan Island" est son premier roman, publié en 2008 aux Etats-Unis, traduit en français.
La douleur d’être homme
« Le monde était à l’origine un vaste champ et la terre était plate. Les animaux de toutes espèces arpentaient cette prairie et n’avaient pas de noms, les grandes créatures mangeaient les petites et personne n’y voyait rien à redire. Puis l’homme est arrivé, il avançait courbé aux confins du monde, poilu, imbécile et faible, et il s’est multiplié, il est devenu si envahissant, si tordu et meurtrier à force d’attendre que la Terre s’est mise à se déformer.» (p.11)...
Ainsi commence Sukkwan Island sur un étrange récit de commencement du monde raconté par un père à son fils. Nous, simple lecteur, comprenons peu à peu que ces mots essentiels sont prononcés dans l’hydravion qui survole l’île sur laquelle un père, l’auteur de ces mots, emmène son fils Roy, passer un an avec lui, dans l’extrême solitude… Nous pourrions songer à de nouveaux « Robinsons suisses » ou de nouveaux trappeurs dignes des héros de Jack London, poursuivant le mythe des pionniers américains, si ce n’était, dès ces premières heures, la présence d’une angoisse sourde, rampante, que l’auteur avec une rare maestria, portera à son paroxysme, sans pour autant que l’on puisse parler de suspens, d’intrigue, mais bien plutôt d’une inexorable fuite en avant ; l’île, d’univers paradisiaque de reconstruction, se révélant, par la force des choses et les faiblesses humaines, un épouvantable piège inextricable…
« L’île où ils s’installaient, Sukkwan Island, s’étirait sur plusieurs kilomètres derrière eux, mais c’étaient des kilomètres d’épaisse forêt vierge, sans route ni sentier, où fougères, sapins, épicéas, cèdres, champignons, fleurs des champs, mousse et bois pourrissant abritaient quantité d’ours, d’élans, de cerfs, de mouflons de Dall, de chèvres de montagne et de gloutons. Un endroit semblable à Ketchikan, où Roy avait vécu jusqu’à l’âge de cinq ans, mais en plus sauvage et en plus effrayant maintenant qu’il n’y était plus habitué.» (p.13)
Sukkwan Island n’est accessible qu’en bateau ou par hydravion. Ainsi John et son père ne seront reliés au reste du monde, pendant une année entière, que par la radio (dont on prend un soin tout particulier lors du débarquement) et par l’avion dont le pilote promet de venir « jeter un œil de temps à autre », quand le temps de l’hiver le permettra. Autrement dit, le père et le fils devront survivre par leurs propres moyens. A priori, c’est une aventure extraordinaire que le père pense ainsi offrir à son fils âgé de 13 ans, dont il ne s’est pour l’instant que très peu soucié.
« Tandis qu’ils survolaient les lieux, Roy observait le reflet de l’avion jaune qui se détachait sur celui, plus grand, des montagnes vert sombre et du ciel bleu. Il vit la cime des arbres se rapprocher de chaque côté de l’appareil, et quand ils amerrirent des gerbes d’eau giclèrent de toute part. Le père de Roy sortit la tête par la fenêtre latérale, sourire aux lèvres, impatient. L’espace d’un instant, Roy eut la sensation de débarquer sur une terre féerique, un endroit irréel. » (p.13)
Pourtant, dès le débarquement des provisions et du matériel, des signes d’imperfection, d’hésitation et d’interrogation sont présents et alertent le lecteur prêt à suivre cette aventure des origines, ce retour aux sources, cette tentative de communion avec l’essentiel au sein d’une nature vierge…
« Debout sur un des flotteurs, son père gonfla le Zodiac avec la pompe à pied pendant que Roy aidait le pilote à décharger le moteur Johnson six chevaux au-dessus de la poupe où il patienta, suspendu dans le vide, jusqu’à ce que l’embarcation fût prête. Ils l’y fixèrent, chargèrent le bateau de bidons d’essence et de jerrycans qui composèrent le premier voyage. Son père le fit en solitaire tandis que Roy, anxieux, attendait dans la carlingue avec le pilote qui ne cessait pas de parler. —"Pas très loin de Haines, c’est là que j’ai essayé. - J’y suis jamais allé, fit Roy. - Eh ben, comme je te disais, tu y trouves des saumons et des ours, et tout un tas de trucs qu’une grande majorité d’humains n’aura jamais, mais c’est tout ce que tu y trouves, et ça inclut une vraie solitude sans personne autour". Roy ne répondit rien. " - C’est bizarre, c’est tout. Les gens emmènent rarement leurs gosses avec eux. Et la plupart emportent de la nourriture". De la nourriture, ils en avaient apporté, du moins pour les deux premières semaines, ainsi que les denrées indispensables : farine et haricots, sel et sucre, sucre brun pour fumer le gibier. Des fruits en conserve. Mais ils comptaient vivre de chasse et de pêche. C’était leur plan. Ils mangeraient du saumon frais, des truites Dolly Varden, des palourdes, des crabes et tout ce qu’ils parviendraient à abattre – cerfs, ours, mouflons, chèvres, élans. Ils avaient embarqué deux carabines, un fusil et un pistolet. » (p.13,14)
Le transbordement du matériel nécessite plusieurs voyages que le père fait seul, à bord du Zodiac, laissant Roy rêver, penser au monde et aux personnes qu’il a quittés, alerté par les paroles du pilote bavard, dernier lien et témoin du monde que Roy s’apprête à quitter pour un an. La description du deuxième voyage doit se lire comme un pressentiment… David Vann tient en effet à nous signifier que le père tente de cacher son sourire à son fils, que la vaguelette liée à la présence humaine ne peut vivre longtemps en dérangeant cette nature inviolée, enfin que si l’eau est apparemment limpide, elle ne laisse pas voir le fond et révèle près du rivage de potentiels dangers…
« Lorsque le père de Roy revint, il affichait un large sourire qu’il essayait de dissimuler en évitant le regard de son fils tandis qu’ils déchargeaient l’équipement de radio dans une boîte étanche, les armes dans des étuis imperméables, le matériel de pêche, les premières conserves et les outils rangés dans des caisses. Puis il fallut à nouveau écouter le pilote pendant que son père s’éloignait en une légère courbe, laissant dans son sillage une petite traînée blanche qui s’apaisait rapidement en vaguelettes sombres, comme si elles ne pouvaient déranger qu’un minuscule coin du monde et que, de ses tréfonds, cette région se ravalerait elle-même en quelques instants. L’eau était limpide mais suffisamment profonde, même si près de la côte, pour que Roy n’en voie pas le fond. Plus près de la rive, par contre, à la limite du miroitement, il devinait les formes floues des branches et des pierres sous la surface. » (p.14,15)
Son père lui apparait dans le soleil, coloré et auréolé, mais impossible à rejoindre (pour le moment ?), tandis que le sentiment de l’absence de sa sœur et de sa mère, qui ne s’est pas opposée à son départ, lui font venir les larmes aux yeux, aussitôt chassées par le retour du père. On apprendra par la suite qu’il aurait suffi que sa mère, plutôt que de lui laisser le choix, s’oppose à ce départ insensé pour que Roy accepte cette décision ; et qu’il espérait, en son for intérieur, cette prise de position qui l’aurait soulagé de la responsabilité qu’il se sentait avoir de son père.
« Son père portait une chemise de chasse en flanelle rouge et un pantalon gris. Il n’avait pas de chapeau, bien que l’air fût plus frais que ne l’avait anticipé Roy. Le soleil brillait sur son crâne, même d’aussi loin il le voyait scintiller sur ses cheveux fins. Son père plissait les yeux dans la lueur éclatante du matin, mais un côté de sa bouche était relevé en un sourire. Roy avait envie de le rejoindre, de poser pied à terre et d’inspecter leur nouvelle maison, mais il restait deux allers-retours avant qu’il puisse y aller. Ils avaient empaqueté leurs habits dans des sacs-poubelle, ainsi que leurs vêtements de pluie, leurs bottes, leurs couvertures, deux lampes, davantage de nourriture et des livres. Roy avait une caisse pleine de manuels scolaires. Ce serait une année entière d’enseignement à domicile – maths, anglais, géographie, sciences sociales, histoire, grammaire et physique-chimie niveau 4e, qu’il mènerait à bien allez savoir comment puisque les cours impliquaient des expériences et qu’ils n’avaient pas l’équipement nécessaire. Sa mère avait posé la question à son père, qui n’avait formulé aucune réponse claire. Sa mère et sa sœur lui manquèrent soudain, et les yeux de Roy s’embuèrent, mais il aperçut son père qui repoussait l’embarcation sur la plage de galets et il s’obligea à se calmer. » (p.15)
L’inéluctable se joue à cet instant et Roy sent peser sur ses épaules de 13 ans le poids du temps :
« Lorsqu’il grimpa enfin à bord et qu’il lâcha le flotteur de l’hydravion, le dépouillement du lieu le frappa. Ils n’avaient plus rien à présent et, tandis qu’il tournait la tête et regardait l’appareil effectuer un petit cercle derrière lui, grincer avec violence et décoller dans une gerbe d’eau, il sentit à quel point le temps allait être long, comme s’il était fait d’air et pouvait se comprimer et s’arrêter. » (p.16)
Roy, et le lecteur à travers lui, découvrent leur installation sur l'île, tout d’abord le site, sauvage, à la nature envahissante, puis la cabane précaire que Roy et son père vont s'employer à aménager et à améliorer, en alternance avec leurs premières pêches (activité impartie à Roy) et leurs premières chasses, plutôt mystérieuses et distantes de la cabane, assurées par le père. Au cours de cette présentation du site par Roy, David Vann distille çà et là des réflexions et des éléments d’observation qui, sans être alarmants, alertent sur la réalité de la situation, nous mettant, nous, lecteur captif, dans une impossibilité de penser que Sukkwan Island soit tout à fait un paradis….
« -"Bienvenue dans ton nouveau foyer", fit son père avant de poser la main sur la tête de Roy, puis sur son épaule. Avant que le bruit de l’avion n’eût disparu, ils avaient déjà débarqué sur la plage de galets sombres, et le père de Roy, en cuissardes, descendait pour tirer la proue du Zodiac. Roy mit pied à terre et tendit la main pour empoigner une caisse. -"Laisse ça pour l’instant, fit son père. On va attacher le bateau et explorer le coin. - Rien ne va entrer dans les caisses ? - Non. Viens là". Ils avancèrent dans l’herbe haute jusqu’aux tibias, d’un vert brillant sous le soleil, puis le long d’un sentier qui traversait un bosquet de cèdres jusqu’à la cabane. Celle-ci était grise et battue par les vents, mais assez récente. Son toit était pentu pour éviter les amoncellements de neige, et la structure toute entière ainsi que le porche étaient surélevés à deux mètres au-dessus du sol. Elle ne possédait qu’une porte étroite et deux petites fenêtres. Roy observait le tuyau du poêle qui dépassait en espérant qu’il y aurait aussi une cheminée. Son père ne le fit pas entrer dans la cabane, il la contourna par un chemin qui continuait en direction de la colline. -"Les toilettes extérieures", dit son père. Elles étaient grandes comme un placard, surélevées elles aussi, et accessibles par des marches. Bien qu’elles soient situées à environ trente mètres de la cabane, ils devraient les utiliser par temps froid, dans la neige hivernale. Son père poursuivit le long du sentier. -"On a une belle vue de là-haut", fit-il. Ils arrivèrent à un point en surplomb au beau milieu des orties et des baies sauvages, écrasant sous leurs pas la terre recouverte de végétation depuis la dernière fois qu’elle avait été foulée. Son père était venu quatre mois plus tôt pour visiter les lieux avant d’acheter. Il avait ensuite convaincu Roy, la mère de Roy et l’école. Il avait vendu son cabinet et sa maison, avait échafaudé ses projets et acheté leur matériel. Le sommet de la colline était envahi d’herbe au point que Roy n’était pas assez grand pour avoir une vue dégagée des alentours, mais il apercevait le bras de terre pareil à une dent scintillante qui jaillissait de l’eau agitée et un autre bras de mer menant à une île lointaine, à un rivage, à l’horizon, l’air limpide et clair, les distances impossibles à évaluer. Il voyait le faîte de leur toit en contrebas, non loin de là, et en bordure de la baie, l’herbe et la plaine qui s’étendaient sur trente mètres à peine depuis la rive, interrompues par le flanc escarpé de la montagne dont le sommet disparaissait dans les nuages. Personne à des kilomètres à la ronde, dit son père. -"D’après ce que je sais, nos voisins les plus proches sont à trente kilomètres d’ici, un petit lot de trois cabanes dans une baie comme celle-ci. Mais ils sont sur une autre île, j’ai oublié laquelle". Roy ne savait pas quoi dire, alors il ne disait rien. Il ne savait pas comment les choses tourneraient. Ils redescendirent à la cabane enveloppés par le parfum doux amer d’une plante, une odeur qui rappelait à Roy son enfance à Ketchikan. En Californie, il avait beaucoup repensé à Ketchikan et à la forêt humide, il avait cultivé dans son imaginaire et dans ses vantardises auprès de ses amis l’image d’un endroit sauvage et mystérieux. Mais à présent qu’il était de retour, l’air y était plus froid et la végétation certes luxuriante, mais rien qu’une simple végétation, et il se demanda à quoi ils passeraient leur temps. Les choses étaient crûment ce qu’elles étaient et rien d’autre. Ils montèrent sur le porche, accompagnés par le bruit sourd de leurs bottes. Son père actionna le loquet de la porte, qu’il poussa pour laisser passer Roy en premier. Lorsqu’il entra, il sentit le cèdre, l’humidité, la terre et la fumée, et il fallut plusieurs minutes à ses yeux pour s’accoutumer à l’obscurité et distinguer autre chose que la silhouette des fenêtres. Il commençait à voir les poutres au-dessus de lui, et à quel point le plafond était haut, à quel point les planches aux nœuds sciés et à l’air rugueux des murs et du sol étaient tout de même douces au toucher. -"Tout a l’air neuf, dit Roy. - C’est une cabane bien construite, fit son père. Le vent ne traverse pas les murs. On sera à l’aise tant qu’on aura du bois pour le feu. On a tout l’été pour se préparer. On mettra de côté du saumon séché et fumé, on fera des confitures et on salera de la viande de cerf. Tu ne vas pas croire tout ce qu’on va faire". Ce jour-là, ils commencèrent par nettoyer la cabane. Ils balayèrent et dépoussiérèrent, puis le père emmena Roy avec un seau le long d’un sentier, jusqu’à un ruisseau qui se jetait dans la baie. Le cours d’eau courait, profond, entre les herbes de prairie et effectuait trois ou quatre méandres dans la végétation avant de rouler dans les galets et de laisser un léger dépôt de sable, poussière et débris dans l’eau salée. Des insectes aquatiques se mouvaient à la surface, et des moustiques. -"C’est l’heure de la dope à bestioles, dit son père. - Ils grouillent de partout, fit Roy". » (p.16,17,18)
En effet, Roy se rend très vite compte que cet exil n’est pas aussi évident et idyllique que l’aventure dont il avait pu rêver. La nature, sans être à proprement parler hostile, se révèle dure, âpre et sauvage, nécessitant d’anticiper, ce que son père est dans l’incapacité pratique de faire. Le climat ne rend pas l’île si facile et les intempéries vont limiter leur capacité d’agir. Les descriptions de la nature et des rapports de ces deux êtres à leur milieu font penser à la plume d’Ernest Hemingway.
Le père de Roy apparait, au fur et à mesure que passent les jours et que s’additionnent les priorités à donner aux choses à faire, inorganisé, improvisant sans arrêt, hésitant et contradictoire, et n’ayant au final qu’en partie anticipé leur séjour. Il n’a pas d’idées précises sur la façon de se donner la capacité de survivre en pleine nature, de préparer ce qu’il sait pourtant être leur défi en ce mois de juin, soit de passer l’hiver sous la neige dont la présence certaine est annoncée dès les premiers mots décrivant le site (le toit de la cabane pentu, les bâtiments surélevés de 2 mètres,…). Aussi leur quotidien, aux yeux de Roy, se résume à tenter de survivre en milieu hostile, développant jour après jour une angoisse grandissante...
Des épisodes tragiques vont se succéder, rendant palpable la réelle difficulté de survie matérielle, que ce soit quand un ours, profitant de leur absence, entre dans leur cabane, mange une grande partie des provisions et détruit une partie du matériel, ou bien que leur cache destinée à protéger leur nourriture, excavation qu’ils ont mis plusieurs jours à creuser, s’effondre, les obligeant à recommencer le travail, ou encore quand, à tour de rôle, ils sont victimes de la nature sauvage et doivent chacun la survie à l’autre…
Roy est surtout d’abord étonné, puis déconcerté, enfin mortifié et épouvanté en entendant son père pleurer toutes les nuits, répétant des tranches de vie douloureuses, dont il ne tardera pas à prendre Roy pour témoin, se confessant à lui de ses erreurs et de ses errances … De plus, le père et le fils se parlent très peu, ne sachant pas comment établir un dialogue pourtant nécessaire, chacun fuyant l’autre tout en guettant et espérant un signe positif. Ils sont étrangers l’un à l’autre et, incapables de communiquer, ne se comprennent pas.
"C'est quoi, ton rêve? Roy réfléchissait et ne trouvait rien à répondre. Il avait l'impression qu'il était seulement en train d'essayer de survivre au rêve de son père. Mais il finit par dire : Un grand bateau avec lequel je pourrais aller jusqu'à Hawaï et peut-être faire le tour du monde." Ah, dit son père. C'est un bon rêve. Et toi? Et moi. Et moi. Il y en a tellement. Un bon mariage, je crois, et ne pas avoir rompu mes deux précédents, et ne pas être devenu dentiste, et ne pas avoir le fisc à mes trousses, et puis, après tout ça, peut-être un fils comme toi et un grand bateau. Il serra Roy dans ses bras, ce qui le prit totalement au dépourvu. Roy se sentait gêné quand il le lâcha enfin. Il savait que son père allait se mettre à pleurer." (p. 95,96)
David Vann décortique avec une précision redoutable, dont l’efficacité est renforcée par la retenue et la sobriété des mots, l'immaturité du père en proie au mal-être, au doute, à la dépression puis à la démence, un père qui ne semble pouvoir exister que dans l’expression de défis posés à lui-même, incapable qu’il est de les résoudre, prisonnier qu’il est de ses contradictions. Les rapports du père et du fils vont évoluer au rythme du mal-être du premier et de la prise de conscience écrasante du second.
Cette première partie se déroule lentement, au rythme de la lourdeur du quotidien, des travaux à réaliser, des chasses et des pêches à assurer, des non dits et des silences, des pesanteurs et des drames mêmes, des nuits trop profondes, trop froides, trop humides, trop cauchemardesques, dans ce coin perdu au bout du monde où l’on est seul avec soi-même, seul face à soi-même, loin de la société de consommation et des folies des hommes. D’ailleurs à y bien remarquer, le père de Roy n’existe pas, civilement parlant, dans cette première partie narrée par son fils. Jamais son prénom n’est cité. Il ne le sera qu’à l’occasion de sa conversation catastrophique, par radio, avec Rhoda, dont il a divorcé un an plus tôt, et qui représente pour Roy, « cette chose que son père tenait absolument à avoir, un désir aussi fort que celui de la pornographie, un besoin qui rendait son père malade, bien que Roy sut que c’était faux, qu’il avait tort de penser qu’elle le rendait malade. Il savait que son père s’infligeait cela tout seul. » (p.111)
Malgré toutes ces situations, tous ces artefacts, toutes ces tensions et tous ces ratés, rien, dans la première partie de ce roman déroutant, ne laisse présager l'horreur de la seconde…, qui débute à la page 113, -maudite page 113!-, par un véritable uppercut que David Vann décoche au lecteur.
Changement de point de vue, changement d’histoire, inéluctable chute conséquente de la première partie, la seconde donne la voix au père, alors que le lecteur a partagé les pensées de Roy dans la première partie du roman. Cette seconde partie change de style et d’écriture : on retrouve celle de Cormac McCarthy avec toute sa sobriété et son efficacité, celles par exemple de La Route, qui raconte également le périple d’un père et de son fils… mais là s’arrête la ressemblance entre les deux récits!
Force est de ne rien dire de plus sur ce roman… car s’étendre d’avantage serait en révéler trop.
Il est des lecteurs qui aiment à butiner le livre qu’ils ont entre les mains, ouvrant çà et là l’ouvrage, l’humant et arrachant quelques bribes de texte avant de s’y jeter totalement ; il en est d’autres qui aiment à lire la fin du livre avant que de le commencer ou après avoir été pris par le début du récit, impatients qu’ils sont d’en connaître la chute… S’il est un ouvrage où ces pratiques sont rigoureusement proscrites, c’est bien Sukkwan Island !
Sukkwan Island vous saisit, vous prend à la gorge, vous hypnotise, vous secoue, vous trouble, vous révolte, vous bouleverse... C’est un roman captivant, noir, angoissant, terriblement pessimiste, sidérant, terrifiant même, mais magistral et éblouissant !
Je n’ai pas pu, durant quelques semaines, après avoir lu cet ouvrage, en parler et encore moins écrire un texte sur lui.
Il en est ainsi, en ce qui me concerne, lorsque je me trouve en présence de textes trop puissants, trop envahissants, trop pleins.
Ce fut le cas de nombreuses lectures aussi diverses que celles des Chants de Maldoror de Lautréamont, de L’oiseau bariolé de Jerzy Kosinski, de Madame Bovary de Gustave Flaubert , de Dieu est né en exil de Vintila Horia, du Chant général de Pablo Neruda, de Sous le Volcan de Malcom Lowry, du Livre de sable de Jorge Luis Borges, de L’insoutenable légèreté de l’être de Kundera, du Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki, du Bruit et la Fureur de William Faulkner, de Manhattan Transfer de John Dos Passos, des Raisins de la colère de John Steinbeck, de La montagne magique de Thomas Mann, ou de Méridien de sang de Cormac Mac Carthy, de 2666 de Bolaño…
Commencer une telle liste se révèle vite une gageure ! Il y en a (heureusement !), tant d’autres…
Il me faut le temps de digérer le texte pour pouvoir en parler. Un peu comme si, absorbés par l’intensité du récit, les mots pour le dire n’étaient plus disponibles.
Aussi, désirant communiquer par ce blog mes émotions de lecteur, m’est-il difficile de me tenir sur la "brèche", dans l’actualité littéraire, proposant, « dans les premiers », mes impressions ravies de lecteur comblé.
Que tous veuillent bien me pardonner cette difficulté.
Desmodus 1er
