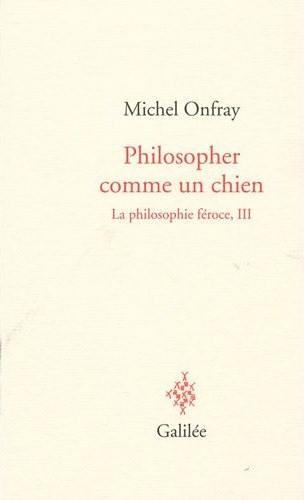 Les titres des essais de Michel Onfray intriguent souvent. Son dernier opus, Philosopher comme un chien (Galilée, 187 pages, 25 €) n’échappe pas à la règle. Pour les lecteurs de Raymond Queneau (Chêne et chien, Philosophes et voyous), l’allusion au canidé se fait jour : « Le chien est chien jusqu’à la moëlle, il est cynique, indélicat, – enfant, je vis dans une ruelle deux fox en coïtation. L’animal dévore et nique ; il est féroce et impulsif, on sait où il aime mettre son nez », écrivait l’auteur des Exercices de style. Les fidèles du philosophe se souviennent aussi qu’il publia, en 1990, Cynismes, portrait du philosophe en chien (Le Livre de poche, 189 pages, 5 €). Son nouveau livre se place donc dans la mouvance des Cyniques et, plus particulièrement, de Diogène, « cette figure qui n’est tenue par aucun politiquement correct […] et se propose de mener la vie libre d’un philosophe libre. » Dans un savoureux avant-propos, l’auteur s’explique : « Diogène avait élu le chien comme animal fétiche. Dans un bestiaire emblématique […] le philosophe l’a choisi parce qu’il veille sur ses amis, saisit le mollet de ceux qui n’en ont pas l’habitude ; il mord aussi ses amis, mais, dit-il, pour les sauver. » Le chien en question tient du dogue, voire du pit-bull ; il n’a rien de commun avec les « yorkshires kantiens, […] toutous platoniciens, […] bichons hégéliens, […] chiens policiers, […] caniches en quantité » dont Michel Onfray dresse un amusant inventaire, auquel il manque peut-être le lévrier… afghan, grand goûteur involontaire de tartes à la crème.
Les titres des essais de Michel Onfray intriguent souvent. Son dernier opus, Philosopher comme un chien (Galilée, 187 pages, 25 €) n’échappe pas à la règle. Pour les lecteurs de Raymond Queneau (Chêne et chien, Philosophes et voyous), l’allusion au canidé se fait jour : « Le chien est chien jusqu’à la moëlle, il est cynique, indélicat, – enfant, je vis dans une ruelle deux fox en coïtation. L’animal dévore et nique ; il est féroce et impulsif, on sait où il aime mettre son nez », écrivait l’auteur des Exercices de style. Les fidèles du philosophe se souviennent aussi qu’il publia, en 1990, Cynismes, portrait du philosophe en chien (Le Livre de poche, 189 pages, 5 €). Son nouveau livre se place donc dans la mouvance des Cyniques et, plus particulièrement, de Diogène, « cette figure qui n’est tenue par aucun politiquement correct […] et se propose de mener la vie libre d’un philosophe libre. » Dans un savoureux avant-propos, l’auteur s’explique : « Diogène avait élu le chien comme animal fétiche. Dans un bestiaire emblématique […] le philosophe l’a choisi parce qu’il veille sur ses amis, saisit le mollet de ceux qui n’en ont pas l’habitude ; il mord aussi ses amis, mais, dit-il, pour les sauver. » Le chien en question tient du dogue, voire du pit-bull ; il n’a rien de commun avec les « yorkshires kantiens, […] toutous platoniciens, […] bichons hégéliens, […] chiens policiers, […] caniches en quantité » dont Michel Onfray dresse un amusant inventaire, auquel il manque peut-être le lévrier… afghan, grand goûteur involontaire de tartes à la crème.
Philosopher comme un chien réunit les chroniques publiées par Michel Onfray dans Siné hebdo, de septembre 2008 à août 2009. Echaudés par les 1300 pages de Bernard-Henri Lévy récemment publiées, quelques lecteurs se plaindront sans doute de ne trouver ici qu’une nouvelle compilation. Ils auraient tort. Car, contrairement à Pièces d’identité (dont j’ai déjà rendu compte ici), l’ouvrage, tout à fait digeste, ne contient aucun exercice de cabotinage : pas de satisfécits, de références récurrentes aux œuvres de l’auteur ; on ne risque pas non plus d’y trouver un comparatif entre les palaces de l’Ile Maurice, New York ou Saint Paul de Vence et, si l’on rit beaucoup, au fil des chapitres, ce n’est pas du comique involontaire de celui qui tient la plume, mais des portraits au vitriol qu’il ciselle avec talent.

Les adversaires de Michel Onfray lui reprochent souvent d’être prévisible, de s’attaquer toujours aux mêmes cibles et de se référer aux mêmes modèles. L’article des pages 99 à 101 aura de quoi les surprendre. Il s’agit de l’éloge de Pierre-Joseph Proudhon, « celui des anarchistes avec lequel je me sens le plus en phase », nous dit l’auteur qui considère qu’il « pense le monde sans filtre intellectuel, en pragmatique soucieux du réel. » J’avoue avoir lu plusieurs fois ces phrases pour me convaincre que je n’étais pas pris d’hallucination… Et je me suis posé une question : comment l’auteur de la Théorie du corps amoureux et du Souci des plaisirs peut-il se sentir si proche du philosophe qui écrivit De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise et (posthume) La Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes ? En matière de refoulement sexuel, Proudhon peut en effet soutenir la comparaison avec Paul de Tarse, que Michel Onfray condamne sans appel dans plusieurs de ses ouvrages. Sur l’hédonisme, Augustin d’Hippone et Kant, à côté du philosophe bisontin, feraient figure de dangereux laxistes. Quant au mépris porté aux femmes, Proudhon se montre encore plus féroce que ne l’étaient Origène ou Tertullien. Juliette Adam et Jenny d’Héricourt attaqueront d’ailleurs avec raison ce sinistre personnage qui écrivait, entre autres propos, dans La Pornocratie : « La femme ne hait point d’être un peu violentée, voire même [sic] violée. »

En dépit de cette réserve qui ne concerne qu’une chronique sur les soixante réunies dans ce recueil, Philosopher comme un chien offre un joli moment de lecture, matière à réflexion et une belle occasion d’attendre ce que l’auteur va nous dire de Freud dans son nouvel essai annoncé, Le Crépuscule d’une idole.
Illustrations : Gérôme, Diogène de Sinope, 1860 - Cave canem, mosaïque.

