Suite de mes pérégrinations discographiques pour exhumer le trésor
qui saura flatter mon lectorat et contenter mes oreilles. 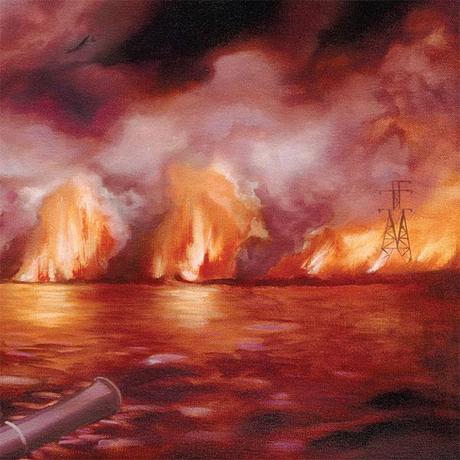 C’est un boulot à plein temps. Une sorte de sacerdoce. Une aventure de chaque instant. Chercher dans les broussailles de la production mondiale un album, que dis-je, l’album qui finira sur l’un des étals lustrés du Grand Musée du Rock. Bien en place. Stoïque. Figé dans l’immortalité. The Ikea of Fame en sorte. Cela demande bien sûr de l’intelligence, une certaine forme d’acuité et une excellente condition physique. Au fond, les mêmes sens sont sollicités lorsque vous vous retrouvez dans le réduit tortueux d’un bon vieux disquaire de quartier. Ces parfums cartonnés qui emplissent l’atmosphère, ces bacs compacts qui n’attendent que vos doigts précis, rusés, entrainés, pour livrer le collector, l’album culte tant espéré. Et puis la surprise : on vient pour une référence, on repart avec trois autres. C’est le sentiment irremplaçable, indescriptible qui vous saisit alors, faisant vibrer esprit et corps dans une transe quasi religieuse. Pas plus tard que ce matin, j’errai dans cette zone pour amateurs en transit près à décoller vers d’autres cieux concurrents. Je crois me souvenir précisément des lieux. Vous entrez dans un petit hall au minimalisme décoratif, façon salle d’attente de cabinet dentaire, mais attention, il n’est nullement question ici de vous arracher une quelconque dent. Vous traversez la pièce et arrivez face à une porte ouverte sur la boutique où les bacs méticuleusement classés par genre et par ordre alphabétique côtoient des bouquins de référence. Les patrons sont là, stoïques, discutant stocks, lp en vrac pour collectionneur maniaque, cotes et autres détails qui n’intéressent que les types dans mon genre. La salle baigne dans une chaude lumière. Derrière, une cabine regroupe une fantastique collection de guitares vintage, car les bonhommes ont aussi le bon goût de vendre ces instruments qui ont littéralement fait certains hommes. Nantis de ce précieux symbole viril, les plus audacieux d’entre eux purent allégrement tomber les femmes comme des vestes, si je puis oser cette métaphore. Ouais chérie, moi et ma guitare, on t’a composé une chanson. Ça s’appelle Starway To Heaven, un truc perso qui me trottait dans la tête. Dialogue classique que l’on peut surprendre les soirs d’été sur les plages de France. Revenons à Crazy Rock Circus, ouais, c’est le nom du commerce. Les boss échangent avec nous sur l’importance d’On The Beach de Neil Young et je songe alors au moment que je suis en train de vivre. Cette excitation à l’approche d’une découverte ou la déception qui imposera sa douloureuse loi. Oui, la vérité est là, dans ces rayonnages, chez ces mecs complètement dévolus à leur tâche, leur passion, leur mission. Ils sont les grands prêtres du rock, ils vous sélectionnent de ces hosties, mes frères : à faire danser un curé tonsuré de près au son de I Wanna Be Your Dog. En fait, le boulot de rock critique se résume à cette étape cruciale où l’on visite son dealer local pour repartir avec LA came qui circulera ensuite sous le manteau du buzz sous forme de chroniques édifiantes. Ce jour là, je suis reparti bredouille mais qu’importe car le contact s’est fait, aussi efficace qu’un riff de Jeff Beck. Où en étais-je ? Ah oui, j’évoquais ma quête quasi quotidienne du précieux chef-d’œuvre qui allait une fois de plus entretenir ma réputation. L’album du mois, et sans doute l’un de ceux qui figureront dans mon top ten annuel, je l’ai trouvé. Enfin. Un mythe. Un choc discographique. Une sorte de substance diablement addictive que l’on pourrait qualifier sérieusement en ces termes : de la space pop. Le mot est lâché. Je suis content de cette trouvaille. Il y avait le space rock d’Hawkwind. Il faudra désormais compter avec la space pop des Besnard Lakes. Je m’explique. Inutile de blablater sur la biographie du groupe. Ok, The Besnard Lakes Are The Roaring Night et leur troisième livraison après le génial The Besnard Lakes Are The Dark Horse. On pourrait citer tous les morceaux, les décrire avec force détail mais l’essentiel n’est pas là. On n’est pas en train de rédiger un dossier de presse ou un argumentaire de vente. On parle de musique, de cette dimension impressionniste qui vous marque à jamais, cette force d’attraction qui vous pousse à repasser le disque en boucle. La space pop quoi. Dès les (8) premières minutes on est happé. Plus rien ne compte, même pas la nomination de Michel Charasse au Conseil Constitutionnel. On est parti. L’ailleurs où l’on se trouve propulsé est mirifique, fait de chœurs cristallins et de guitares tourbillonnantes, dissertant à l’infini dans les crispations de l’électricité, noyées dans la réverb. La science des Besnard Lakes est climatique, non pas qu’ils nous illuminent de leurs propos nourris sur l’écologie, non. Ils n’ont pas leur pareil pour créer des ambiances que leur savante dramaturgie vient contrarier : une montée inexorable des voix conjuguées de façon orgasmique vers une explosion panthéiste des sons ainsi agencés. Leur pouvoir tient dans cette saisissante et délicate alchimie. Imaginez, car il faut des comparaisons, des Beach Boys dépressifs (pas difficile) menacés par le flingue d’un Phil Spector suant, hystérique, parce que son mur du son n’a pas encore posé sa toute dernière et indispensable pierre et vous vous ferez je crois une idée assez juste de la musique s’épanouissant à chaque seconde que compte Are The Roaring Night. Perso, à ce moment précis, je suis encore coincé dans l’extase gluante des huit premières minutes de l’album. Chose assez vicieuse et géniale, leur savoir-faire va plus loin, dans cette aptitude à enchaîner sur un trip plus calme, bien vaporeux qui finira malgré tout par se réveiller en tonitruants riffs déboulonnés avec l’exactitude d’un horloger suisse peu concerné par le débat sur les minarets. Tiens en parlant de minaret, car le coq-à-l’âne constitue l’une des nombreuses prérogatives du rock critique, The Besnard Lakes Are The Roaring Night est fondamentalement spirituel. De la première à la dernière minute qui serait le terminus des anges. Le paradis si vaste, si intemporel, si pur, serait pour beaucoup un enfer. L’album malgré sa pochette tout de flammes vêtue prend les formes connues du paradis perdu. Jace Lasek et son épouse Olga Goreas incarnant les Adam et Eve de l’aventure moderne. Elle, pour sa voix céleste. Lui pour sa guitare puissante, luminescent phare pour aiguiller les bonnes âmes. Ils n’ont pas encore goûté au fruit défendu (un contrat avec une major) qui pousse sur l’arbre de la connaissance et se content de livrer des fresques astrales, denses, éthérées. Leur studio d’enregistrement doit forcément se la jouer Chapelle Sixtine pour rockeurs. Je ne vois pas d’autres explications pour définir la musique de Besnard Lakes. En faut-il une ? Ok, il s’agit d’un absolu pour tout journaliste encarté mais appartenons-nous ici à cette confrérie qui parle en colonnes et en nombre de signes. Nous sommes des pourvoyeurs d’images magnifiques touchés avant les autres par la grâce de nos apôtres canadiens dont la liturgie n’a pas fini de faire parler d’elle. En tout cas, celle-ci me parle, j’y entends le message ésotérique que les chants séraphiques de Jace et Olga continueront de porter. A jamais et malgré les incursions dissonantes, les plages de mellotron (enfin une bonne nouvelle) et les percussions aux nombreux effets dramatisants. On rêve, logique pour une musique nimbée par excellence, à un quatrième album plus ramassé où le couple soudé s’essaierait enfin au format des trois petites minutes, comme ça, histoire de montrer que la pop n’est pas cette facilité navrante taillée pour (par) les radios mais bien cette fantaisie irréelle qui tatoue notre cœur de manière indélébile. Pas si débile ?
C’est un boulot à plein temps. Une sorte de sacerdoce. Une aventure de chaque instant. Chercher dans les broussailles de la production mondiale un album, que dis-je, l’album qui finira sur l’un des étals lustrés du Grand Musée du Rock. Bien en place. Stoïque. Figé dans l’immortalité. The Ikea of Fame en sorte. Cela demande bien sûr de l’intelligence, une certaine forme d’acuité et une excellente condition physique. Au fond, les mêmes sens sont sollicités lorsque vous vous retrouvez dans le réduit tortueux d’un bon vieux disquaire de quartier. Ces parfums cartonnés qui emplissent l’atmosphère, ces bacs compacts qui n’attendent que vos doigts précis, rusés, entrainés, pour livrer le collector, l’album culte tant espéré. Et puis la surprise : on vient pour une référence, on repart avec trois autres. C’est le sentiment irremplaçable, indescriptible qui vous saisit alors, faisant vibrer esprit et corps dans une transe quasi religieuse. Pas plus tard que ce matin, j’errai dans cette zone pour amateurs en transit près à décoller vers d’autres cieux concurrents. Je crois me souvenir précisément des lieux. Vous entrez dans un petit hall au minimalisme décoratif, façon salle d’attente de cabinet dentaire, mais attention, il n’est nullement question ici de vous arracher une quelconque dent. Vous traversez la pièce et arrivez face à une porte ouverte sur la boutique où les bacs méticuleusement classés par genre et par ordre alphabétique côtoient des bouquins de référence. Les patrons sont là, stoïques, discutant stocks, lp en vrac pour collectionneur maniaque, cotes et autres détails qui n’intéressent que les types dans mon genre. La salle baigne dans une chaude lumière. Derrière, une cabine regroupe une fantastique collection de guitares vintage, car les bonhommes ont aussi le bon goût de vendre ces instruments qui ont littéralement fait certains hommes. Nantis de ce précieux symbole viril, les plus audacieux d’entre eux purent allégrement tomber les femmes comme des vestes, si je puis oser cette métaphore. Ouais chérie, moi et ma guitare, on t’a composé une chanson. Ça s’appelle Starway To Heaven, un truc perso qui me trottait dans la tête. Dialogue classique que l’on peut surprendre les soirs d’été sur les plages de France. Revenons à Crazy Rock Circus, ouais, c’est le nom du commerce. Les boss échangent avec nous sur l’importance d’On The Beach de Neil Young et je songe alors au moment que je suis en train de vivre. Cette excitation à l’approche d’une découverte ou la déception qui imposera sa douloureuse loi. Oui, la vérité est là, dans ces rayonnages, chez ces mecs complètement dévolus à leur tâche, leur passion, leur mission. Ils sont les grands prêtres du rock, ils vous sélectionnent de ces hosties, mes frères : à faire danser un curé tonsuré de près au son de I Wanna Be Your Dog. En fait, le boulot de rock critique se résume à cette étape cruciale où l’on visite son dealer local pour repartir avec LA came qui circulera ensuite sous le manteau du buzz sous forme de chroniques édifiantes. Ce jour là, je suis reparti bredouille mais qu’importe car le contact s’est fait, aussi efficace qu’un riff de Jeff Beck. Où en étais-je ? Ah oui, j’évoquais ma quête quasi quotidienne du précieux chef-d’œuvre qui allait une fois de plus entretenir ma réputation. L’album du mois, et sans doute l’un de ceux qui figureront dans mon top ten annuel, je l’ai trouvé. Enfin. Un mythe. Un choc discographique. Une sorte de substance diablement addictive que l’on pourrait qualifier sérieusement en ces termes : de la space pop. Le mot est lâché. Je suis content de cette trouvaille. Il y avait le space rock d’Hawkwind. Il faudra désormais compter avec la space pop des Besnard Lakes. Je m’explique. Inutile de blablater sur la biographie du groupe. Ok, The Besnard Lakes Are The Roaring Night et leur troisième livraison après le génial The Besnard Lakes Are The Dark Horse. On pourrait citer tous les morceaux, les décrire avec force détail mais l’essentiel n’est pas là. On n’est pas en train de rédiger un dossier de presse ou un argumentaire de vente. On parle de musique, de cette dimension impressionniste qui vous marque à jamais, cette force d’attraction qui vous pousse à repasser le disque en boucle. La space pop quoi. Dès les (8) premières minutes on est happé. Plus rien ne compte, même pas la nomination de Michel Charasse au Conseil Constitutionnel. On est parti. L’ailleurs où l’on se trouve propulsé est mirifique, fait de chœurs cristallins et de guitares tourbillonnantes, dissertant à l’infini dans les crispations de l’électricité, noyées dans la réverb. La science des Besnard Lakes est climatique, non pas qu’ils nous illuminent de leurs propos nourris sur l’écologie, non. Ils n’ont pas leur pareil pour créer des ambiances que leur savante dramaturgie vient contrarier : une montée inexorable des voix conjuguées de façon orgasmique vers une explosion panthéiste des sons ainsi agencés. Leur pouvoir tient dans cette saisissante et délicate alchimie. Imaginez, car il faut des comparaisons, des Beach Boys dépressifs (pas difficile) menacés par le flingue d’un Phil Spector suant, hystérique, parce que son mur du son n’a pas encore posé sa toute dernière et indispensable pierre et vous vous ferez je crois une idée assez juste de la musique s’épanouissant à chaque seconde que compte Are The Roaring Night. Perso, à ce moment précis, je suis encore coincé dans l’extase gluante des huit premières minutes de l’album. Chose assez vicieuse et géniale, leur savoir-faire va plus loin, dans cette aptitude à enchaîner sur un trip plus calme, bien vaporeux qui finira malgré tout par se réveiller en tonitruants riffs déboulonnés avec l’exactitude d’un horloger suisse peu concerné par le débat sur les minarets. Tiens en parlant de minaret, car le coq-à-l’âne constitue l’une des nombreuses prérogatives du rock critique, The Besnard Lakes Are The Roaring Night est fondamentalement spirituel. De la première à la dernière minute qui serait le terminus des anges. Le paradis si vaste, si intemporel, si pur, serait pour beaucoup un enfer. L’album malgré sa pochette tout de flammes vêtue prend les formes connues du paradis perdu. Jace Lasek et son épouse Olga Goreas incarnant les Adam et Eve de l’aventure moderne. Elle, pour sa voix céleste. Lui pour sa guitare puissante, luminescent phare pour aiguiller les bonnes âmes. Ils n’ont pas encore goûté au fruit défendu (un contrat avec une major) qui pousse sur l’arbre de la connaissance et se content de livrer des fresques astrales, denses, éthérées. Leur studio d’enregistrement doit forcément se la jouer Chapelle Sixtine pour rockeurs. Je ne vois pas d’autres explications pour définir la musique de Besnard Lakes. En faut-il une ? Ok, il s’agit d’un absolu pour tout journaliste encarté mais appartenons-nous ici à cette confrérie qui parle en colonnes et en nombre de signes. Nous sommes des pourvoyeurs d’images magnifiques touchés avant les autres par la grâce de nos apôtres canadiens dont la liturgie n’a pas fini de faire parler d’elle. En tout cas, celle-ci me parle, j’y entends le message ésotérique que les chants séraphiques de Jace et Olga continueront de porter. A jamais et malgré les incursions dissonantes, les plages de mellotron (enfin une bonne nouvelle) et les percussions aux nombreux effets dramatisants. On rêve, logique pour une musique nimbée par excellence, à un quatrième album plus ramassé où le couple soudé s’essaierait enfin au format des trois petites minutes, comme ça, histoire de montrer que la pop n’est pas cette facilité navrante taillée pour (par) les radios mais bien cette fantaisie irréelle qui tatoue notre cœur de manière indélébile. Pas si débile ?
09-03-2010 | Envoyer | Déposer un commentaire | Lu 1457 fois | Public
 Ajoutez votre commentaire
Ajoutez votre commentaire
