Voici les livres dont nous avons parlé, le 27 février 2010, Cécile Guilbert, Josyane Savigneau, Sabine Audrerie et votre serviteur dans « Jeux d'épreuves », une émission littéraire de France Culture présentée par Joseph Macé-Scaron (> Lien vers le site de l'émission )

Merci à Cécile Guilbert qui m'a fait connaître Philippe Bordas dont j'ai savouré L'invention de l'écriture, formidable hommage de l'homme de lettres à l'homme de langue, Frédéric Bruly Bouabré, noir instruit en science européenne, artiste premier, archétypal et définitoire, animiste et chrétien, un écrivain peintre, un peintre écrivain. Cet Ivoirien, aujourd'hui âgé de 87 ans, a donné naissance aux 400 signes de l'alphabet bété, cette ethnie à laquelle il appartient lui-même et qui a été privée de lettres qui sont la magie des Blancs.
J'ai été d'emblée frappé par la poésie du texte. Ainsi, quand l'auteur met en parallèle Bruly Bouabré et Ponge – auquel le livre est dédié - :
Francis Ponge fond la monnaie ancienne, Bruly extrait le métal nouveau.
Plus loin, on lira sous la plume de Philippe Bordas que le sage rêve son présent.
Il s'agit d'un livre très envoûtant parce que la démarche de l'auteur n'est pas d'embrasser toute la personnalité de Bruly Brouabré et tenter d'en faire un portrait exhaustif. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt ici de ne souligner que quelques éléments biographiques de cet homme. Un portrait anglé, pourrait-on dire. Philippe Bordas me donne le sentiment de ne retenir que certains éléments de la vie de cet homme pour en faire une sorte de variation musicale.
Ce texte ne flirte pas avec l'indécence hagiographique. Ce qui n'empêche pas le respect de l'auteur pour son « modèle ». Mais il n'y a pas d'aveuglement. Il y a, au contraire, beaucoup de retenue dans ce texte. Et cette démarche incite le lecteur à aller au-delà de ce texte, à en savoir plus sur ce singulier Africain.
Il se trouve qu'en ce moment, à Paris, à la Maison Européenne de la Photographie, et à Lausanne, à la collection d'art brut, deux expositions nous permettent d'entrer dans l'univers de Bruly Brouabré et/ou Bordas.
Je trouve qu'au-delà de tout cela, l'occasion nous est donnée de lire quelque chose de différent sur l'Afrique qui n'est ni larmoyant, ni défaitiste – comme le fait la collection Continents Noirs de Gallimard, sous la direction de Jean-Noël Schifano, qui fête ses 10 ans – (voir chronique en janvier 2010 sur Le diable dévot de Libar Fofana).
Dernier argument : l'écriture de Philippe Bordas est tellement imagée qu'elle donne envie de faire un long documentaire sur Bruly Bouabré.
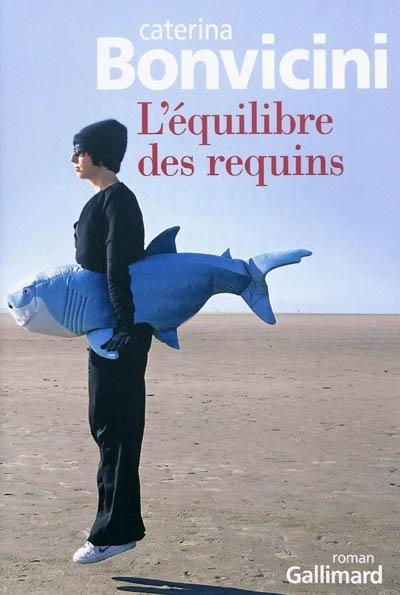
Il m'a fallu un peu plus de 200 pages – sur les 300 que compte L'équilibre des requins - pour entrer dans ce roman qui m'a totalement désarçonné. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à une jeune femme complètement dans l'air du temps. Qui se marie puis qui se sépare. Qui a un nouvel amant, Arturo, puis n'en a plus. Qui en voit un autre, Marcello, entrer dans sa vie puis en sortir. En grossissant le trait et en jouant un peu les provocateurs je dirais que j'ai eu le sentiment de lire un journal tenu par une femme dont le compte-rendu serait fait par un magazine féminin.
Bref, je n'ai d'abord pas cru à ce texte ni à la dépression de son personnage principal dont je ne voulais voir que l'égocentrisme, le nombrilisme et le manque de sérieux – je ne suis pas séduit par ce genre d' humour trop léger -.
Mais il faut toujours lire les livres jusqu'au bout. En fait j'ai compris tardivement qu'il s'agissait d'humour du désespoir. Quand Nicola, le mari, revient, j'ai changé d'avis. Et à mesure que je m'approchais de la fin du roman tout devenait plus clair. Je crois que ce livre mérite une lecture plus attentive de ma part.
Peut-être goûterai-je alors différemment les nombreux parallèles entre cette fille d'océanographe qui sombre et les requins si chers au coeur de son père ? Peut-être m'abandonnerai-je alors à des phrases telles que : Si tu as peur, tu te mets dans la position de la proie ?
Était-il toutefois important de se livrer à cette référence animale. Après tout, Hobbes nous avait déjà dit au 17è siècle que l'homme est un loup pour l'homme.
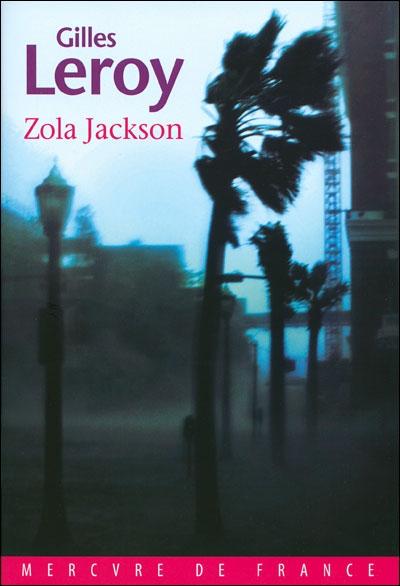
C'est le genre de livre que je vais sans doute assez vite oublier. Non pas que sa lecture soit un pensum mais parce que je le trouve consensuel. Consensuel dans le choix de cette tragédie survenu à la Nouvelle-Orléans, le 29 août 2005, événement qui a donné lieu à un énorme traitement médiatique.
D'emblée, je me suis demandé s'il n'y avait pas la tentation ici d'exploiter un tel fait d'actualité avec son cortège de sentiments - l'angoisse, la tristesse, les rares joies et surtout l'extraordinaire suspense – en se disant que, tout ça mélangé, ça allait faire un livre qui marche.
L'accumulation de signes choisis par l'auteur finit par provoquer chez moi un trop-plein. Jugez plutôt. L'héroïne s'appelle Zola – ah la référence au naturalisme -, elle est née le 15/08 – ah la référence religieuse -, elle est noire et appartient donc à une minorité, elle s'est faite mettre à mi-temps de l'éducation parce qu'elle boit, elle n'a plus de mari, elle a un fils mulâtre dont elle a du mal à accepter l'orientation sexuelle.
J'ai eu le sentiment qu'on recherchait d'emblée ma compassion. Comme s'il s'agissait d'avertir le lecteur que, décidément, le sort s'acharne sur cette pauvre mère Courage. Je n'ai ni suivi, ni compati.
Et puis il y a cette attente de Zola quand les eaux montent. Zola avec sa chienne dans cette maison inondée. Elle agonise mais elle a du courage. On a l'impression de voir Bruce Willis dans un film dont les grandes majors d'outre-Atlantique ont le secret. Ces grosses ficelles n'ont pas du tout accroché mon attention. Et tout cela ne fait que monter en puissance jusqu'à l'épilogue où Zola Jackson se réconcilie avec le compagnon de son fils.
Si j'étais un réalisateur cherchant à réaliser le jack-pot, je crois que j'appellerais immédiatement Gilles Leroy pour lui proposer de porter son livre à l'écran. Je crois qu'il y aurait là la promesse d'un très juteux pactole.
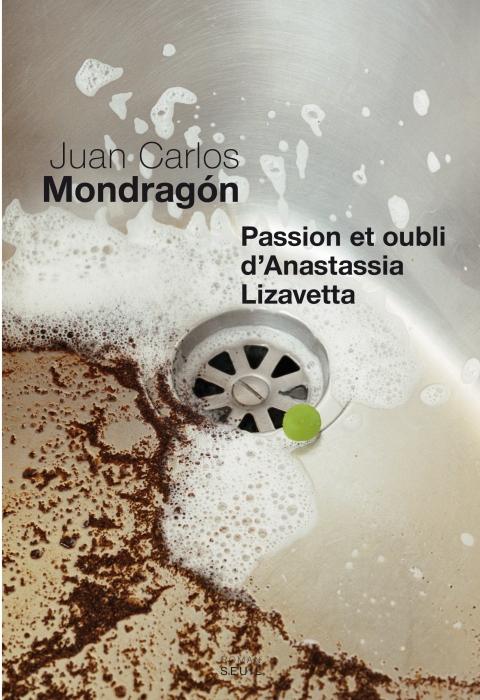
Laissez-moi vous parler, en préambule, de Juan Carlos Mondragon. C'est un écrivain uruguayen de 59 ans qui a déjà une douzaine de livre à son actif. Il signe là son deuxième roman aux éditions du Seuil. Le premier, Oriana à Montevideo, date de 2002 -. Deux ans plus tard il y eut Le principe de Van Helsing en 2004, un recueil de nouvelles.
Titre curieux : Passion et oubli d'Anastassia Lizavetta. Ça ne sonne pas très uruguayen Les connaisseurs de Dostoïevski auront reconnu le nom d'un personnage des Frères Karamazov, Lizaveta – avec un « t » - Smerdiatchcaïa, femme muette de la rue. Ce n'est pas la première fois que Juan Carlos Mondragon fait référence au grand écrivain russe puisque, dans Oriana à Montevideo, l'écrivain dit, à propos de Claudio, un des personnages : Précisons qu'il avait connu les privations, mais sans la folie d'un Raskolnikov attaquant à la hache l'usurière Aliona Ivanovna. Cette fois, il n'est pas question de hache mais de couteau.
Couteau dont cette femme, donc, Anastassia Lizavetta, cousine du narrateur, s'empare, une nuit d'insomnie, pour tuer son mari. Et pas n'importe quel couteau :
C'est un couteau coréen acheté l'hiver dernier grâce à une émission de téléachat.
Étonnant de la part de cette habitante de Montevideo dont la vie semble toujours avoir été parfaitement linéaire.
Jamais l'idée de tuer ne lui était venue à l'esprit ; un de mes confrères dirait que son geste condensait sur le plan symbolique une succession interminable de frustrations, une kyrielle de petites déceptions, de dépits ordinaires qui n'auraient pas dû gâcher sa vie si elle avait pu les surmonter avec résignation. Évidemment, de loi, il est facile de tout arranger.
Plus loin :
Ma cousine avait dissimulé ses illusions, les avait enfermées à double tour, à commencer par les plus innocentes. Entassées quelque part, elles étaient devenues les spectres dont elle écoutait à présent les rires sarcastiques. Elle croyait que les mauvais pensées sont le résultat d'un traumatisme survenu dans l'enfance.
Nous partons donc à la recherche des raisons qui « expliqueraient » le geste d'Anastassia Lizavetta. Et cette recherche se met en mouvement au moment où cette femme décide de quitter son appartement situé dans la Tour L du parc Posadas. Tout le livre est une gigantesque déambulation hypnotique dans les rues de Montevideo, la capitale uruguayenne. Le narrateur fouille dans le passé de sa cousine et avance des explications.
Elle n'aime pas sortir sans s'être lavée, de peur que les gens ne découvrent que son corps est sale. Cette crainte lui vient du jour où une bonne de la maison voisine à peine plus âgée qu'elle, l'a enlacée en lui soufflant : « Laisse-moi te toucher. » Le souvenir de cette agression est resté profondément gravé en elle, et toutes les douches du monde ne peuvent effacer l'empreinte de cette langue, plus dure et plus fouineuse que celle des garçons de l'école qui ont pu marquer sa sexualité d'enfant.
Anastassia Lizavetta doit également faire face à la violence verbale de son mari. Exemple, quand elle achète des chaussures :
« Des chaussures de pute », avait dit son mari quand elle les avait achetées, et il avait même fait des remarques agressives la première fois qu'elle les avait mises.
Ce qui fait dire au narrateur :
J'ai toujours détesté sa manière vulgaire, autoritaire et parfois même obscène de la traiter en public. Ce matin, peut-être par esprit de vindicte, elle se plaît en cet équipage, elle se souvient même d'un des amoureux qui lui avait un jour glissé à l'oreille qu'il aimerait voir se prostituer. Les amies auxquelles elle s'en était ouverte lui avaient affirmé qu'il s'agissait d'une pure et simple provocation. Mais ma cousine savait qu'il était sincère.
Moment terrible aussi que celui où Anastassia Lizavetta doit avorter mais n'en rien dire, même pas au curé si un jour tu te maries à l'église, ajoute sa mère.
Chaque pas qu'elle ferait désormais ne dépendrait ni de sa volonté ni d'un caprice, mais répondrait à une détermination d'un autre ordre, et si elle cherchait maintenant des explications c'est parce que celle qui avait tué « n'était pas tout à fait elle ». Elle avait l'impression, comme elle a essayé de me le dire plus tard, que quelqu'un l'avait choisie dans le seul but de l'observer et de prendre des notes; Pour écrire un roman, par exemple. Parce qu'elle croyait faire partie à son insu d'une expérience portant sur les réactions d'une personne ordinaire confrontée à une situation déstabilisante.
Dans ce roman, nous suivons donc une femme qui tombe. Lentement mais sûrement. Qui ne peut s'accrocher à rien. Surtout pas sa famille.
Car son oncle - comme son père - se livre à des attouchements sexuels sur elle. Le narrateur nous dit d'ailleurs cette phrase terrible : Il lui a laissé en guise de cadeau ce souvenir, pour qu'elle le garde enfoui toute sa vie, avec l'ordre implicite d'user de la boisson pour oublier.
En toile de fond, à moins qu'il ne s'agisse du personnage principal, il y a la ville de Montevideo. Cette ville enferme, cloisonne, ressemble à n'importe quelle autre ville du monde, guettée par une forme néfaste de mondialisation.
Un déclin irréversible qu'on ne remarque pas dans les traces de son passé mais à ce que les ombres du présent cachent de l'avenir et que l'on devine pour peu que l'on prête attention à ce qui nous entoure.
Cette envie de rupture – de fuite - était déjà présente dans Oriana à Montevideo. Rappelons que l'auteur lui-même a rompu avec sa partie puisqu'il vit en France depuis quelques années maintenant.
La culture uruguayenne n'est plus que le bruit d'une benne à ordures mêlé aux coups de klaxon des autobus dernier modèle.
Vers la fin le narrateur « cède sa place ». C'est un des moment forts du livre qui pose la question de la voix. Anastassia Lizavetta a-t-elle voix au chapitre dans ce monde ? Non, et ce silence lui a été dicté.
Une merveilleuse description de la dépossession de soi, en somme.

