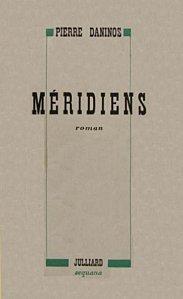
Largement inspiré de la vie de l'auteur, Méridiens raconte les tribulations d'un soldat, Jean Soleure, rescapé de la bataille de Dunkerque, qui, après un séjour de quelques mois dans un hôpital anglais, embarque pour Rio où il réussit à publier son premier livre. Il succombe d'abord au charme de la vie brésilienne, faite de nonchalance, de soleil, de paysages grandioses et de jeunes filles sublimes, puis, lassé de cette existence trop facile, trop factice, ressent à nouveau le besoin de partir. Il répond à l'invitation d'un éditeur américain et part pour New-York via l'argentine, le Pérou, Panama et La Nouvelle Orléans. Il y rencontre Barbara, délicieux mélange de sang irlandais et slave, qui lui fait presque oublier Martine, son amour d'enfance qu'il n'a plus revu depuis sa mobilisation. Mais New-York se révèle moins hospitalière que prévu. Le succès du livre, pourtant lancé à grand renfort de publicité, est de courte durée. Les dollars viennent à manquer. Barbara s'éloigne. Les meublés médiocres succèdent aux hôtels confortables. Jean Soleure repart au Brésil pour y chercher une île déserte où se retirer loin du monde. Ce sera l'Ilha do Regador, petit territoire sauvage seulement connu de quelques pêcheurs. Le Robinson s'y installe, découvre que sa liberté est un leurre et, lassé de cette solitude qui ne l'apaise même pas, regagne Rio d'où un avion l'emmène pour Lisbonne. Il retrouve finalement Martine qu'il se promet de ne plus quitter, pour autant que le laisse tranquille ce besoin de partir, de s'enfuir, qui le tenaille depuis l'enfance.
Dans la même veine que son premier livre, mêlant éléments biographiques et romanesques, Méridiens est le roman d'une attirance, d'une fascination pour le départ, le
voyage, les pays lointains. C'est aussi un regard lucide sur ces contemporains, sur la difficulté de se trouver, d'être soi-même, sur la précarité des sentiments. On y retrouve un Daninos
pudique, désabusé, dont le style manque parfois encore de concision mais qui sait déjà dénoncer, critiquer, s'insurger, sans violence, et avec cette forme de gentillesse amusée qu'il développera
dans ses ouvrages ultérieurs.
Désillusions
Nuits de Rio… Soirées au clair de lune… Combien de fois les films et les récits de m'ont-ils pas comblé les yeux et rebattu
les oreilles de vos "délices enchanteurs"… Il ne nous aura cependant pas fallu longtemps à Sylvestre et à moi, pour comprendre et admettre que, de la coupe tendue chaque soir par les jeunes
beautés de l'avenida Atlantica à nos lèvres avides, il y a un pas que l'on ne franchit rapidement que dans les rêves. Car ces ravissantes jeunes filles, qui laissent le clair de lune et les yeux
des senhores caresser leurs bras dorés et leurs fermes attraits, disparaissent vers vingt-deux heures pour rejoindre leurs lits et non les nôtres. Elles ne sont pas pour nous, ces plus belles,
ces plus pures. Respirer, ne pas toucher. A nous que le désir fouaille s'offriront, vers minuit, sur le trottoir de la promenade, les mulatines à vingt milreis descendues des moros. Elles sont
très gentilles, d'ailleurs, ces mulatines, dont la teinte s'échelonne du plus clair café au lait à l'ocre le plus sombre…
Un éditeur, enfin...
Je ne m'étais pas trompé. Voici enfin un éditeur sérieux. Un éditeur qui m'a pris mon manuscrit, ce qui est bien, qui l'a lu, ce qui est mieux, et qui me le rend en me donnant son accord, ce qui
est parfait. Il est vrai que ce n'est encore qu'un accord de principe. Mais l'accord de fait n'est pas méchant. L'éditeur, qui trouve le roman intéressant du point de vue psychologique, est prêt
à le publier si je veux bien allonger ma partie guerre et faire de la toile de fond dunkerquoise un grand tableau. Ainsi, il me laisse mes héros, il me laisse mes amants, il me laisse mon
intrigue. Il me laisse tout. C'est un amour, cet éditeur! Je l'embrasse, ou plutôt j'embrasse ses vues. Je ne saurais refuser un petit Dunkerque prolongé à un homme aussi révérencieux pour l'art
pur. Il l’aura, son Dunkerque; je vais vous en mettre, de la guerre, attendez un peu. Un peu, c’est trois semaines, trois semaines pendant lesquelles mon cher petit enfant, jusque-là bien bâti,
proportionné et symétrique, devient une espèce de monstrueux diptyque où l‘on périt d‘amour pendant cent cinquante pages, et où l‘on meurt de la guerre pendant cent cinquante autres. J’ai laissé
inchangées les cent cinquante premières, et, à la cent cinquante et unième, j’améliore ma guerre éclair. « Elle est venue terrible un matin de printemps, comme personne ne croyait plus
ni à la guerre, ni au printemps. »
La meilleure façon de faire la guerre
La guerre, en somme, crée trois sortes de gens: ceux qui la font faire, ceux qui la font, ceux qui la suivent. Ce sont peut-être ces derniers qui, de tous, sont les plus exigeants. Les plus
agissants aussi.Plus d’un résident, qui ne jurait que par la peau des boches, oubliait complètement l’époque où, tremblotant dans son veston de toile, il avait gravi en pleine guerre les
escaliers de l’ambassade, pour faire valoir à l’attaché militaire les impérieuses raisons qui exigeaient, pendant quelque temps encore, sa présence à Rio.
Promotion
Sous le feu de leurs questions, je me sens pris comme par un vertige. D’abord je ne veux rien répondre, m’éclipser, mais mon
manager est là qui m’éperonne, qui déjà parle à ma place et dit tout ce qui lui passe par la tête.
- Cet homme que vous voyez a été fait prisonnier… Il s’est évadé au péril de sa vie, a été arrêté, traduit en conseil de guerre, condamné à mort, s’est échappé en tuant deux sentinelles allemandes, a été torpillé au large de Dunkerque, etc., etc.
Étourdi par cette énumération, gagné par cette verve, je décide de rentrer dans la danse. Moi aussi, je veux dire mon mot. Ma famille a vu sa maison brûler… Une petite maison de campagne bien française… Les chevaux étaient comme fous… la fermière aussi… Oui, je me suis raccroché à une épave pour ne pas sombrer… De ma fiancée, je n’ai pas de nouvelles, elle s’appelle Martine… so terrible indeed.. Mais la France revivra… quand à moi, dégoûté du monde civilisé, je cherche une île déserte… Je vis mes derniers mois dans l’univers habillé.
En un clin d’œil, la masse des reporters s’est dispersée. Le public relation agent, enlevant son chapeau, se laisse tomber sur un des fauteuils du salon, s’éponge le front, nettoie ses verres embués, sourit:
- I think we have done a good job… We’ll see the papers now.
Sur une île...
Je voulais tout oublier, je n’ai oublié que le pire. Le souvenir du meilleur, vivace, me hante, tandis qu’ici la présence obstinée du pire efface le meilleur de mon rêve
Je ne vois pas de Paris le métro odoriférant, les gens aigris, la saleté des murs, la laideur des maisons; je vois le mariage chaque printemps renouvelé de la pierre grise du Louvre avec le bleu pastel du ciel d’Ile-de-France.
Je ne vois pas la France en noir du dimanche; je vois le charme de Martine et de ses amies qui d’un rien font une robe, et de dix riens semblables dix robes différentes.
Je ne vois pas la crasse et l’avarice des fermiers millionnaires; je vois les fermes dont les murs patinés par le temps se fondent avec l’or des blés de la terre.
Je ne vois pas les fonctionnaires acrimonieux, les blouses sales des employés, les loges putrides des concierges; je vois des gens têtus et fous d’indépendance qui critiquent tout le monde et ne veulent vivre comme personne.
Je ne vois pas la France qui déjeune et dîne à la cuisine pour ne pas salir la table de salleà manger; où les fauteuils dorment sous les housses; je vois la France des coqs au vin et du Saint-Emilion.
Je ne vois pas la hideur des lotissements de banlieue, les pavillons des petits rentiers de la Garenne-Bezons et du Kremlin-Bicêtre; je vois les perspectives du Carrousel et des jardins du Trianon.
Je ne vois pas les bistrots, je vois les vignobles.
Je ne vois pas les cancans des bigotes, je vois les flèches des cathédrales.
Je ne vois pas le travail à la chaîne, je vois le fignolage de l’artisan.
Je ne vois pas Martine, je vois Martine sans ses défauts… enfin! Une femme qui me comprenne sans que je parle après tant d’autres qui ne m’ont pas compris quand je parlais.
Epilogue
Parfois, des gens étriqués, une rue lépreuse, un accent trop hargneux, une aube trop grise, une vent aigrelet, réveillent brusquement en moi cet appétit de départ, de solitude, de grand large,
que je croyais rassasié. Quitterai-je un jour cette femme? Quitterai-je ces amis? Trahirai-je ce réseau que tissèrent les atomes et dont je suis l’heureux esclave? Et y aura-t-il sur terre un
homme, un ami, un Sylvestre pour me comprendre? Il y a quelque temps, comme j’évoquais une de ces aubes flamboyantes qui illuminaient encore le souvenir de l’île, j’ai perçu dans le regard de
Martine le reflet de la crainte. Rien ne saurait lui garantir qu’un jour je ne partirai point sans elle. Il n’y a peut-être que cette ombre sur notre bonheur, mais elle pèse. Et quand Martine
dit: « Tu sais… si un jour tu veux repartir… je comprendrai… », je sens tellement qu’elle ment, tellement qu’elle ment…


