Alors que l'on célèbre les cinquante ans de la disparition d'Albert Camus, La Brèche revient sur l'œuvre du Nobel 1957 et sur les hommages unanimes dont il fait aujourd'hui l'objet.
 Le cinquantenaire de la mort d'Albert Camus est difficile à ignorer, tant il est l'occasion d'hommages divers. Une cascade de publications, d'abord. Des œuvres de Camus, bien entendu, comme la récente réédition de la version originale de La postérité du soleil (Gallimard), paru après la mort de l'auteur, en 1965, grâce à René Char ; ou encore la parution en poche de La mort heureuse (Gallimard, coll. « Folio », le 5 janvier 2010), un récit de jeunesse. Les ouvrages sur Camus ne manquent pas non plus, en particulier l'omniprésent Dictionnaire Albert Camus dirigé par Jeanyves Guérin (Robert Laffont, coll. « Bouquins »), et le beau Albert Camus, solitaire et solidaire (Michel Lafon) de Catherine Camus, gestionnaire de l'œuvre de son père depuis 1980 (et à qui l'on doit notamment la parution en 1994 du Premier homme resté à l'état de manuscrit et inachevé). Mais depuis quelques temps, l'hommage a gagné d'autres sphères et l'intérêt soutenu des médias, plus précisément depuis l'annonce par Nicolas Sarkozy, le 19 novembre dernier, de sa volonté de faire entrer Albert Camus au Panthéon, « un symbole extraordinaire » selon le chef de l'État, qui n'a pas cru utile de préciser de quoi.
Le cinquantenaire de la mort d'Albert Camus est difficile à ignorer, tant il est l'occasion d'hommages divers. Une cascade de publications, d'abord. Des œuvres de Camus, bien entendu, comme la récente réédition de la version originale de La postérité du soleil (Gallimard), paru après la mort de l'auteur, en 1965, grâce à René Char ; ou encore la parution en poche de La mort heureuse (Gallimard, coll. « Folio », le 5 janvier 2010), un récit de jeunesse. Les ouvrages sur Camus ne manquent pas non plus, en particulier l'omniprésent Dictionnaire Albert Camus dirigé par Jeanyves Guérin (Robert Laffont, coll. « Bouquins »), et le beau Albert Camus, solitaire et solidaire (Michel Lafon) de Catherine Camus, gestionnaire de l'œuvre de son père depuis 1980 (et à qui l'on doit notamment la parution en 1994 du Premier homme resté à l'état de manuscrit et inachevé). Mais depuis quelques temps, l'hommage a gagné d'autres sphères et l'intérêt soutenu des médias, plus précisément depuis l'annonce par Nicolas Sarkozy, le 19 novembre dernier, de sa volonté de faire entrer Albert Camus au Panthéon, « un symbole extraordinaire » selon le chef de l'État, qui n'a pas cru utile de préciser de quoi.
Popularité d'une œuvre (et ses contreparties)
Il faut reconnaître à l'œuvre de Camus un mérite devenu rare : il est probablement l'un des plus lus des auteurs du siècle dernier, en particulier du fait de son inscription quasi-permanente aux programmes de l'éducation nationale. Et si cette œuvre-là est lue, en particulier sur les bancs des établissements du secondaire, c'est qu'elle est accessible, ce qui est également un mérite certain. Les Français sont familiers avec les livres de Camus, et les grands thèmes qu'ils exploitent à travers les deux fameux « cycles », celui de l'absurde et celui de la liberté, ou de la révolte. Camus offre une synthèse simple sur ces deux grands thèmes modernes. Les influences qui s'exercent sur Camus sont généralement transparentes, souvent même revendiquées (Dostoïevski, Kafka, Jean Grenier, René Char), parfois aussi négligées (comme celles pourtant évidentes de Malraux ou d'Albert Memmi dont La statue de sel, préfacée par Camus, évoque irrésistiblement Le premier homme).
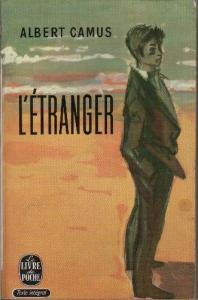 Une synthèse simple mais aussi, comment ne pas l'admettre, souvent simpliste, parfois maladroite ou lacunaire. « Les grands romanciers sont des romanciers philosophes » dit justement Camus dans Le mythe de Sisyphe. Or, lui-même ne peut semble-t-il pas être qualifié de « philosophe » autrement qu'entre guillemets. S'il fait sans nul doute partie de cette catégorie des romanciers philosophes, en revanche, Camus pense en romancier, et ses essais philosophiques n'ont jamais séduit d'un autre point de vue que littéraire. La « philosophie » de Camus est une éthique elle aussi accessible, populaire même. L'absurde de Sisyphe ou de L'étranger perd tout le caractère tragique d'une « lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu », que lui confère Schopenhauer et, à sa suite, Kafka, ou le Sartre de la Nausée : il n'est pour Camus que la privation de bonheur, de liberté, en un monde saturé de beauté. Dès lors, l'absurde camusien est injustice et fonde la révolte, aussi bien que la non-violence, et l'engagement d'un écrivain au service, non de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent, pour reprendre les mots du discours de Stockholm, lors de la remise du Nobel en 1957. Un engagement admirable et constant, qui ne fait pourtant pas de Camus un philosophe.
Une synthèse simple mais aussi, comment ne pas l'admettre, souvent simpliste, parfois maladroite ou lacunaire. « Les grands romanciers sont des romanciers philosophes » dit justement Camus dans Le mythe de Sisyphe. Or, lui-même ne peut semble-t-il pas être qualifié de « philosophe » autrement qu'entre guillemets. S'il fait sans nul doute partie de cette catégorie des romanciers philosophes, en revanche, Camus pense en romancier, et ses essais philosophiques n'ont jamais séduit d'un autre point de vue que littéraire. La « philosophie » de Camus est une éthique elle aussi accessible, populaire même. L'absurde de Sisyphe ou de L'étranger perd tout le caractère tragique d'une « lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu », que lui confère Schopenhauer et, à sa suite, Kafka, ou le Sartre de la Nausée : il n'est pour Camus que la privation de bonheur, de liberté, en un monde saturé de beauté. Dès lors, l'absurde camusien est injustice et fonde la révolte, aussi bien que la non-violence, et l'engagement d'un écrivain au service, non de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent, pour reprendre les mots du discours de Stockholm, lors de la remise du Nobel en 1957. Un engagement admirable et constant, qui ne fait pourtant pas de Camus un philosophe.
Un détournement malvenu
L'unanimité des hommages à Camus est forcément un peu le résultat de cette simplicité et des défauts qu'elle induit. Albert Camus est depuis bien longtemps un auteur populaire, qui ambitionnait d'ailleurs d'écrire pour le public mêlé des théâtres et dont le Caligula révéla Gérard Philipe en 1945. Depuis les polémiques avec Sartre et les existentialistes, depuis le Nobel, depuis la mort en 1960, les ventes de Camus n'ont guère faibli. L'étranger demeure le livre le plus vendu en format poche (6,7 millions d'exemplaires au total), et ses nombreuses traductions en font l'un des textes français les plus connus et respectés, comme l'illustrait de façon amusante sa présence parmi les lectures revendiquées par George W. Bush, lorsque ce dernier voulut se forger une image respectable lors de son deuxième mandat.
Mais il serait injuste de faire reposer ce consensus sur la seule responsabilité de Camus. Ce cortège de noms si surprenants, parce que si étrangers à la pensée de Camus et à ses convictions, est bien un peu indécent (on oserait dire absurde), lorsqu'on en vient à Georges-Marc Benamou, Alain Finkielkraut ou bien, donc, Nicolas Sarkozy. Et cette indécence se révèle justement, peut-être, par la volonté d'un hommage officiel, la fameuse « panthéonisation ». La rareté de ce rituel républicain, qui n'est en rien subie mais de plus en plus recherchée (plus de 200 caveaux sont disponibles et la place est encore plus grande pour les simples inscriptions), n'en a pas accru la valeur. En revanche chacun perçoit aujourd'hui combien les choix successifs dessinent aussi le profil des « éliminés », des grands hommes auxquels la Patrie, ou du moins ceux qui la représentent, ne veulent pas témoigner leur reconnaissance, fait d'autant plus significatif en ces temps de débat sur l'identité nationale. Faire entrer aujourd'hui Camus au Panthéon, c'est donc refuser cet honneur à Sartre. Ce choix-là, il ne devrait revenir à personne de le faire. Pourtant, c'est aussi ce sens-là qu'acquiert la proposition de Nicolas Sarkozy, qui s'inscrit à ce titre dans le mouvement de « liquidation » de mai 68. Effectivement, en 68, Camus n'était plus là pour prendre position.
 La récupération de l'hommage, son détournement entrepris depuis quelques semaines est d'autant plus déplorable qu'au fond, Camus est un véritable écrivain, qui à ce titre mérite certainement le Panthéon, pour son œuvre riche, ses romans et récits, ses nouvelles parfois admirables (La pierre qui pousse) et ses brillants essais littéraires (Noces et L'été). Pour ce qui est des limites philosophiques soulevées plus haut, le caractère tragique de l'absurde a beau manquer dans les écrits de Camus, il définit néanmoins son destin. Le 4 janvier 1960, il y a cinquante ans, sur le retour de Lourmarin à Paris, la Facel Vega de l'écrivain, conduite par Michel Gallimard, quittait la route et tuait le Nobel sur le coup. Dans la sacoche d'Albert Camus, on retrouvait, entre autres effets personnels, le billet du train pour Paris qu'il n'avait finalement pas pris, préférant l'automobile.
La récupération de l'hommage, son détournement entrepris depuis quelques semaines est d'autant plus déplorable qu'au fond, Camus est un véritable écrivain, qui à ce titre mérite certainement le Panthéon, pour son œuvre riche, ses romans et récits, ses nouvelles parfois admirables (La pierre qui pousse) et ses brillants essais littéraires (Noces et L'été). Pour ce qui est des limites philosophiques soulevées plus haut, le caractère tragique de l'absurde a beau manquer dans les écrits de Camus, il définit néanmoins son destin. Le 4 janvier 1960, il y a cinquante ans, sur le retour de Lourmarin à Paris, la Facel Vega de l'écrivain, conduite par Michel Gallimard, quittait la route et tuait le Nobel sur le coup. Dans la sacoche d'Albert Camus, on retrouvait, entre autres effets personnels, le billet du train pour Paris qu'il n'avait finalement pas pris, préférant l'automobile.
Crédits photographiques : 1. © AFP - 2. © LGF / Le livre de poche 1961 - 3. CC-BY-SA-3.0 User:Gryffindor (Wikimedia Commons)

