Vous pourrez m’entendre, samedi 2 janvier 2010, dans l’émission littéraire « Jeux d’épreuves » qui est diffusée tous les samedis sur France Culture et présentée par Joseph Macé-Scaron. Quatre chroniqueurs se retrouvent autour de la table et viennent avec un livre. Chacun doit lire les ouvrages des petits camarades qui, cette fois, avaient pour nom : Josyanne Savigneau, Nathalie Crom et Frédéric Ferney.

J’aime beaucoup ce titre qui évoque Shakespeare et son goût pour les fantômes très souvent synonymes de mauvais présage.
S’agit-il d’un roman ? La question reste ouverte tant la lecture de ce livre en deux parties ne permet pas de répondre catégoriquement. La première s’intitule Le mannequin. On dirait une ébauche de film qui parlerait d’une mission confiée à une jeune femme. Quelle en est la nature? Difficile, là encore, de répondre. Le narrateur nous informe juste que ce travail s’achèvera dans un bar de nuit qui s’appelle l’Angle du Hasard. Faut-il s’attacher aux personnages qui jalonnent cette histoire comme le groom, un certain Karl ou encore Vaughan ? A mon sens non puisque le récit qui évoque des expériences sur des cerveaux de cobaye, des trafics d'organes échangés contre des armes prend fin avant que nous n’ayons pu nous installer.
En quelques lignes, Jean-Jacques Schuhl campe un décor noir qui n’est pas sans évoquer, je trouve, certaines lignes de Songes de Mevlido d’Antoine Volodine. On remarquera aussi dans ce très court texte une référence à un album d’Ingrid Caven, femme de l’auteur - qui est aussi le titre du roman couronné en 2000 par le prix Goncourt - : Chambre 1050, endroit où le mannequin, Marge, doit retrouver le dénommé Vaughan. Fin de la première partie du livre.
Dans la seconde partie, le « je » est de retour. On comprend que Le mannequin est un récit inachevé. Comme si le narrateur bloquait. Un narrateur qui s’interroge sur lui-même. Interrogations sur son physique où il est question d’une très hypothétique opération des hanches – ces membres inférieurs captés aux rayons X -, interrogations sur ce métier d’homme de lettres.
Ce questionnement est récurrent dans ce récit assez drôle où le narrateur parle d’une rencontre avec le cinéaste Raoul Ruiz qui lui propose de jouer le chirurgien dans Les Mains d’Orlac. Jean-Jacques Schuhl nous dit qu’il préférerait jouer Richard III, proposition qu’il fait d’ailleurs au metteur en scène Georges Lavaudant.
Peut-on réduire ce livre à une autobiographie ? Je ne le crois pas et d’ailleurs j’aime beaucoup cette zone littéraire. Je parlerais plus volontiers d’un work-in-progress, d’une création en court.
-Et alors, ce roman, ce machin comme tu dis, tu vas le finir bientôt ?
-Je ne sais pas... Je suis bloqué... incapable de ficeler une histoire, camper un personnage, faire avancer l'action, c'est décousu et obscur et j'ai aucune imagination... la fille et le garçon, j'arrive pas à les faire se rencontrer. Pour le moment, ça n'a pas de vie, on dirait le scénario inachevé d'un jeu vidéo, et la fille n'est pas plus vivante...
Une création en cours que je lis comme un immense point d’interrogation sur la création. J’aime que la zone d’étude soit celle qui précède l’acte de pure création. Ici, les hésitations, l’incertitude gouvernent. C’est ce qui donne à ce livre un côté un peu chaotique, pas fini. Comme si, finalement, le lecteur était plongé dans les coulisses.
Vous écrivez en ce moment ?
Faut toujours que j'aille en pensée voir ailleurs si j'y suis, jamais là tout à fait, j'aime être à la fois dans deux lieux, deux époques éloignées et je ne sais laquelle est la plus présente, elles se confondent, je mélange celui que j'étais hier et celui d'aujourd'hui, j'entretiens des relations nébuleuses avec le temps, l'Histoire : je n'aime que l'instant, ni dedans, ni dehors ou les deux, comme la porte-tambour, au croisement de la Via Appia antica et de la Cinquième Avenue, entre Cointreau et tequila.
J’ai lu ce livre comme une mise à nue, comme une déconstruction progressive qui appellerait à une remise en ordre sans que l’auteur ne sache quelle direction prendre.
J'avais le projet, ça me reprend parfois, d'un roman totalement synthétique, sans un mot de moi, fait de phrases trouvées ailleurs dans les livres des autres.
Plus loin :
Mes tentatives dérisoires ne dépassaient pas, là comme souvent ailleurs, le stade de l'esquisse. (...) longtemps, je ne me suis pas considéré comme un écrivain, d'abord parce que, après avoir publié deux minces livres sans substance, j'avais traversé une longue éclipse où je me contentais de prendre des notes sur un carnet.
Il y a aussi des références à ce prix Goncourt pas totalement digéré, accepté.
Presque en même temps on m'avait décerné une récompense littéraire inattendue, couronnement d'une vie nébuleuse et oisive de parasite, et mon père était mort sans que je vienne à son chevet.
Bien sûr, on peut se demander si tout cela n’est pas une posture. La posture d’un homme – il se qualifie volontiers de Juif huguenot coincé – qui, peut-être, aime son mal de vivre, surtout quand il reprend, à l’envi, cette phrase :
Je suis si romanesque.
Joue-t-il Jean-Jacques Schuhl ? Se joue-t-il de nous lorsqu’il fait référence à l’affaire Profumo et nous donne, bien plus loin, la clef de cette référence pour le moins surprenante :
L'écrivain est un clandestin, un espion, un agent secret. Éventuellement un agent double qui va dans le monde en amenant son ombre dans la lumière.
J’ai été très séduit par ce voyage passé en compagnie d’un homme qui, finalement, avance sans masque et ne se fait pas d’illusion sur lui-même :
Croiser des fantômes est un luxe réservé à de riches oisifs aux nerfs fragiles et un peu hors du monde.
Tout prend sens dans cette phrase, qui me semble être un moment-clef du livre :
Est-ce que j'entrais dans le livre ou est-ce que le personnage du livre venait à moi. A mon avis nous faisions un pas chacun l'un vers l'autre jusqu'à nous rencontrer le fantôme et moi.

Cet écrivain chilien est surtout connu pour Le vieux qui lisait des romans d'amour, en 1992, qui fut un immense succès de vente. Luis Sepúlveda écrit à un rythme soutenu. Il s'agit-là de son quatorzième livre traduit en français, aux éditions Métailié. Son avant dernier opus date de 2008 : La lampe d'Aladino et autres histoires pour vaincre l'oubli.
Sous-titre important qui montre la quasi obsession de cet homme – emprisonné et torturé durant la dictature avant de connaître l'exil – pour le travail de mémoire.
L'ombre de ce que nous avons été s'ouvre sur une dédicace :
A mes camarades, ces hommes et ces femmes qui sont tombés, se sont relevés, ont soigné leurs blessures, conservé leurs rires, sauvé la joie et continué à marcher.
Belle tonalité optimiste en apparence qui, à mon sens, contraste avec l'esprit de ce livre. De quoi s'agit-il ici ? D'un groupe de braqueurs. Ils s'apprêtent à faire un casse. Ils attendent le cerveau de la bande, un certain Pedro Nolasco González, petit-fils d'un homme qui avait déjà défrayé la chronique judiciaire dans les années 20 au Chili, mi-bandit mi-anarchiste – un Butch Cassidy et le Kid réunis (on croit d'ailleurs retrouver quelques caractéristiques du grand-père de Sepúlveda dont parlait l'auteur dans Le neveu d'Amérique) -.
Ce cerveau – celui qui est appelé le spécialiste – ne viendra jamais. Il meurt, tué par un projectile, un tourne-disque qui tombe d'un appartement. Cette chute est la conséquence d’une dispute conjugale.
Pendant ce temps-là, nos braqueurs attendent sagement – Sepúlveda les assimile un peu à ceux du film Reservoir dogs du réalisateur américain Quentin Tarentino. On en est en fait à des années lumières -. Il s'agit d'anciens opposants à la dictature. L'argent qu'ils veulent récupérer dort dans une cache depuis 1971.A cette époque-là, Salvador Allende est au pouvoir. La droite, déjà furieuse de la gestion du pays a décidé de faire sortir illégalement des devises, de priver le pays d'argent, histoire de le couler plus rapidement. Et que tout cela entraînera la chute du gouvernement tellement honni.
Voilà le cadre. Il s'agit d'un livre à mon sens d'un homme qui aimerait bien retrouver chez ses contemporains un souffle résistant – cet homme n'en est pas dépourvu –. Luis Sepúlveda montre pas mal d'ironie. Ironie à l'endroit de ces braqueurs – qui utilisent comme mots de passe des extraits de slogans politiques qu’ils ne maîtrisent plus -. Ironie quand il parle d'un homme tué par un tourne-disque – un objet symbole de la société de consommation (est-ce à dire que celle-ci a définitivement gagné contre l'idéalisme politique et militant ?) -. Ironie vis-à-vis de cette société chilienne quand il dit par exemple à propos d'un vendeur de poulet, communiste :
J'ai enfin trouvé un Chilien qui avait une opinion personnelle, et sincère par-dessus le marché.
En fait, il interroge, angoissé, la notion de mémoire. Il questionne cette société chilienne qui oublie. Celle qui n'a pas connu les années de plomb : ainsi, à propos de l'adjointe de Inspecteur Crespo, Adelita Bobadilla – toute fière d'appartenir à la première promotion de policiers aux mains propres, ceux qui en 1973 n'étaient pas encore nés ou étaient trop petits pour pratiquer la torture ou s'allier aux narcotrafiquants, -.
C'est donc un livre qui pose la question de l'engagement. Y a-t-il encore des raisons de se révolter ? Faut-il tourner la page et faire comme si de rien n'était ? Y a-t-il encore un espace possible pour le combat ?
Je trouve cette tonalité assez nouvelle. Même si il y a toujours cette volonté de résistance car comme disait l'auteur dans La folie Pinochet, paru en 2003 :
J'ai appris que « raconter c'est résister », et sur cette barricade de l'écriture, je résiste aux assauts de la médiocrité planétaire qui plane sur le XXe siècle agonisant et le XXIè qui commence à peine.
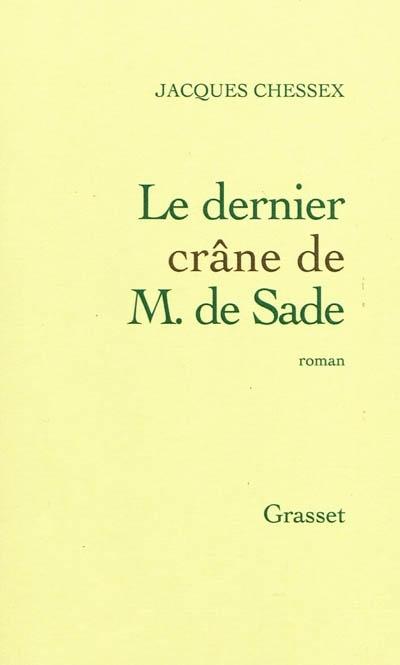
Le 9 octobre dernier disparaissait l’écrivain et peintre suisse Jacques Chessex qui obtint, entre autre, le Prix Goncourt. C’était pour L’Ogre en 1973.
Exercice difficile pour moi de juger un livre posthume d’un auteur que je n’ai jamais lu de son vivant.
Ce roman est en deux parties. La première retrace les derniers instants du divin marquis avant sa mort, le 2 décembre 1814.
A cet instant, M. de Sade n'est plus l'arrogant aristocrate de la légende, mais un vieux corps écailleux et rouge, gonflé de goutte, d'ulcères, de liquides épaissis par trop de crimes.
On croise Coulmier, l’ancien directeur de Charenton – jugé trop proche de Donatien, il sera remplacé par M. Roulhac de Maupas -, l’abbé Fleuret, la petite Madeleine Leclerc - une vraie petite salope sous ses airs d'ange transparent -
Le roman, je trouve, n’est pas qu’une énième description de l’homme en tant que phénomène de foire. Il montre un monde finissant – 1814 est l’année de l’avènement de Louis XVIII au pouvoir – où subsistent des êtres épris d’une totale liberté, dont la liberté sexuelle n’est qu’une manifestation.
L'anus bée, ourlé comme un bijou fruité, couleur de braise, de framboise des bois, un rouge rosé sur l'ombre où il voudrait inviter.
Jacques Chessex nous montre le refus quasi obsessionnel de Sade de laisser pratiquer une autopsie de son corps, d’interdire tout signe religieux sur son cercueil lorsqu’aura sonné l’heure de la mort. Il nous dit aussi l’importance pour le marquis de Sade de conserver ses écrits.
La deuxième partie, écrite peut-être par un autre narrateur, plus contemporain, montre les vicissitudes de tous ceux qui, après le Docteur Ramon en 1818, vont chercher à acquérir le crâne de Sade, devenu objet de culte, totem. Comme si détenir cet objet attirait sur soi tous les dangers.
Un livre donc sur les dangers de la possession.
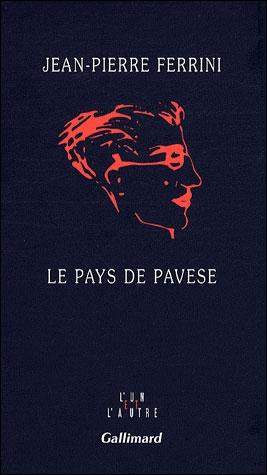
C’est un livre à propos duquel j’ai un avis partagé. Très partagé devrais-je dire.
J’ai entamé sa lecture en me disant qu’il s’agirait d’un hommage à l’œuvre d’un homme dont je connais mal les écrits. Si vous envisagez ainsi cette rencontre je pense que vous faites fausse route.
Car, comme le rappelle Frédéric Ferney dans l’émission, cette collection de Gallimard se donne pour objet de rassembler des œuvres qui dévoilent « les vies des autres telles que la mémoire des uns les invente ». Jean-Pierre Ferrini ne se pose donc pas en biographe de Cesare Pavese. Sa démarche n’est nullement factuelle. Non, elle consiste à passer par son propre filtre une vie d’un auteur qu’il aime et à nous exposer le fruit de sa réflexion sur cet écrivain majeur de la littérature italienne.
Mea culpa maxima : j’aurais dû faire preuve de davantage de rigueur et relire l’objectif que s’est fixé cette collection L’un et L’Autre. Ne l’ayant pas fait avant d’entrer dans ce livre, la déroute a été totale.
Premier exemple lorsque le narrateur nous dit travailler à Lucino, au bord du lac Majeur qui est tout sauf le pays de Pavese.
Mais surtout, j'ai ressenti un désir irrépressible de retourner à Luino, dans la chambre de l'albergo Ancora, comprenant que Pavese, c'était un pays, une Amérique, comprenant que la langue française, étrangère que j'écris, élargissant la langue régionale de Roggiano, du circolo communale, comprenant, enfin, que le seul où habiter c'était celui de Pavese, celui qu'il contenait dans son nom propre comme un nez au milieu de la figure,
Et tout se complique pour le lecteur que je suis puisque ce parti pris – les vies des autres telles que la mémoire les invente - est pleinement, évidemment, assumé et ne cessera de l’être jusqu’à la dernière page :
Entrer dans le pays de Pavese, c'est entrer dans le souvenir qu'est pour Pavese un pays, la réalité du souvenir qui ne correspond pas au souvenir de la réalité. Le décalage que Pavese crée entre le narrateur de La Lune et les Feux et lui-même dit cette différence. Il dit que ce n'est pas dans la généalogie qu'on doit chercher le pays, son origine, comme je la cherchais à Luino. Il dit que ce n'est pas dans les cimetières que nous avons une chance de retrouver le pays que nous cherchons. Il dit encore que notre pays est le pays de notre enfance. Le pays de l'infans, de ce qui ne parle pas. Le pays des images primordiales qui ont sédimenté notre mémoire déterminant ensuite toutes les autres images. L'image de l'arbre, de la maison, de la vigne, du sentier, de la colline... Le pays que nous avons en nous.
Ce décalage entre mon appréciation de lecteur et la démarche de l’écrivain ne va donc cesser de s’accentuer. Qui suis-je alors pour dire que le texte manque quand-même de gourmandise ? Mais Jean-Pierre Ferrini est-il seulement gourmand de Pavese ? Ce dernier peut-il se laisser dévorer, lui qui est parfois considéré comme un auteur monotone ?
Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je ne m’attendais pas à un « Profil d'une œuvre », insupportable de neutralité mais ce point de vue d’un auteur sur un autre auteur m’est apparu un peu excluant pour le lecteur. Jean-Pierre Ferrini m’a donné l’impression de confisquer Pavese. J’aurais peut-être préféré davantage de réflexions sur les citations de Pavese. Comme ici :
La vérité de Pavese n'existe pas. Elle n'est qu'un ensemble d'interprétations.
Cette phrase me permet tout de même de saluer l’humilité de Jean-Pierre Ferrini. Ce dernier ne vient pas nous délivrer une vérité, du haut de son savoir. Il se retrouve face à une œuvre. Il nous dit sa difficulté de l’interpréter. Il revendique son erreur de jugement possible. C’est assez rare, je trouve, pour être noté.
L'interprète a le choix. Il peut penser qu'il est anormal qu'un homme vive chez sa sœur. Il peut penser encore que Pavese voua entièrement sa vie à son travail d'écrivain, de traducteur, à son métier d'éditeur, de lecteur et de correcteur infatigable chez Einaudi et que deux mots résument cette vie : travailler et fatigue. Mon choix penche pour la seconde interprétation.
Et puis, il y a ceci :
Les livres ne se suffisent pas à eux-mêmes. Nous attendons d'eux qu'ils nous réveillent, nous tourmentent, nous mettent devant notre douleur et notre mystère, même s'ils n'épuisent ni douleur ni mystère.
J’entends bien prendre au mot Jean-Pierre Ferrini. Car ce dernier aura eu au moins un mérite : me donner envie de plonger plus profondément dans les écrits de Cesare Pavese.
Un livre qui donne envie d’autres livres… N’y a-t-il pas là de quoi se réjouir ?

