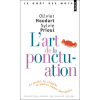Mais je vais rarement jusqu’au bout des livres que je commence : je n’atteins la dernière
page qu’une fois sur trois ou sur quatre. Parce que j’aime lire, sauf quand je n’aime pas. La lecture est un plaisir trop jouissif pour être trouvé dans la douleur.
Un des professeurs que j’ai le plus apprécié dans ma jeunesse nous recommandait chaleureusement
de ne jamais nous forcer à lire. Il nous demandait simplement de savoir parler des grands livres qu’on n’avait pas lus, en quelques idées simples et fortes, afin d’éviter de passer pour un
inculte. Il n’y avait chez lui aucun cynisme, il aimait vraiment la littérature et savait nous la faire aimer. Les livres du programme, nous les lisions quand même, mais c’était surtout pour le
plaisir d’en discuter avec lui.
Des années plus tard, j’ai retrouvé la même prescription chez J.L. Borges d’arrêter toute
lecture, si elle s’effectuait sans plaisir : « Si le livre ne vous plaît pas, c’est que vous n’êtes pas mûr pour lui ; refermez-le et retrouvez-le quelques années plus
tard » (Je cite de mémoire).
J’ai mis en pratique leurs préceptes. Je continue à éprouver le même plaisir chaque fois que je
referme un livre. Celui d’abandonner des personnages en pleine campagne, hop, ils n’existent plus ! Ils m’ennuyaient, je les ai tués. Mais le plus vif plaisir, c’est l’idée de pouvoir
commencer plus vite un autre livre.
Je sors d’une semaine bizarre : un peu trop de bonnes pioches, ça fausse les
statistiques.
J’ai commencé par
La Consolante d’Anna Gavalda (livre non choisi, mais
trouvé, car abandonné par un invité à la maison, ouf, je suis couvert !). Je me suis arrêté à la page 2. Je reconnaissais, jusqu’ici, un certain
style à Anna Gavalda, à défaut d’histoire ou d’idées fortes. Je n’ai plus reconnu le style que je lui reconnaissais. Il est devenu maniéré, elle fait l’intéressante. Je cite ici, tel quel, le
dernier paragraphe, celui où j’ai abandonné :
Alexis, lui, non. Ne se dérobait jamais. Lui tendait son cartable et mangeait son goûter de
l’autre, la vacante, en s’éloignant vers la place du Marché.
Alexis, avec son extraterrestre en talonnettes, son monstre de foire, son bouffon des
primaires, se sentaoit plus en sécurité que moi, et mieux aimé.
Croyais-je.
Je ne me voyais pas lire 637 pages du même tonneau. Au suivant !
L’Ombre en fuite, de Richard Powers.
Cela me paraissait costaud, du Powers. Élu meilleur livre étranger de l’année par Lire
avec « Le Temps où nous chantions », National Book Award avec « La Chambre aux échos », ça ne court pas les rues, des titres de gloire pareils. Il m’a quand même paru prodigieusement ennuyeux. C’était peut-être la quatrième de couv’ qui
était trop bonne. Arrêté page 38. Powers, ça vous emmène plus loin que Gavalda ? Non, ça vous fait perdre plus de temps, c’est tout. Et ses petits effets de typo, je ne sais pas qui cela
amuse. Pas moi.
Au suivant !
Ulysse, d’un certain James Joyce Je le cite pour faire rire, je me suis arrêté, toujours au même passage, celui où ils chantent. Page 19. Un
jour, je lirai Ulysse jusqu’au bout, ne serait-ce que pour en parler avec mon cousin qui est grand admirateur de Joyce. Fais gaffe, Jean-Paul, j’arrive. Mais l’année prochaine, ou plus tard, car
Borges a raison : je ne suis pas encore mûr.
Au suivant !
L’art de la ponctuation, d’Olivier Houdart et Sylvie Prioul. Un pur bonheur. Je vous l’accorde, ce n’est pas vraiment un roman. Mais qu’est-ce que ça se lit bien !
Style irréprochable, idées à toutes les pages. J’ai failli le lire en une nuit, tant j’étais accroché.
A la fin de la deuxième nuit, j’étais triste de passer au suivant.
Le degré suprême de la tendresse, d’Héléna Marienské. Héléna est une femme jeune. En tout cas plus que moi quoi ne suis d’ailleurs pas femme du tout, même par
politesse. Héléna est une femme pleine de vivacité, de drôlerie, de finesse, d’intelligence, de charme. Je le sais, elle était invitée en même temps que moi au Festival du Premier Roman, l’année
où Le Vertige des Auteurs en a été co-lauréat (n’applaudissez pas si vite, il faudrait applaudir aussi les autres : nous étions 14 meilleurs premiers romans de l’année). C’est un
livre de pastiches littéraires, mais ça ne prend pas, c’est dommage. J’ai quand même bien aimé le pastiche de Céline. Le pastiche est un art très exigeant : il doit aller à la quintessence
de l’auteur pastiché. Sinon, ce n’est que du Guignol de l’Info. Il y a certains auteurs que je n’ai jamais lu, mais dont je parle bien, car j’ai lu
d’excellents pastiches de leur oeuvre (notamment dans À la manière d’eux). Un jour, j’écrirai un billet là-dessus. Des promesses, des promesses.
Au suivant !
Le chanteur de tango, de Tomás Eloy Martínez. J’ai commencé avec prudence, car j’avais tenté de le lire en espagnol, il y a un an – c’était un cadeau de
quelqu’un qui m’avait surestimé, donc un double cadeau, merci Mariana ! Formidable livre, confus à souhait, mêlant deux intrigues à dormir
debout, celle d’un universitaire américain qui tente de retrouver un insaisissable, et vieux, et fabuleux, mais surtout insaisissable, chanteur de tango qu’il pourchasse dans Buenos Aires. Et il
est aussi mêlé à un canular où l’on crée de toutes pièces une maison où les touristes sont invités à chercher l’Aleph (oui, celui de Borges). Le tout sur fond d’agonie du régime militaire – mais
en Argentine, tous les régimes sont vite à l’agonie. Mon seul regret c’est de ne pas avoir eu un plan de Buenos Aires dans le livre : je l’avais, mais dans mon bureau. La nuit, se lever pour
aller chercher un plan de Buenos Aires, c’est une vraie expédition. Je dis ça parce que le vrai héros du livre, c’est Buenos Aires. Je connais assez bien la ville, mais pas toutes les rues.
Achetez d’abord le plan de Buenos Aires avant de lire le livre, ce n’est pas du gaspillage : vous irez certainement à Buenos Aires après l’avoir lu. Ou vous en parlerez sans y être
allé.
Au suivant ! il fallait bien.
Contrebande, d’Enrique Serpa. J’ai arrêté à la page 47. C’est pourtant très bien, mais j’étais encore dans le livre précédent : deux
auteurs latino-américains en suivant, ça crée des interférences. Je le reprendrai quand j’aurai choisi.
Ah, et Mythologies d’hiver, de Pierre Michon. J’allais l’oublier ! Je vous en reparlerai un autre jour, ce billet est déjà bien trop long.
Avant
de m’en aller, je tiens à rendre hommage au visiteur qui est arrivé avec la requête : « Comment débuter le début d’un roman ». Il avance à
petits pas prudents dans l’écriture. Il va revenir, je le sens. Je prépare pour lui un billet « Comment finir finalement la fin d’un
roman ».