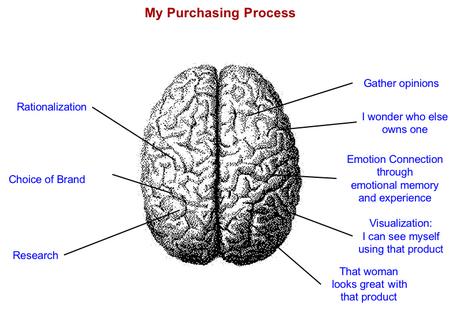 Il devrait y avoir une science qui étudie le blurb, cette petite merveille de concision à travers laquelle des auteurs chantent les louanges d'autres auteurs afin de les aider à vendre du papier. L'étude en profondeur attendra, laissez-moi juste vous parlez des cinq finalistes du National Book Award 2009. Si on voulait être méchant, on avancerait que la sélection a été faite pour des raisons extra-littéraires : un Pakistanais qui possède un passeport américain, un Irlandais qui possède un passeport américain, un Américain qui vit au Royaume-Uni et deux femmes. Superbe représentation de la diversité et du cosmopolitisme de la littérature et de la société américaine, très multiculturelle. Tout ça n'est que façade : si on regarde les blurbs, on se rend compte que loin d'être une célébration de la différence, tout ça n'est que cases, cases, cases. Le plus bel exemple, c'est Daniyal Mueenuddin : cinq des six blurbs ont été rédigés par des Pakistanais ou des Indiens, le sixième par un Ecossais qui mentionne, en guise de comparaison, deux auteurs indiens. Le message, sans doute inconscient, est clair : il y a de la bonne fiction écrite dans cette région, mais seuls les locaux sont capables d'en rendre compte. Le multiculturel est renvoyé à la case ghetto. Pire : les auteurs du sous-continent indien sont les seuls capables de parler du livre d'un des « leurs », mais ils sont incapables de parler du livre de quelqu'un d'ailleurs : sur les quatre autres livres de la shortlist, ils sont complètement absents. Le livre de Bonnie Jo Campbell, lui, est de toute évidence écrit par une femme : les prénoms des auteurs de trois des quatre blurbs sont Carolyn, Rachael et Laura… Même un auteur aussi connu que Colum McCann échappe à peine moins cette règle : il est de nationalité irlandaise, tout comme quatre des neuf blurbers. Plus mesurée, Jayne Anne Philips n'a que trois petites notes, et elles sont variées (on y retouve d'ailleurs Junot Diaz qui dit qu'il s'agit du meilleur livre qu'il a lu cette année – Diaz est membre du jury du NBA... Pour Marcel Theroux, c'est encore plus simple : un seul blurb.
Il devrait y avoir une science qui étudie le blurb, cette petite merveille de concision à travers laquelle des auteurs chantent les louanges d'autres auteurs afin de les aider à vendre du papier. L'étude en profondeur attendra, laissez-moi juste vous parlez des cinq finalistes du National Book Award 2009. Si on voulait être méchant, on avancerait que la sélection a été faite pour des raisons extra-littéraires : un Pakistanais qui possède un passeport américain, un Irlandais qui possède un passeport américain, un Américain qui vit au Royaume-Uni et deux femmes. Superbe représentation de la diversité et du cosmopolitisme de la littérature et de la société américaine, très multiculturelle. Tout ça n'est que façade : si on regarde les blurbs, on se rend compte que loin d'être une célébration de la différence, tout ça n'est que cases, cases, cases. Le plus bel exemple, c'est Daniyal Mueenuddin : cinq des six blurbs ont été rédigés par des Pakistanais ou des Indiens, le sixième par un Ecossais qui mentionne, en guise de comparaison, deux auteurs indiens. Le message, sans doute inconscient, est clair : il y a de la bonne fiction écrite dans cette région, mais seuls les locaux sont capables d'en rendre compte. Le multiculturel est renvoyé à la case ghetto. Pire : les auteurs du sous-continent indien sont les seuls capables de parler du livre d'un des « leurs », mais ils sont incapables de parler du livre de quelqu'un d'ailleurs : sur les quatre autres livres de la shortlist, ils sont complètement absents. Le livre de Bonnie Jo Campbell, lui, est de toute évidence écrit par une femme : les prénoms des auteurs de trois des quatre blurbs sont Carolyn, Rachael et Laura… Même un auteur aussi connu que Colum McCann échappe à peine moins cette règle : il est de nationalité irlandaise, tout comme quatre des neuf blurbers. Plus mesurée, Jayne Anne Philips n'a que trois petites notes, et elles sont variées (on y retouve d'ailleurs Junot Diaz qui dit qu'il s'agit du meilleur livre qu'il a lu cette année – Diaz est membre du jury du NBA... Pour Marcel Theroux, c'est encore plus simple : un seul blurb.
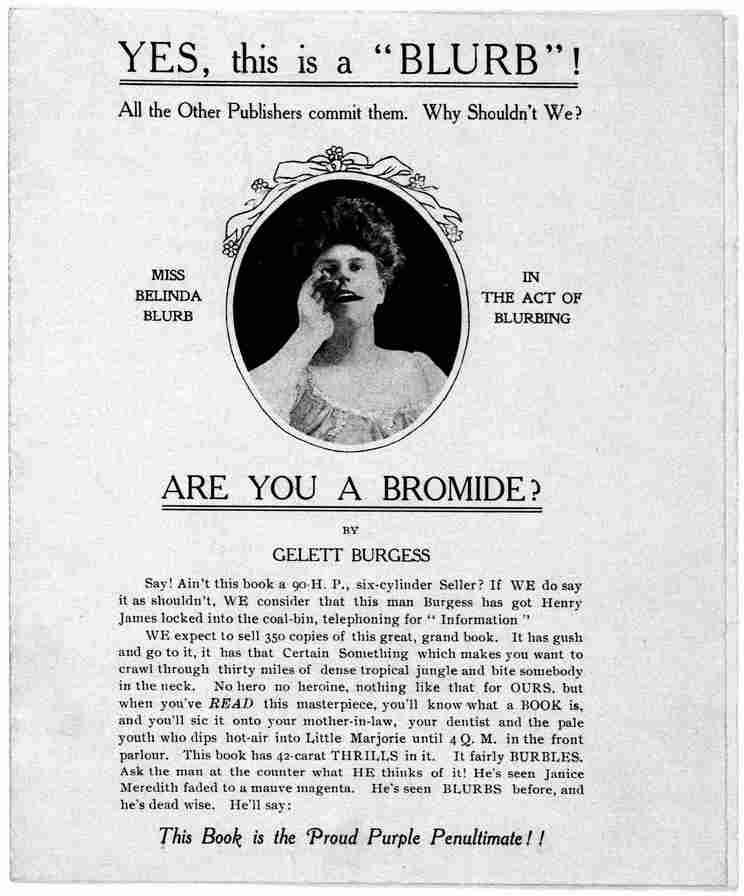 Transfuge s'interroge ce mois-ci sur la littérature américaine. La fin de l'âge d'or ?, se demandent-ils… Inutile de revenir sur l'absurdité de la question, surtout de la part d'un média qui dépend en large mesure de traductions pour établir son jugement et que, dans ce domaine, il reste un paquet de machins formidables à publier. Toujours est-il que, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à tomber sur des romans qui valent la peine. Comme si à la génération de Powers, Vollmann ou Johnson (tous lauréats récents du National Book Awards), rien n'avait vraiment succédé. C'est idiot : il y a de bons écrivains apparus au cours des dix dernières années : on pense immédiatement à Lydia Millet, Chris Adrian ou Brian Evenson, pour n'en citer que trois.
Il n'y a pas d'âge d'or, il n'y aura pas de fin de l'âge d'or. Par contre, il y a une certaine tendance (comme partout, dira-t-on) à la pacotille. Les blurbs démontrent le multiculturalisme de pacotille qui dissimule un renforcement du ghetto. Les ateliers de Creative writing produisent à la tonne des écrivains de pacotille capables d'utiliser toutes les ficelles narratives mais incapables de leur donner un sens (Larsen, Unferth, Galchen, Ferris, la liste de ces infâmes écrivains présentés comme des merveilles est longue comme un jour sans pain). On s'agenouille devant l'autel de la sentimentalité de pacotille (une large partie de l'école McSweeney's) qui anesthésie le lecteur pour ne pas lui laisser voir que l'empereur est nu, nu, nu. On nous vend des romans polyphoniques dont le cortège de personnages parvient à peine à cacher que l'auteur, le seul qui compte, est aphone. On écrit des romans où le point de vue est multiple mais où on ne voit rien. Le meilleur roman américain que j'ai lu cette année a été écrit par un Espagnol. Tout est dit.
A mon grand, grand regret, les finalistes du National Book Award 2009 illustrent parfaitement ce mal. Qu'est-ce que Lydia Millet, membre du jury, est venue foutre dans cette galère ? J'ai lu, j'ai donc perdu mon temps à lire les cinq livres concernés. Et je vous jure que ma rancœur n'est pas motivée par la perte nette que ça suppose sur mon compte en banque.
Colum McCann – Let the great world spin
Transfuge s'interroge ce mois-ci sur la littérature américaine. La fin de l'âge d'or ?, se demandent-ils… Inutile de revenir sur l'absurdité de la question, surtout de la part d'un média qui dépend en large mesure de traductions pour établir son jugement et que, dans ce domaine, il reste un paquet de machins formidables à publier. Toujours est-il que, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à tomber sur des romans qui valent la peine. Comme si à la génération de Powers, Vollmann ou Johnson (tous lauréats récents du National Book Awards), rien n'avait vraiment succédé. C'est idiot : il y a de bons écrivains apparus au cours des dix dernières années : on pense immédiatement à Lydia Millet, Chris Adrian ou Brian Evenson, pour n'en citer que trois.
Il n'y a pas d'âge d'or, il n'y aura pas de fin de l'âge d'or. Par contre, il y a une certaine tendance (comme partout, dira-t-on) à la pacotille. Les blurbs démontrent le multiculturalisme de pacotille qui dissimule un renforcement du ghetto. Les ateliers de Creative writing produisent à la tonne des écrivains de pacotille capables d'utiliser toutes les ficelles narratives mais incapables de leur donner un sens (Larsen, Unferth, Galchen, Ferris, la liste de ces infâmes écrivains présentés comme des merveilles est longue comme un jour sans pain). On s'agenouille devant l'autel de la sentimentalité de pacotille (une large partie de l'école McSweeney's) qui anesthésie le lecteur pour ne pas lui laisser voir que l'empereur est nu, nu, nu. On nous vend des romans polyphoniques dont le cortège de personnages parvient à peine à cacher que l'auteur, le seul qui compte, est aphone. On écrit des romans où le point de vue est multiple mais où on ne voit rien. Le meilleur roman américain que j'ai lu cette année a été écrit par un Espagnol. Tout est dit.
A mon grand, grand regret, les finalistes du National Book Award 2009 illustrent parfaitement ce mal. Qu'est-ce que Lydia Millet, membre du jury, est venue foutre dans cette galère ? J'ai lu, j'ai donc perdu mon temps à lire les cinq livres concernés. Et je vous jure que ma rancœur n'est pas motivée par la perte nette que ça suppose sur mon compte en banque.
Colum McCann – Let the great world spinVous pouvez le lire en français (Et que le vaste monde poursuive sa course folle, titre hilarant de grandiloquence, Belfond 2009) mais ce serait perdre 22€. En temps de crise, ce serait regrettable. McCann présente à travers les portraits croisés d'une série de personnes culturellement diversifiées un tableau de New York de 1974 à presque nos jours, où les traces d'un discours sur le New York d'aujourd'hui abondent. C'est le proverbial roman choral qui pue l'artifice à vingt mètres malgré la volonté de vraisemblance, qui s'avère une pure mascarade. Tout est forcé, jusque dans la recherche du petit détail poétique ou psychologique soi-disant bien vu, tout simplement pathétique. McCann étale sa recherche documentaire, et il a bien raison : c'est la seule façon de faire croire qu'il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Daniyal Mueenudin – In other rooms, other wonders
Recueil de nouvelles interconnectées – il y a un homme qui lie entre eux tous les personnages. Autre version donc de la tactique chorale. L'ambition est ici de présenter l'ensemble de la société pakistanaise, du paysan au gosse de riche, en passant par le serviteur et l'industriel. Il faut admettre que Mueenudin fait montre d'une certaine qualité d'écriture et de composition dans une veine toute traditionnelle et qu'il parvient à montrer la variété sociale de son pays. On regrettera alors que cette variété ne ressort pas dans sa façon de narrer, ni d'ailleurs dans son ton : à des degrés divers, toutes les nouvelles finissent mal. Le Pakistan serait donc un pays perdu. On peut aussi déplorer l'impression qu'on a à la lecture que tout ici correspond au regard cliché de l'occidental éclairé (certains diront : heureusement qu'il ne s'agit pas de la vision du stratège US, mais nous ne nous contentons pas de si peu). Jayne Anne Phillips – Lark & Termite
Vous pouvez aussi le lire en français (chez Bourgois). Il s'agit sans doute du livre le mieux écrit et le mieux construit du lot. Moins connu par ici que McCann, c'est le deuxième poids-lourd de la liste (pas pour rien qu'elle est blurbée par trois véritables « stars » littéraires : Tim O'Brien, Alice Munro et Junot Diaz). C'est l'histoire de deux enfants (Termite, un gamin qui se déplace en chaise roulante et ne sait pas parler ; Lark, une jeune fille qui veut à la fois découvrir le monde et la vie de sa mère) qui vivent avec leur tante. La narration mélange quotidien (sur quatre jours) de cette étrange famille, retour sur la jeunesse de la tante et de la mère et (les meilleurs chapitres) les dernières heures du père de Termite, porté disparu lors de la guerre de Corée. Les pages coréennes sont de loin les meilleures, les plus vivaces, les plus fortes, les mieux composées. La part belle est pourtant laissée au duo Lark et Termite. Frappant, mais il n'a malheureusement pas eu sur moi l'impact qu'il aura eu sur d'autres lecteurs plus illustres (Diaz : « astounding feat of the imagination », O'Brien : « the best new novel I've read in the last five years »). Même sans être vraiment convaincu, il doit s'agir du favori. Marcel Theroux – Far North
Marcel n'est pas Alexander. Malheureusement. Son petit récit post-apocalyptique a son charme et c'est sans doute de toute la sélection le livre qui se lit avec le plus de plaisir (malheureusement, il s'agit du plaisir de qui veut passer le temps entre deux séries TV à ne pas manquer : la lecture bouche-trou, ça s'appelle). Theroux peut être salué pour certaines idées et options (son personnage principal est une femme), mais c'est un lâche : il n'a jamais le courage d'explorer les possibilités offertes par ces choix. Son roman est donc condamné à se convertir en une occasion manquée, un potentiel non exploré. Divertissant, Far North se lit bien. Mais ce n'est qu'un bouche-trou. Un bouche-trou. Et si un bouche-trou est le livre le plus satisfaisant des finalistes, tout est dit (bis). Bonnie Jo Campbell – American Salvage
Quand je suis arrivé à ce livre là, je me suis accroché à l'espoir que ce serait peut-être la petite merveille surprise, la wild card de la sélection, celle qui arrive jusqu'au bout alors qu'on ne l'attendait pas. American Salvage est un recueil de nouvelles parfaitement maîtrisées qui mettent en scène la vie d'une Amérique profonde qu'on connait, hormis les clichés, très, très mal en Europe. Ces histoires sont humaines, vivantes et composent un portrait qui, comme celui de Mueenudin, a tendance à être négatif, mais qui, cette fois-ci, a le grand mérite de ne pas laisser un arrière-goût moraliste. On ne sent pas, derrière ces récits, une volonté de dire autre chose que ce qui s'y déroule et d'orienter une lecture qui se voudrait engagée. C'est, au final, le seul livre auquel je n'aie rien à reprocher. Pour autant, ce n'est pas un grand moment de littérature. C'est intelligent et bien foutu et, cette année, c'est de ça qu'il faudra se contenter. Tout est donc dit (ter).
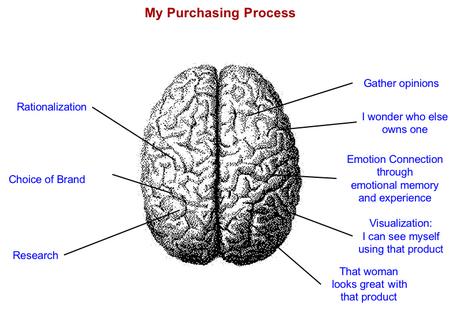 La littérature américaine n'est pas morte. Il n'y a jamais eu d'âge d'or. Mais Dieu qu'on aimerait trouver des nouvelles voix dont l'impact est autre que pur marketing. Le lauréat du National Book Award 2009 sera annoncé mercredi.
La littérature américaine n'est pas morte. Il n'y a jamais eu d'âge d'or. Mais Dieu qu'on aimerait trouver des nouvelles voix dont l'impact est autre que pur marketing. Le lauréat du National Book Award 2009 sera annoncé mercredi.
