 Photographie © Simon Chauvin
Photographie © Simon Chauvin Mais retenu du côté des sordides ancêtres,
Ignorant l'art du feu, dans la caverne il était seul
À savoir qu'il devait mourir de la même mort
que les mots, les astres et les monstres.
Jacques Réda
Le terrain est partiellement déminé ; nous pouvons désormais passer aux choses sérieuses. Rappelons les présupposés qui sont les nôtres : la science-fiction, comme le suggère Serge Lehman, accorde une place primordiale à la métaphysique. Le cycle de la Culture de Iain M. Banks, dont l'acuité dans les domaines conjugués de l'astrophysique et de la biologie n'est plus à démontrer, ne fait pas exception à cette règle ; et de nombreux exemples d'ouvrages classés sans contestation possible au rayon SF des librairies[1] pourraient également apporter de l'eau à ce moulin plus ancien qu'il n'en a l'air[2], en montrant a posteriori que l'approche spéculative n'est nullement incompatible avec le questionnement métaphysique.
Pour clarifier cette perspective, l'apport de la théorie littéraire, au sens universitaire du terme, pourrait bien ne pas être aussi inutile que l'on voudrait parfois s'en persuader, notamment lorsqu'il s'agit de cerner les enjeux liés au concept de fiction. Le dédain régulièrement affiché par la critique de tradition universitaire à l'égard de la science-fiction – et que cette dernière lui rend allègrement, dans ce qu’il faut bien appeler un formidable dialogue de sourds – peut d'ailleurs s'expliquer par le même contresens que semble commettre une partie du microcosme SF : structurellement, la SF ne saurait être investie d'aucune mission d'utilité publique, car elle s’inscrit dans un rapport au monde qui la rend objectivement inopérante, et qui appartient en propre à la fiction.
Notre hypothèse est donc la suivante : si une partie de la SF, apparemment en voie de disparition ou de refondation, se trouve en porte-à-faux avec le monde actuel, c’est d’abord parce qu’elle cherche à le prendre directement pour objet, à la manière du discours scientifique.
Définir la SF comme un outil idéologique ayant pour vocation de sensibiliser l’opinion à une thèse revient en premier lieu à réduire considérablement son intérêt sur le plan philosophique : il s’agirait moins pour l’écrivain de créer un monde qui réponde au réel en s’y substituant que de mettre au point un simple vecteur d’opinion, un complément aux travaux des journalistes et essayistes politiques, qui tirerait son efficacité de son aptitude à emporter, par un usage sophistique de la narration, l’assentiment du lecteur. Le sens du récit se réduirait alors au strict minimum : plutôt que de donner corps à une représentation singulière du réel, il constituerait le relais d’une doxa ; un texte plus journalistique que littéraire, en somme.
Cette ligne de partage entre littérature et journalisme peut intervenir au sein d’une même oeuvre, comme en témoignent les deux derniers romans d’Antoine Bello. Les Falsificateurs, premier volet du diptyque, relate l’intégration d’un jeune Islandais, Sliv Dartunghuver, dans une organisation occulte qui vise à influer sur la marche du monde par la falsification de la réalité. Ce fantasme d’une franc-maçonnerie à l’échelle mondiale, fondée à la gloire de ce que Bello appelle « l’esprit humain », répond à mesure qu’on la découvre à une interrogation qui outrepasse largement le cadre politique : le réel, dépourvu de Dieu, est-il tout à fait contingent ? Se pourrait-il qu’existe, en amont du réel accessible aux peuples, une cohérence proprement humaine qui transcende les frontières géopolitiques et culturelles ? Le Consortium de Falsification du Réel, sous la houlette de son Comité Exécutif dirigé par le Camerounais Angoua Djibo, incarne ainsi à la fois la salvatrice « main invisible » imaginée par l’économiste Adam Smith pour assurer la régulation du capitalisme, et une sorte de « dessein intelligent » qui s’efforcerait, en se substituant à l’Absolu hégélien, de fournir un sens et une finalité à l’Histoire. Les Falsificateurs fait ainsi appel à une forme de vertige logique proche de celle que la SF met en oeuvre, en manipulant la matière factuelle de l’Histoire pour en questionner l’objectivité, à tel point que la démarche de Bello s’approche par endroits de celle d’Edward Whittemore, pour qui l’Histoire fait également l’objet d’un tri préalable en fonction des préoccupations des hommes. Le rôle du CFR ne se limite pas à la falsification des faits ; il vise principalement à faire concorder l’Histoire, dont la matière est contingente, avec une vérité à visage humain.
Mais la dimension méta-historique du récit se trouve malheureusement occultée, dans le second tome intitulé Les Éclaireurs, par un message d’ordre politique : rien ne justifie l’invasion de l’Irak par les États-Unis. Au moyen d’un glissement presque imperceptible au départ, la falsification, conçue dans le premier tome comme un ressort narratif ouvrant une réflexion sur le sens de l’Histoire, devient l’outil principal d’un réquisitoire en règle contre l’administration Bush. S’ensuivent des dizaines de pages subitement ennuyeuses au cours desquelles l’auteur tâche visiblement de persuader son lecteur que la Maison Blanche s’est sciemment appuyée sur de fausses preuves pour accabler l’Irak de Saddam Hussein, mélangeant allègrement au passage réalité et fiction, vérité objective et opinion, roman et reportage. L’oeuvre d’Antoine Bello perd ainsi subitement sa portée universelle, et se voit ravalée au rang de ces reportages orientés qui font sensation, se vendent à merveille pendant quelques mois, et qu’on oublie aussi rapidement qu’ils ont été ficelés. « Je n’aime pas avoir raison », a dit quelque part Pierre Michon ; et puisque Michon est aujourd’hui la littérature en personne comme Hugo fut « le vers personnellement », nous pouvons sans hésiter compléter la formule : la littérature n’aime pas avoir raison.
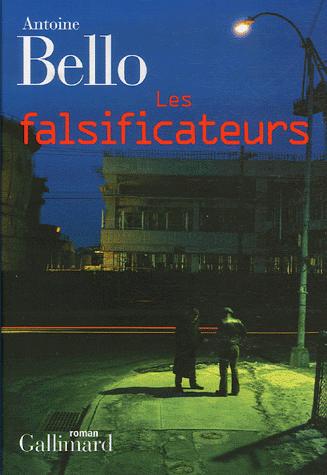
Définir la SF comme l’instrument d’une idéologie donnée (le transhumanisme, par exemple) ne revient pas uniquement à en réduire la portée philosophique ; une telle définition l’exclut systématiquement du champ de la littérature, dont la finalité n’est assurément pas de transmettre un savoir positif ; le texte littéraire constitue un espace en marge du réel, au sein duquel les lois de la fiction se substituent à celles de la physique. La métaphore n’élucide pas directement le monde ; en s’y rapportant, elle en joue et lui fait concurrence. Le temps du récit recouvre le temps réel et, dans la mesure où la fiction repose sur le patient tissage de ce voile appelé à occulter le monde, à en épouser intimement le relief, elle ne saurait le modifier, fût-elle tributaire des sciences par sa trame.
Comme l’a fait remarquer Searle, d’un point de vue objectif, toute oeuvre de fiction repose sur une « feintise » : l’auteur fait comme s’il produisait un discours sérieux, un authentique acte de langage, et nous acceptons de nous prêter à ce jeu innocent, le temps de la lecture. Si la vérité était uniquement de nature objective, la fiction se limiterait en effet à l’exercice puéril de simulation décrit par Searle dans Sens et expression (« Le statut logique du discours de la fiction ») : quand nous produisons un discours fictionnel, nous sommes dans la situation de l’enfant qui, assis à la place du conducteur, manipule toutes les commandes de la voiture pour faire mine de piloter un véhicule en marche. Searle, il est vrai, a nuancé par la suite cette théorie quelque peu lapidaire, notamment grâce à l’opposition de Derrida[3] ; mais au fondement de cette approche de la fiction comprise comme un cas particulier au sein de la théorie des actes de langage, subsiste le présupposé selon lequel l’ensemble de ces actes langagiers est régi par les seules « conventions du langage ordinaire », elles-mêmes nécessairement liées à la vérité objective.
Car précisément, le lecteur ne peut considérer son rapport au récit comme une « feintise » qu’en objectivant la fiction, en considérant les éléments qui la peuplent comme des phénomènes falsifiés, alors qu’ils exigent d’être appréhendés dans leur surgissement même. Le sérieux de la fiction ne peut se concevoir au moyen de la démarche objectivante que nous adoptons à juste titre face à un objet ordinaire, puisque l’objet fictionnel n’en est précisément pas un : la vérité de la fiction repose non dans le phénomène, mais dans sa phénoménalité, son apparition. Il s’agit d’une vérité en perpétuel mouvement, plus exactement d’une vérité vivante qui se manifeste sur le mode de la révélation plutôt que sur celui de l’être.
Le sens, en littérature comme en musique, est indissociable de l’émotion liée à son surgissement : c’est en tout cas ce qu’enseigne la rhétorique, qui ne constitue ni une science de l’affect verbal, ni un catalogue de tours de passe-passe logiques, mais considère ces deux domaines comme indissociables. La fiction n’est régie qu’en apparence par les conventions du langage ordinaire ; elle se définit au contraire par les distorsions qu’elle impose à la langue commune, et qui lui permettent de s’en démarquer. La langue littéraire s’inscrit en surcroît par rapport à la la langue usuelle, dans la mesure où elle ne se résume pas à la désignation d’un objet existant, mais s’efforce d’atteindre le point d’incandescence qui lui permettra de le faire apparaître sous les yeux du lecteur, non plus en tant qu’objet, mais dans sa manifestation subjective.
Pierre Michon, encore lui, reprend à son compte, dans divers entretiens le sarcasme de Paul Nizan à l’égard des auteurs qui souhaitent « porter l’objet littéraire à la température d’un dieu ». C’est bien de cela qu’il s’agit : en se substituant au réel, la fiction révèle ce qui l’excède. En excédant le monde, et la langue usuelle qui en est le signe, pour incarner une vérité humaine, elle s’impose par l’évidence universelle de son surgissement.
Toute fiction a donc nécessairement maille à partir avec la transcendance comprise comme ce qui outrepasse la pure matérialité du monde. Ce dernier, objet de l’investigation scientifique, est le lieu du vivant biologique, conçu comme un mécanisme cyclique et indifférencié ; au sein de la fiction, en revanche, s’épanouit le temps humain, le temps individuel, sur le mode de l’apparition et de la disparition. L’oeuvre de fiction glorifie le singulier au détriment de la vérité objective ; n’est-ce pas pour cette raison que la difficulté que nous éprouvons à classer les récits semble proportionnelle à leur réussite ? Les véritables chefs-d’oeuvre ont sans doute tous été conçus pour faire voler en éclats un genre, un mouvement ou un académisme.
De toute évidence, la science-fiction ne fait pas exception à cette logique fictionnelle du surcroît ou, pour faire à nouveau référence à l’oeuvre de Iain M. Banks, de l’excession. Le terme de « science-fiction » constitue à lui seul un bel oxymore, propice à l’incandescence narrative : en tant que fiction, la SF excède nécessairement le cadre objectif de la science, puisque la vérité qu’elle met en oeuvre est éminemment subjective ou, au mieux, feinte. Elle ne l’annihile pas pour autant, mais se situe précisément à la croisée des chemins, entre la connaissance positive qui forme sa matière brute, et cette vérité méta-physique qui l’accompagne et la transcende.
Revenons à notre point de départ : Serge Lehman suggère la pertinence d’une lecture métaphysique de la science-fiction. Ce projet semble d’autant plus viable à nos yeux qu’il aborde la SF à rebrousse-poil, en mettant en évidence le paradoxe qui l’anime, puisqu’elle se réclame à la fois de la fiction et de la science, sans que l’un puisse jamais tout à fait éclipser l’autre. L’hypothèse de Lehman a également le mérite de prendre la SF pour ce qu’elle est : une branche de la littérature, et non de la science. Si un réel travail théorique est mis en oeuvre, citer Thomas Pynchon ou Antoine Volodine dans un texte sur la science-fiction pourrait bientôt ne plus paraître si incongru ; et les ponts que certains ont toujours tenté de bâtir entre les genres et les oeuvres pourraient enfin être appréciés à leur juste valeur, y compris au sein du milieu de la science-fiction française.
[1] Je pense à Hypérion de Dan Simmons, ou encore à Dune, unanimement considéré comme une œuvre fondatrice du genre sous sa forme actuelle : la dimension métaphysique de ces deux romans a déjà été évoquée maintes fois, et mériterait à coup sûr d'être approfondie.
[2] Pierre Jouan a précisément fait remarquer, dans un compte-rendu des Utopiales publié sur Chronicart, ce « paradoxe » qui veut que les tenants du renouvellement de la SF (les « Modernes ») s'appuient sur une tradition très ancienne.
[3] Profitons-en pour signaler un ouvrage récemment publié par Raoul Moati au sujet de cette passionnante controverse : Derrida / Searle, déconstruction et langage ordinaire, collection « Philosophies », P.U.F., 2009. « Rassemblant toutes les pistes ouvertes par la controverse Derrida/Searle, Raoul Moati propose comme point d’aboutissement de questionner la déconstruction, et peut-être au-delà de celle-ci la phénoménologie dont elle repart, sur le concept d’intentionnalité qu’elle mobilise, en demandant si une telle intentionnalité procède de la présence métaphysique comme le pense Derrida, ou des conventions du langage ordinaire comme le pense Searle. » (source : http://ceppa.univ-paris1.fr/spip.php?article227)
