 Dans son livre Communisme et totalitarisme, dont j'ai fait hier une recension (voir mon article "Communisme et totalitarisme" de Stéphane Courtois ), Stéphane
Courtois écrit à propos du système communiste :
Dans son livre Communisme et totalitarisme, dont j'ai fait hier une recension (voir mon article "Communisme et totalitarisme" de Stéphane Courtois ), Stéphane
Courtois écrit à propos du système communiste :
"Après plus de soixante-dix ans d'expérimentation dans une quinzaine de pays, ce système a démontré par son implosion même, son incapacité à créer un nouveau modèle
de gouvernement, d'économie et de société."
Il ajoute aussitôt :
"Voici le grand paradoxe : au cours d'une Guerre froide qui aura duré des décennies, le communisme a été défait en rase campagne par le capitalisme et la démocratie.
Mais cette vérité de première importance, il est interdit de l'exprimer, sous peine de passer pour un butor, voire pour un "anticommuniste"."
Il est toujours interdit de dire que le capitalisme et la démocratie ont défait le communisme. Pour ma part peu me chaut de passer pour un anticommuniste, je suis
anticommuniste, très clairement.
Comme je l'ai mis en exergue sur ce blog:
"Il n'est pas possible d'être un homme (ou une femme) digne de ce nom sans l'exercice de libertés"
C'est volontairement que j'ai mis libertés, au pluriel, parce que je suis homme de terrain, et non pas de constructions intellectuelles. Si j'ai mis la statue de la
Liberté comme illustration de cet article, ce n'est donc pas parce que je crois à la Liberté des hommes avec un grand L, mais parce que cette statue, bien
humaine, et féminine, là où elle se trouve, à Paris, et à New York, est devenue - qu'on le veuille ou non - le symbole des libertés individuelles.
Or le communisme était un système, une construction intellectuelle, qui déniait la réalité, qui voulait faire le bonheur des gens - ce qui est louable - bon gré mal gré - ce qui l'est moins
-, sans leur assentiment, au besoin en supprimant physiquement et moralement les récalcitrants, qu'il qualifiait d'ennemis - ce qui est monstrueux. Comme, pseudo-scientifique, il
prétendait avoir raison contre toutes les autres pensées, le communisme ne pouvait pas souffrir de contestation sans se mettre en danger, et c'est, à partir du moment où
certains membres de ce sytème ont admis que le communisme pouvait ne pas représenter le Bien avec une majuscule, et qu'il pouvait échouer, qu'il s'est petit à petit
effondré.
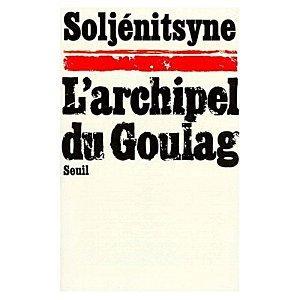 La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, il y a
tout juste 20 ans, n'a été qu'une étape spectaculaire de cet effondrement, comme avaient été des étapes le rapport secret de Khrouchtchev en 1956, le soulèvement de
Budapest en 1956, l'écrasement du printemps de Prague en 1968, la publication de L'Archipel du Goulag de Soljénitsysne
en 1973, l'élection d'un pape polonais en 1978, l'émergence de Solidarnosc en Pologne en 1980, l'élection de Ronald Reagan en 1981, le retrait
des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989, avant que la chute de la maison-mère moscovite ne parachève l'implosion de l'édifice en 1991.
La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, il y a
tout juste 20 ans, n'a été qu'une étape spectaculaire de cet effondrement, comme avaient été des étapes le rapport secret de Khrouchtchev en 1956, le soulèvement de
Budapest en 1956, l'écrasement du printemps de Prague en 1968, la publication de L'Archipel du Goulag de Soljénitsysne
en 1973, l'élection d'un pape polonais en 1978, l'émergence de Solidarnosc en Pologne en 1980, l'élection de Ronald Reagan en 1981, le retrait
des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989, avant que la chute de la maison-mère moscovite ne parachève l'implosion de l'édifice en 1991.
Le capitalisme, imparfait, comme la démocratie, imparfaite, ont eu raison de ce système parce que les hommes ont besoin de libertés individuelles pour s'accomplir et que les
deux cadres des activités humaines, que sont l'économie et la politique, ne peuvent bien fonctionner que grâce aux libertés individuelles qu'y peuvent exercer leurs
acteurs. Le marché étant d'ailleurs la forme de démocratie la plus accomplie puisqu'il permet aux intervenants de voter au moment de chaque échange, sans attendre des échéances électorales
espacées dans le temps.
En effet quand on parle de capitalisme, on entend aujourd'hui le marché. Le capitalisme peut revêtir pourtant de multiples formes. Il peut même être d'Etat. Ce qui était le
cas dans les pays communistes où l'Etat, aux mains d'un parti unique, avait le monopole de la production et de la distribution. L'échec du communisme dans le domaine économique,
comme dans tous les domaines d'ailleurs, est dû au fait que l'homme est ainsi fait qu'il a besoin d'être motivé, c'est-à-dire d'être récompensé de ses efforts, selon ses mérites, et que cela ne
peut exister qu'individuellement.
L'homme produit moins de richesse - et moins bien - quand il n'est pas libre de disposer de ce qu'il produit. Or il ne peut être libre de ce qu'il produit que s'il en est
le propriétaire, comme il ne peut créer librement que s'il est propriétaire de sa pensée et de ses mouvements. Il est significatif que les pays libres attirent les étrangers et que les
pays, où les peuples sont asservis, sont ceux où ces derniers ne demandent qu'une chose, de pouvoir s'en évader. Des Allemands de l'Est fuyaient leur pays depuis
l'érection du mur de Berlin comme avaient fui des Russes dans les années 1920 ou fuiraient des Vietnamiens, devenus "boat
people", après la chute de Saïgon en 1975.
Dans ces conditions il est d'autant plus malheureux que des hommes (et des femmes) n'aient toujours pas compris que les libertés individuelles, qui vont de pair avec le droit de
propriété au sens large et les responsabilités, sont des biens on ne peut plus précieux et qu'il faut défendre bec et ongles, parce que non seulement elles rendent
les hommes dignes, mais également leur permet d'améliorer leur sort matériel, spirituel et moral.
Dans l'avion qui me ramenait de Biarritz à Genève, j'ai eu tout le temps hier après-midi de lire, en long et en large, le Journal du dimanche, du 8 novembre donc.
Martine Aubry, la patronne du Parti socialiste français, dans un entretien à l'hebdomadaire, dit (ici) :
"Le marché, c'est l'initiative et l'innovation, ce qui me va parfaitement."
Rien à dire. Elle corrige aussitôt son propos, peu socialiste :
"Mais les principes qui le déterminent, la concurrence, l'individualisme, le court terme ne peuvent s'appliquer aux biens collectifs - l'éducation, la santé et
encore moins à la société. Le marché doit être régulé".
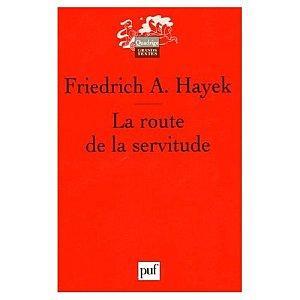 Qu'est-ce qu'un bien public, sinon un bien que l'Etat omniscient se
considère comme le seul à pouvoir gérer... Si le marché est régulé - sous-entendu par l'Etat -, il n'est plus le marché... Si le marché se donne des "règles de bonne conduite", comme disait Friedrich Hayek, il fonctionne, mais seulement si ces règles s'élaborent au gré des échanges et ne sont pas
imposées arbitrairement par l'Etat, dont les interventions faussent justement le fonctionnement du marché, comme on a pu le voir récemment avec la crise des subprimes.
Qu'est-ce qu'un bien public, sinon un bien que l'Etat omniscient se
considère comme le seul à pouvoir gérer... Si le marché est régulé - sous-entendu par l'Etat -, il n'est plus le marché... Si le marché se donne des "règles de bonne conduite", comme disait Friedrich Hayek, il fonctionne, mais seulement si ces règles s'élaborent au gré des échanges et ne sont pas
imposées arbitrairement par l'Etat, dont les interventions faussent justement le fonctionnement du marché, comme on a pu le voir récemment avec la crise des subprimes.
Le même Journal du dimanche reproduit des extraits de l'hommage que Jean-Marie Rouart a rendu à Claude Lévi-Strauss, son collègue à
l'Académie française, et notamment ce passage (ici) :
"Il était hanté par l'uniformisation du monde, sa standardisation par la tyrannie de profit et la dictature du marché".
N'étant pas suffisamment connaisseur de l'anthropologue je me garderai de porter un jugement sur la véracité de cette hantise. Je retiendrai seulement que les mots de tyrannie et
de dictature sont employés dans un sens inversé. En effet le profit n'est pas en lui-même tyrannique; il est le résultat d'un échange et en mesure la richesse qui a été produite. De
même le marché est-il le contraire de la dictature puisqu'il permet à chacun d'opérer un choix personnel. Le monde ne s'uniformise que si un seul producteur occupe le marché et empêche - ou
obtient que - d'autres producteurs puissent y entrer.
Arrivé à Lausanne j'ouvre L'Hebdo du 5 novembre (ici) et je lis le
dernier entretien que Jean-François Bergier, décédé le 29 octobre dernier, a accordé à l'hebdomadaire romand. L'historien suisse qui a "présidé de 1996 à 2001 la Commission indépendante d'experts sur l'attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale" - laquelle a accouché du controversé
Rapport Bergier - déclare :
"Le néolibéralisme n'est qu'un libéralisme sauvage qui exclut toutes les règles pouvant entraver un profit rapide. Alors qu'il faut des règles du jeu et que c'est à
l'Etat de les fixer et de contrôler qu'elles soient appliquées".
Ce que le digne professeur ignore - ou feint d'ignorer - c'est que ce sont les règles fixées, et contrôlées, par l'Etat américain qui sont à l'origine de la crise financière, et plus
particulièrement les règles bancaires et les manipulations monétaires.
Comme on le voit, alors que ce soir, avec la célébration de la chute du mur de Berlin, est fêtée la liberté retrouvée, en 1989, de circuler entre les deux Allemagnes, qui n'en feront plus
qu'une un an plus tard, de brillants esprits ne se rendent toujours pas compte que leur façon d'appréhender le marché les conduit tout droit sur "la route
de la servitude".
Francis Richard
Nous en sommes au
478e jour de privation de liberté pour Max Göldi et Rachid Hamdani, les deux otages suisses en Libye

