 La seconde partie de « La machine à traduire de Ricardo Piglia » laisse la parole, pour un entretien, au traducteur François-Michel Durazzo.
La seconde partie de « La machine à traduire de Ricardo Piglia » laisse la parole, pour un entretien, au traducteur François-Michel Durazzo.
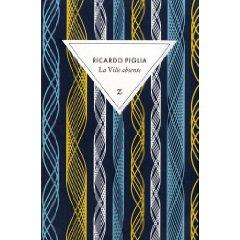 Ricardo Piglia est né en 1940 dans la province de Buenos Aires. Il est romancier, nouvelliste et critique, et enseigne la littérature latino-américaine à Princeton. En français sont actuellement disponibles deux romans (Respiration artificielle, Ed. André Dimanche, 2000 et La Ville absente, Ed. Zulma, 2009), un essai (Le dernier lecteur, Ed. Christian Bourgois, 2008) et un court texte (Une Rencontre à Saint -Nazaire, Ed. Meet, 1989). Argent Brûlé, initialement paru chez André Dimanche en 2001, sera publié en 2010 par les Editions Zulma.
De Ricardo Piglia, François-Michel Durazzo a traduit Argent Brulé et La Ville absente. Il a bien voulu répondre à quelques questions que je lui ai soumises sur son travail de traducteur et sa sensibilité de lecteur vis-à-vis des romans de Piglia.
Ricardo Piglia est né en 1940 dans la province de Buenos Aires. Il est romancier, nouvelliste et critique, et enseigne la littérature latino-américaine à Princeton. En français sont actuellement disponibles deux romans (Respiration artificielle, Ed. André Dimanche, 2000 et La Ville absente, Ed. Zulma, 2009), un essai (Le dernier lecteur, Ed. Christian Bourgois, 2008) et un court texte (Une Rencontre à Saint -Nazaire, Ed. Meet, 1989). Argent Brûlé, initialement paru chez André Dimanche en 2001, sera publié en 2010 par les Editions Zulma.
De Ricardo Piglia, François-Michel Durazzo a traduit Argent Brulé et La Ville absente. Il a bien voulu répondre à quelques questions que je lui ai soumises sur son travail de traducteur et sa sensibilité de lecteur vis-à-vis des romans de Piglia.
Antonio Werli - Comment avez-vous découvert l'oeuvre de Ricardo Piglia (vous avez traduit Argent Brûlé en 2001 aux éditions André Dimanche, et l'auteur n'était pratiquement pas connu en France). Pouvez-vous nous parler de son importance, de sa notoriété en Argentine ? François-Michel Durazzo - Quand André Dimanche m'a demandé de traduire Argent brûlé, Ricardo Piglia n'était pas tout à fait un inconnu en France. Quelques textes courts avaient déjà été traduits : « La fronde », (Europe n° 690, 1986), Une rencontre à Saint-Nazaire (Meet, 1989), un recueil de nouvelles : Faux nom (Arcane 17, 1990) et « L'affaire Urquiza » (Anthologie de la nouvelle latino-américaine, Belfond, 1991). Dimanche venait tout juste de publier la traduction qu'avaient faite Antoine et Isabelle Berman de Respiration artificielle (2000). Le travail d'Antoine Berman, mort en 1991, avait été refusé partout et si André Dimanche s'est intéressé à cette œuvre, c'est sur les conseils du grand critique argentin installé en France Saul Yurkievich, avec l'intention de continuer à le publier : d'abord Argent brûlé, puis La Ville absente, œuvre à laquelle il renoncera pour concentrer sa ligne éditoriale sur les livres d'art. On connaît la suite : Bourgois pensait reprendre le flambeau et a publié Le dernier lecteur, juste avant sa mort, et sa veuve n'a pas souhaité poursuivre avec Piglia. C'est Zulma qui avec beaucoup de foi et d'engagement reprend Ricardo Piglia avec la volonté de lui donner la place qu'il mérite dans le paysage littéraire français et de reprendre les titres publiés précédemment et épuisés. Ce qui personnellement me prédisposait à la traduction d'un roman argentin, c'étaient les deux voyages que je venais de faire à Buenos Aires, sur les pas de Juarroz et de Borges, au centenaire duquel je venais de travailler. J'avais aussi traduit quelques poètes argentins, par exemple Juan Gelman, surtout pour des revues en en anthologie.
Vu d'Argentine, on ne considère peut-être pas l'œuvre de Piglia de la même façon. En France, au moment de la publication de Respiration artificielle, Piglia pouvait sembler un auteur complexe, un intellectuel, un narratologue. C'était de cette manière que la réception de son œuvre s'opérait, portée par la traduction du grand théoricien qu'était devenu Berman avec l'Épreuve de l'étranger (1984) et par les universitaires franco-argentins spécialistes de son œuvre. En Argentine, Ricardo Piglia est bien plus que cela : c'est à la fois un formidable conteur en plus d'une caisse de résonance des conflits qui agitent la société argentine dans les dernières années de la dictature. En même temps, il est l'héritier de Roberto Arlt, l'auteur qui a le plus marqué la génération d'auteurs à laquelle appartient Piglia. Les micro-récits qui prolifèrent dans son œuvre, presque toujours symboliquement saturés de représentations de la violence psychologique, policière, étatique… expriment avec beaucoup d'acuité la réalité argentine telle que Piglia la ressent.
A. W. - Quels sont les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la traduction d'un livre comme La Ville absente, d'une densité et d'une richesse (de tons, de références, de structure...) assez inouïe. J'imagine qu'il a fallu faire un travail de "décryptage" important :
F-M. D. - Traduire n'est rien d'autre que lire de manière intense, précise, critique, active. C'est pour moi la lecture portée à ses extrêmes avec tout ce que cela suppose d'interprétation, de réinterprétation, d'appropriation. Je ne suis pas un traducteur qui prend l'auteur au pied de la lettre. Je n'ai pas hésité à questionner Piglia, sur tel ou tel détail de l'original. Si je suis fidèle, ce serait plutôt à ce que je sens de l'œuvre qui me traverse. C'est pour cela que je revendique la traduction comme une lecture personnelle. En même temps et paradoxalement avec ce que je viens de dire, je tente de ne pas me mettre en avant dans la traduction, je tente d'inventer un style qui ne serait pas le mien, mais celui que j'imagine sous la plume de mon auteur s'il s'était exprimé en français. Pure fiction, bien sûr ! La ville absente mêle plusieurs récits prêtés à plusieurs personnages. Piglia revendique dans l'écriture ce qu'il appelle le document « dur », brut, la retranscription fidèle d'une voix, d'où le passage qui s'appelle « l'enregistrement », d'autre part La Ville absente postule la liberté absolue de la littérature, quand bien même elle serait prisonnière d'une machine. Tout se passe comme s'il donnait à sa plume une sorte d'indépendance, comme si l'écriture devait échapper à son créateur. Évidemment, l'auteur reste l'auteur et cette posture littéraire n'est là encore qu'une fiction, mais une fiction signifiante. Il fallait donc trouver un rythme, différents rythmes, et pour cela, la traduction de la poésie m'a beaucoup aidé. A. W. - L'écrivain Cubain José Lezama Lima n'avait pas peur d'affirmer que seule était stimulante la difficulté. Au-delà des difficultés que vous avez pu rencontrer, quels sont ou ont été vos plaisirs lors de ce travail ?
F-M. D. - Pour moi, le plaisir se joue d'abord comme pour n'importe quel lecteur dans la lecture-découverte, la traduction, sans trop réfléchir, au fil d'un texte dont je n'ai lu que quelques pages avant de m'y mettre, poussé par le même désir d'avancer que n'importe quel lecteur. Ce travail, que le traducteur argentin Rolando Costa Picazo appelle son tricot, se prolonge pour moi dans la recherche et la vérification systématique et boulimique de toutes les références (dont on trouve le résultat sur le site de Zulma dans « À propos de La Ville absente » (mini essai sur la tradition littéraire et glossaire pigliens). Si la traduction fonctionne, je retrouve ce plaisir à la fin, quand à la lecture des dernières épreuves, l'émerveillement initial me ressaisit. Entre ces deux moments, il y a quelques moments difficiles, d'innombrables corrections. Il faut dire que dans ce travail, le traducteur n'est pas seul. Les éditeurs, en l'occurrence chez Zulma Laure Leroy et Serge Safran, ont aussi leurs exigences et sont un véritable stimulant. Je reprends donc plusieurs fois mon premier jet. Notons à ce propos que le travail éditorial est très différent en Argentine et en France où les corrections d'épreuves, la cohérence typographique, la vérification systématique des références internes consistent à mener un travail plus approfondi que ce qui a été fait dans l'édition originale. C'est donc aussi à ce propos et à ce moment-là aussi que le dialogue avec l'auteur s'engage, comme l'éditeur l'aurait fait avec un de ses auteurs français. Evidemment aucune intervention ne ne se fait sans l'accord de l'auteur.
A. W. - Pouvez-vous nous parler de sa langue ? J'ose à peine évoquer la richesse des tons et des registres dans ses livres, et sa pratique spécifique du discours rapporté comme processus narratif. Pouvez-vous nous en dire plus ?
F-M. D. - La langue de Piglia s'inscrit dans la tradition d'Arlt « polyfacétique » : selon les situations, elle peut être parlée, argotique dans Argent brûlé quand il fait parler des malfrats, voire soignée, conceptuelle… C'est l'une des difficultés de cet auteur. L'un de ses traits les plus frappants, que ma traduction ne reflète peut-être pas assez, c'est la sobriété absolue de sa syntaxe, sa préférence pour la coordination plutôt que la subordination, son goût pour le rythme binaire, courant en espagnol, mais qui passe si mal en français. Tout cela fait partie de l'oralité et de la tradition du conte. Même quand Piglia tend vers un discours historique, scientifique ou critique, sa parole tient plus de l'oralité du discours du professeur en chaire qu'il est à Princeton que de l'écriture léchée. La difficulté dans la traduction était de rendre cette richesse de tonalités tout en évitant ce qui ne serait pas passé en français, de ne pas dénaturer la tonalité et ce qui fait la singularité de l'œuvre.
A. W. - Le paysage littéraire contemporain argentin est extrêmement riche (on a vu en France paraître des auteurs marquants comme Aira, Pauls, Fresán, et bien d'autres). Auriez-vous des auteurs ou des livres que vous conseilleriez aux lecteurs hispanophones du Fric-Frac Club ?
F-M. D. - En tant que lecteur, je me disperse beaucoup et je n'ai pas une vision claire de l'ensemble de la production argentine. J'ai malgré tout suivi avec intérêt César Aira, dont Un épisode dans la vie du peintre voyageur, admirablement servi par la traduction de Michel Lafon, m'avait beaucoup impressionné. Cependant, je n'adhère pas toujours à cette écriture et quelques traductions ultérieures m'ont déçu. Par ailleurs, Le Passé d'Alan Pauls m'a passionné. Je l'ai lu dès sa sortie en espagnol, avant même que Bourgois n'achète les droits pour proposer la traduction à André Gabastou qui a fait un magnifique travail. Je me souviens de la réponse de Piglia à qui j'avais demandé son avis sur ce roman : « Pauls est la meilleure chose qui ait pu arriver à la littérature argentine depuis très longtemps ». Quand à Rodrigo Fresán, il faut absolument lire son roman paru aux Éditions Passage du Nord-Ouest La Vitesse des choses, qui dans la ligne de ceux de Piglia, bien que dans une écriture assez différente, fourmille en mini-récits, mêle critique et récit, réflexion et narration, a une vision des destins humains très profonde. Il faudra aussi suivre Lucía Puenzo, dont un étonnant roman est en préparation chez Stock. Cela dit, malgré le talent d'écrivains comme Pauls, Fresán ou Aira, personne n'avait, depuis Macedonio Fernández, Roberto Arlt et Borges, pénétré avec la profondeur de Piglia la relation entre le langage, la société, la violence, la littérature, tout en parvenant à nous offrir de vraies histoires, des visages attachants que nous emportons avec nous comme la petite fille ou le gaucho de La Ville absente.
A. W. - Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
F-M. D. - Après El Último lector (titre homonyme de celui de Piglia), je viens d'achever pour Zulma la traduction d'un deuxième roman du Mexicain David Toscana, qui en espagnol s'intitule Estación Tula, une véritable boîte à merveilles. Un auteur intense, original, important au Mexique, et qui dans les prochaines années sera considéré comme l'un des grandes figures de la littérature hispano-américaine. En ce moment, je reviens à Piglia et suis en train de reprendre ma première traduction d'Argent brûlé, un roman totalement différent de La Ville absente, d'une force incroyable et qui raconte un fait divers survenu dans les années 60 : une bande de voyous prend d'assaut et dévalise un fourgon blindé, en laissant derrière eux plusieurs morts. Une course poursuite s'engage. Cela fonctionne comme une tragédie grecque, ça a quelque chose du meilleur Faulkner, c'est une prouesse narratologique qui repose sur la synthèse d'une foule de coupures de presse rassemblées par Piglia au moment des faits et c'est, de plus, une très forte histoire d'amour homosexuel. J'ai aussi traduit, en 2009 un roman catalan d'Anna Soler-Pont et d'Asha Miró, ainsi qu'un petit bijou, intitulé Pépé l'Anguille, premier roman écrit en langue corse en 1929. Tout cela paraîtra en 2010. *
 Ricardo Piglia - DR
Ricardo Piglia - DR
