
Par quel bout prendre ce petit livre de deux cents pages, joliment habillé en français par les
Editions Zulma et leur graphiste/designer
David Pearson - l'habilleur de Penguin qui fait un travail admirable et classieux, ici des bandes parallèles spiralées zébrant la couverture de
la Ville absente ? Par quel bout le prendre - petite boîte de Pandore à histoires -, qui, bien qu'on le lise dans un sens tout à fait conventionnel, du début à la fin évidemment, parvient à chaque page à brouiller les pistes et les repères classiques de la narration pour confondre son lecteur dans un impressionnant tourbillon de micro-fictions, de fictions fragmentées, d'investigations méta-littéraires, voire métaphysiques, de propositions saturées, de mélanges, de parodies, de réflexions politiques, d'humour absurde, de profonde paranoïa... La question n'est pas exactement comment lire
la Ville absente, mais comment en parler.
J'ai poussé mes camarades du Club à plonger dans
la Ville absente (et j'exhorte tout le monde que je croise depuis trois mois à lire Piglia, et je VOUS exhorte aussi à le lire, maintenant), et avec moi, impressionnés par sa sophistication, sa variété, sa langue et ses références, comme par sa profondeur réflexive (littéraire, politique, historique...) et ses reliefs parodiques et burlesques, ceux qui m'ont suivi convenaient qu'il fallait faire quelque chose de cet extraordinaire roman... mais encore une fois : comment dire ? Que dire ? (question évidemment centrale chez Piglia, chez qui rien n'est laissé au hasard).
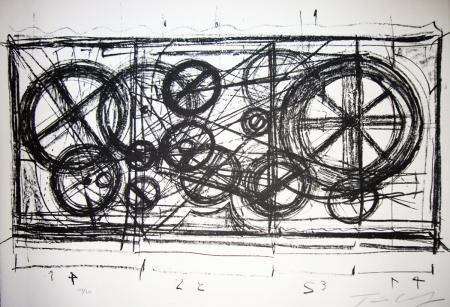
Commençons par explorer l'histoire. Je dois avouer qu'il m'a fallu reprendre attentivement le livre avec un gros marqueur à biffure afin d'oublier un instant la prolifération de récits secondaires et enchâssés (mais absolument pas inutiles ou dispensables, comme nous le verrons puisqu'ils
nourrissent constamment la trame principale) pour en dégager l'essence. Attachez vos ceintures,
vamos : Junior Mac Kensey vient trouver Emilio Renzi au bureau du quotidien
El Mundo. Il cherche du travail et va pour le journal commencer une longue investigation sur la machine de Macedonio, une improbable invention qui à l'origine est une machine à traduire. Alors que Junior est celui qui détient déjà le plus d'informations sur celle-ci, qui par ailleurs est connue dans tout le pays (cela le rend suspect aux yeux de ses collègues), il reçoit un jour un coup de fil d'un femme mystérieuse qui lui donne un information essentielle : il doit rencontrer le Coréen Fuyita, le gardien d'un musée où se trouverait la machine, à l'hôtel Majestic. Au Majestic, chambre 223, ce n'est pas Fuyita (alias Cristo) que Junior rencontre mais une autre femme, alcoolique, jalouse, battue et abattue, ancienne danseuse de cabaret dont le nom de scène est Lucia Joyce, qui lui explique que Fuyita est au Musée, et que la machine, c'est une femme, "c'
était une femme". Le nom de cette dernière est Elena et elle se trouverait dans "une boîte de conserve", "derrière une paroi de verre [...] pleine de tubes et de fils électriques". Sur la route du Musée, Junior écoute le dernier enregistrement produit par la machine, que Renzi lui a transmis avant de partir vers le Majestic. Puis, au Musée, il parcours de nombreuses pièces rousselliennes, pour arriver enfin à croiser Fuyita, qui lui dit avoir un document que Junior est censé analyser et publier dans le journal par la suite. Fuyita lui avoue de plus travailler pour l'ingénieur Richter qui a collaboré avec Macedonio depuis le début, et permet à Junior d'éclairer quelques points sombres de l'enquête, il apprend entre autre qu'Elena est la femme de Macedonio. Junior repart avec "Les Nœuds Blancs" en main, l'un des derniers récit de la machine, qui n'a pas encore été rendu public. Ensuite, réveillé en pleine nuit par un nouvel appel de la femme mystérieuse, qui dit s'appeler Julia Gandini, Junior s'en va à sa rencontre, rendez-vous qu'elle lui impose. Elle en profitera pour divulguer une quantité d'informations non négligeables, mais la police qui mettra son nez dans l'affaire remet entièrement en cause ses dires, Julia semble être une patiente complètement dérangée de l'Hôpital neuropsychiatrique d'Avellaneda, "une psychopathe [...] une prostituée qui passe des informations à la police." Elle aura cependant transmis à Junior une nouvelle enveloppe, contenant "des numérotations et des citations de différents récits, en particulier celui de
Stephen Stevenson", le premier de la machine, comme nous l'a appris le narrateur bien plus tôt (qui au passage n'est ni Junior, ni Renzi...) :
Tel était le point de départ. (p. 113)
Junior part donc sur les traces de Russo l'ingénieur (car "il savait bien qu'à présent on disait qu'en réalité il était Donald Richter, le physicien atomique qui avait trompé le Général Perón"), qui semble détenir le secret de la machine, tout en essayant de démêler la pelote d'histoires, de récits, d'informations qu'il a accumulés depuis le début, tentant de faire la part des choses entre le rêve et la veille, entre la fiction et la réalité, entre la vérité et le mensonge. Il relit et relie les récits, plonge dans l'histoire récente argentine, suit les biographies des différents personnages, explore les œuvres dont la réalité semble s'inspirer (Macedonio Fernández évidemment et de nombreux auteurs argentins, mais aussi Edgar Poe, James Joyce, Hermann Broch, Dante et tant d'autres...) corrobore les informations, tisse des liens, interprète, rencontre d'autres personnages, des femmes pour la plupart, et commence à comprendre qu'"au début, la machine se trompe. L'erreur est le principal déclencheur."
Je crois qu'il n'est pas utile de poursuivre plus avant, minutieusement, le fil de la trame. D'autant plus que j'ai laissé de côté une quantité de choses, et que je ne parviens ici pour ainsi dire qu'à dénouer un peu plus de la moitié du livre. Au lecteur de plonger et prolonger cette enquête et d'en démêler les fils ; de se laisser porter par l'écriture d'une fluidité et d'une respiration déconcertante en rapport à sa densité ; de découvrir la multitude de récits secondaires qui mériteraient chacun un traitement à part entière (les chapitres "'L'enregistrement", les fragments du chapitre "Le Musée", le récit "Les Nœuds blancs", et encore le vertigineux "L'île", pour les principaux) ; de céder au plaisir souvent oublié de la relecture !
Par contre, ce qu'il me semble important de poursuivre, c'est l'effort de comprendre ce qui se cache à l'intérieur de cette intrigue hyper-sophistiquée, riche et aux accents fantasques.

Ainsi, partons de la machine.
La machine de Macedonio est la forme technique et paranoïaque de l'archaïque Shéhérazade. Elle est conçue comme une machine à traduire, et le premier récit qu'on lui intègre est la célèbre et infernale histoire de double d'Edgar Poe,
William Wilson. Comme je le précisais plus haut, dès le début, il y a une erreur. La machine traduit, répète, mais avec des variations. Ces variations, ces mélanges, ces fuites contaminent rapidement la réalité, William Wilson devenant Stephen Stevenson. Joyce se substituant à Poe tout en restant Poe superposé à Joyce.
De fait, la fiction est productrice de réel, et quelquefois même de vérité (on verra tout à l'heure que la vérité est le point central de la fiction piglienne), au détriment d'autres zones d'influence qui organisent la société, comme le politique ou le juridique ("Ils contrôlent tout, ils ont fondé l'Etat mental [...] qui est une nouvelle étape dans l'histoire des institutions."), ou la police ("la police avait toujours le dernier mot"), ou les médias ("il existe une certaine relation entre la faculté télépathique et la télévision"). L'œuvre romanesque de Piglia part de ce principe : le document (lettre, témoignage, photographie, compte-rendu, et ici symptomatiquement l'enregistrement) est ce qui produit le réel. Le langage n'est que le moyen de l'exprimer, ce qui est essentiel, c'est comment, par quel moyen il s'exprime. D'où de grandes réflexions sur l'écriture de l'Histoire, l'écriture des faits (divers ou historiques), et le contrôle du pouvoir qui la traverse (le pouvoir politique sur le peuple dans le roman, le pouvoir médiatique sur la ville et ses rumeurs, le pouvoir du romancier sur son œuvre, le pouvoir d'interprétation du lecteur sur le sens du texte...). Finalement, celui qui détient le pouvoir n'est pas celui qui détient l'information, comme on pourrait facilement le penser (Junior a dès le début toutes les informations ou presque concernant la machine) mais comment ces informations sont exprimées et ensuite, diffusées. Que ce soit à grande ou moindre échelle. Ce qui est sûr c'est qu'on ne parvient jamais à (re)trouver l'information originelle, le document, l'enregistrement premier.. Tout est pâle copie produite par la machine, mais parce qu'il y a des erreurs, des variations, des différences dans les répétitions, tout devient l'original, ou plutôt tout parvient à exprimer quelque chose d'original et donc avoir des conséquences ou des effets sur le réel.
Shéhérazade-machine en vient
naturellement à automatiser sa propre histoire au sein du récit plus vaste, et le récit-cadre, qui
comme j'ai essayé de le pointer chez
Lafargue permet de jouer de la subversion à différents niveaux (au sein de l'histoire même, vis-à-vis du lecteur, ou dans une réflexion politique), est ici, par saturation, par automatisation, par répétition, le processus qui ôte non pas toute réalité, mais toute vérité au langage, au signifiant, sauf s'il exprime la première représentation du fait, de la passion ou de la certitude. Vaine quête toujours remise en cause par la paranoïa contenue et produite par ce système clos. Shéhérazade en mouvement perpétuelle, la machine de Macedonio est aussi folle sinon plus que l'invention de Morel, dans le roman éponyme d'un autre célèbre argentin.
Ainsi, Junior découvre avec le lecteur au fur et à mesure de son enquête différents récits de la machine, insérés concrètement par Piglia dans la trame principale, nourrissant directement celle-ci, rendant vague quelquefois - assez souvent devrais-je dire -, ce qui tient de la l'influence des récits dans le réel ou vérité du roman, ou de la manière dont le réel nourrit la machine de nouvelles fictions. Il y a dans un sens quelque chose de très
spectaculaire dans le fonds des romans pigliens : l'impossibilité de faire la différence entre la poule et l'œuf (pas simplement de savoir qui était là avant !), l'impossibilité de repérer les flux d'informations, l'impossibilité, du fait de la saturation d'informations et de récits de faire émerger un récit supérieur ou une information fondamentale, tout fonctionnant circulairement, en tours, détours et retours, d'Héraclite (dont "on a inversé la maxime [...] pensa Junior") à Debord ou Baudrillard en passant par Nietzsche - regardez de près cette splendide phrase autotélique : "Encore une fois, c'était le point de départ, un anneau au centre de la narration." (p. 114)
Par ailleurs, Piglia ne perd pas de vu que cette séduisante vision du monde, cette impressionnante définition du réel, excluant toute eschatologie puisqu'à chaque instant réalisant son propre but, n'est encore qu'un récit parmi d'autres. Voilà peut-être l'une des grandeurs de cet auteur ayant la lucidité de NE PAS tomber dans le piège d'une idéologie pouvant vite surgir de ces interprétations. A la suite du premier Wittgenstein, il admet volontiers qu'il y a certaines choses dont on ne peut parler, il faut les taire. Le théoricien (double du romancier) est alors remplacé - transposé - par le romancier (retour de l'image du romancier). A l'image de romanciers gnostiques contemporains (si je peux les appeler ainsi), à l'image de
Dick ou de
Pynchon par exemple, il me semble qu'il projette alors l'indicible vérité dans le creuset du mensonge ou de l'illusion : "Le réel était défini par le possible (et non l'être). A l'opposition vérité/mensonge devait se substituer l'opposition possible/impossible." J'ai bien précisé que Piglia jouait sur le possible et l'impossibilité comme définition du réel. A un moment, Piglia retourne cette proposition qui définissait jusque-là son projet. Sur cette question de la vérité et du mensonge, et du possible et de l'impossible, sur la définition du réel, il faudrait étudier de près l'utilisation des temps et des modes temporels que fait Piglia. Les imparfaits, les conditionnels, les présents ne sont pas dus au hasard.
"Le langage tue" est tagué sur le plafond de la cabine d'ascenseur du Majestic (quelle place symbolique !), mais il n'a dans les faits tué personne. De fait ce que propose Macedonio en inventant la machine, c'est l'inverse, c'est la quête des « nœuds blancs », l'éternité par le langage. Même dans la plus sophistiquée des machines, celle de Macedonio, ou celle de Morel, la vérité du réel a une consistance autre que celle du langage. Ainsi, la vérité au cœur du cœur de Macedonio n'est plus le(s) possible(s) exhaustif(s) mais la réalité et l'éternité d'une passion. Elle n'est plus déterminée par le langage et ses jeux, mais par la certitude intime et sa vérité propre. Piglia fait dire à un endroit à Macedonio quelque chose d'essentiel, qui transforme son espèce de roman d'anticipation métaphysique, narratologique, théorique, critique en une pure histoire de passion et d'amour, débordant, enfin et heureusement, les limites du langage, comme une espèce de nouvelle erreur, ou panne dans la machine :
Un récit n'est rien d'autre que la reproduction de l'ordre du monde à une échelle purement verbale. Une réplique de la vie, si la vie était seulement faire de mots ! Mais la vie n'est pas seulement faite de mots, elle est aussi malheureusement faite de corps, c'est-à-dire disait Macedonio, de maladie, de douleur et de mort. (p. 163)
La machine de Macedonio est sa femme, et c'est l'amour désespéré qui l'anime qui l'a poussé à élaborer une telle invention.
Ce qui est réellement admirable dans ce roman (comme dans les autres), c'est cette conscience de la violence, de la douleur, de la mort, de la maladie (physique ou mentale), comme du plaisir, de l'espoir, de l'amour, ou d'une passion - par exemple la littérature, centrale et mystérieuse machinerie qui est évidemment plus qu'une machine, "un organisme plus complexe".
La Ville absente est une histoire d'amour et il est probable que cette absente ne soit pas simplement cette ville (un Buenos Aires fantasmé) mais une femme, Elena, la femme de Macedonio, accompagnée de toutes les femmes possibles, dont Junior rencontre quelques avatars sur son chemin, rappelant par ailleurs le cœur perdu ou occulté d'un autre énorme roman saturé, ou le moteur du récit est la recherche d'une autre femme-machine, d'une femme multiple : la V. de Thomas Pynchon.
Dans ces années-là, Macedonio perdit sa femme, Elena Obieta, et tout ce qu'il fit depuis lors (surtout la machine) fut destiné à la rendre présente. Elle était l'Eternelle, le fleuve du récit, la voix interminable qui gardait vivant le souvenir. Jamais il ne put se résigner à sa perte. En cela il était comme Dante, et comme Dante il édifia un monde pour vivre avec elle. La machine fut ce monde en même temps que son chef-d'œuvre. (p. 53)
Piglia, dans une sauce parfaitement paranoïaque, dans la parfaite tradition littéraire qui irrigue le XX
e siècle littéraire, propose finalement - et ses trois romans le proposent chacun à leur tour -, une réécriture d'un même problème. Il dit quelque part - l'ai-je lu dans un des ces livres ou dans un entretien ? Peu importe au fond, d'autant plus qu'il est probable que ce ne soit pas lui qui l'ait dit, ou plutôt que je ne l'aie pas lu chez lui, ou qu'il l'ai simplement répété, et il est probable que ce ne soit pas de cette manière que ça a été formulé... - qu'il y a deux manières de faire un roman, et peut-être une variation infinie ou presque de l'écrire : le voyage ou le crime sont les deux possibilités du roman. L'épopée ou la tragédie, au fond. Nous ne faisons que réécrire notre origine grecque, n'est-ce pas ? Ce que propose Piglia je pense, et que font
Bolaño ou Pynchon (pourquoi je les cite ? parce qu'ils me hantent comme me hante Piglia mais je pourrais en citer bien d'autres), c'est réaliser ce voyage et ce crime. Il y a forcément une grande nostalgie liée à cela, démultipliée par la paranoïa dans
la Ville absente, mais la tension jetée au cœur de son roman par Piglia, tension dramatique, tension philosophique, tension intellectuelle, tension politique, provient non pas d'un désenchantement ou d'un horizon inatteignable, d'une perte irrésoluble mais d'une passion, d'une passion gigantesque pour la littérature, la culture et la langue, une passion pour l'art et pour la vérité (donc pour la fiction et pour l'illusion), une passion inscrite dans l'amour pour une femme, Elena, invention monstrueuse qui comble parfaitement l'absence de sa réalité. (Nous ne sommes probablement pas si éloigné ici de
la tentative mitigée mais ambitieuse de Stéphane Velut.)
Le voyage de Piglia, c'est un voyage dans le temps, la culture et le langage, et son Ulysse c'est Renzi, dont Junior n'est que la doublure dans cette
Ville absente.
Le crime de Piglia, c'est ce qui est à l'absence, ce dont l'absence est le produit : la machine substituée à la vie.
Qu'on reproche à Piglia l'excès formel et théorique de ses livres, et l'on ne comprendrait pas une chose fondamentale :
Ce qui n'a pas trouvé sa forme, dit Rios [fleuves en espagnol], souffre d'un manque de vérité. (p. 133)
Qu'on reproche à Piglia une froideur ou une distance trop cérébrale ou intellectuelle, et l'on ne comprendrait pas la mesure de cette
chose, comme un avertissement donné en guise de ligne de mire - en gras dans le texte, les derniers mots d'Enrique Osorio au début de
Respiration Artificielle :
Ne vous dépassionnez point, car la passion est le seul lien que nous avons avec la vérité.
*
Et après cela, j'entends encore l'ironie de Junior derrière (ou devant ?) tous ces efforts : "Toutes les certitudes sont incertaines, ironisa Junior, il faut les vivre en secret, comme une religion privée."
 Notes - Les images de machines, c'est Tinguely gentiment grappillées sur le net, merci à lui. - Demain, en guise de seconde partie à ce papier, nous vous proposerons un entretien avec le traducteur de
Notes - Les images de machines, c'est Tinguely gentiment grappillées sur le net, merci à lui. - Demain, en guise de seconde partie à ce papier, nous vous proposerons un entretien avec le traducteur de la Ville absente
, François-Michel Durazzo.
 Par quel bout prendre ce petit livre de deux cents pages, joliment habillé en français par les Editions Zulma et leur graphiste/designer David Pearson - l'habilleur de Penguin qui fait un travail admirable et classieux, ici des bandes parallèles spiralées zébrant la couverture de la Ville absente ? Par quel bout le prendre - petite boîte de Pandore à histoires -, qui, bien qu'on le lise dans un sens tout à fait conventionnel, du début à la fin évidemment, parvient à chaque page à brouiller les pistes et les repères classiques de la narration pour confondre son lecteur dans un impressionnant tourbillon de micro-fictions, de fictions fragmentées, d'investigations méta-littéraires, voire métaphysiques, de propositions saturées, de mélanges, de parodies, de réflexions politiques, d'humour absurde, de profonde paranoïa... La question n'est pas exactement comment lire la Ville absente, mais comment en parler.
J'ai poussé mes camarades du Club à plonger dans la Ville absente (et j'exhorte tout le monde que je croise depuis trois mois à lire Piglia, et je VOUS exhorte aussi à le lire, maintenant), et avec moi, impressionnés par sa sophistication, sa variété, sa langue et ses références, comme par sa profondeur réflexive (littéraire, politique, historique...) et ses reliefs parodiques et burlesques, ceux qui m'ont suivi convenaient qu'il fallait faire quelque chose de cet extraordinaire roman... mais encore une fois : comment dire ? Que dire ? (question évidemment centrale chez Piglia, chez qui rien n'est laissé au hasard).
Par quel bout prendre ce petit livre de deux cents pages, joliment habillé en français par les Editions Zulma et leur graphiste/designer David Pearson - l'habilleur de Penguin qui fait un travail admirable et classieux, ici des bandes parallèles spiralées zébrant la couverture de la Ville absente ? Par quel bout le prendre - petite boîte de Pandore à histoires -, qui, bien qu'on le lise dans un sens tout à fait conventionnel, du début à la fin évidemment, parvient à chaque page à brouiller les pistes et les repères classiques de la narration pour confondre son lecteur dans un impressionnant tourbillon de micro-fictions, de fictions fragmentées, d'investigations méta-littéraires, voire métaphysiques, de propositions saturées, de mélanges, de parodies, de réflexions politiques, d'humour absurde, de profonde paranoïa... La question n'est pas exactement comment lire la Ville absente, mais comment en parler.
J'ai poussé mes camarades du Club à plonger dans la Ville absente (et j'exhorte tout le monde que je croise depuis trois mois à lire Piglia, et je VOUS exhorte aussi à le lire, maintenant), et avec moi, impressionnés par sa sophistication, sa variété, sa langue et ses références, comme par sa profondeur réflexive (littéraire, politique, historique...) et ses reliefs parodiques et burlesques, ceux qui m'ont suivi convenaient qu'il fallait faire quelque chose de cet extraordinaire roman... mais encore une fois : comment dire ? Que dire ? (question évidemment centrale chez Piglia, chez qui rien n'est laissé au hasard).
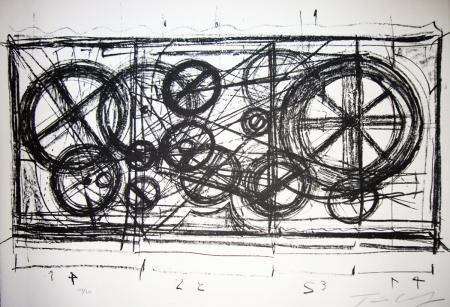 Commençons par explorer l'histoire. Je dois avouer qu'il m'a fallu reprendre attentivement le livre avec un gros marqueur à biffure afin d'oublier un instant la prolifération de récits secondaires et enchâssés (mais absolument pas inutiles ou dispensables, comme nous le verrons puisqu'ils nourrissent constamment la trame principale) pour en dégager l'essence. Attachez vos ceintures, vamos : Junior Mac Kensey vient trouver Emilio Renzi au bureau du quotidien El Mundo. Il cherche du travail et va pour le journal commencer une longue investigation sur la machine de Macedonio, une improbable invention qui à l'origine est une machine à traduire. Alors que Junior est celui qui détient déjà le plus d'informations sur celle-ci, qui par ailleurs est connue dans tout le pays (cela le rend suspect aux yeux de ses collègues), il reçoit un jour un coup de fil d'un femme mystérieuse qui lui donne un information essentielle : il doit rencontrer le Coréen Fuyita, le gardien d'un musée où se trouverait la machine, à l'hôtel Majestic. Au Majestic, chambre 223, ce n'est pas Fuyita (alias Cristo) que Junior rencontre mais une autre femme, alcoolique, jalouse, battue et abattue, ancienne danseuse de cabaret dont le nom de scène est Lucia Joyce, qui lui explique que Fuyita est au Musée, et que la machine, c'est une femme, "c'était une femme". Le nom de cette dernière est Elena et elle se trouverait dans "une boîte de conserve", "derrière une paroi de verre [...] pleine de tubes et de fils électriques". Sur la route du Musée, Junior écoute le dernier enregistrement produit par la machine, que Renzi lui a transmis avant de partir vers le Majestic. Puis, au Musée, il parcours de nombreuses pièces rousselliennes, pour arriver enfin à croiser Fuyita, qui lui dit avoir un document que Junior est censé analyser et publier dans le journal par la suite. Fuyita lui avoue de plus travailler pour l'ingénieur Richter qui a collaboré avec Macedonio depuis le début, et permet à Junior d'éclairer quelques points sombres de l'enquête, il apprend entre autre qu'Elena est la femme de Macedonio. Junior repart avec "Les Nœuds Blancs" en main, l'un des derniers récit de la machine, qui n'a pas encore été rendu public. Ensuite, réveillé en pleine nuit par un nouvel appel de la femme mystérieuse, qui dit s'appeler Julia Gandini, Junior s'en va à sa rencontre, rendez-vous qu'elle lui impose. Elle en profitera pour divulguer une quantité d'informations non négligeables, mais la police qui mettra son nez dans l'affaire remet entièrement en cause ses dires, Julia semble être une patiente complètement dérangée de l'Hôpital neuropsychiatrique d'Avellaneda, "une psychopathe [...] une prostituée qui passe des informations à la police." Elle aura cependant transmis à Junior une nouvelle enveloppe, contenant "des numérotations et des citations de différents récits, en particulier celui de Stephen Stevenson", le premier de la machine, comme nous l'a appris le narrateur bien plus tôt (qui au passage n'est ni Junior, ni Renzi...) :
Commençons par explorer l'histoire. Je dois avouer qu'il m'a fallu reprendre attentivement le livre avec un gros marqueur à biffure afin d'oublier un instant la prolifération de récits secondaires et enchâssés (mais absolument pas inutiles ou dispensables, comme nous le verrons puisqu'ils nourrissent constamment la trame principale) pour en dégager l'essence. Attachez vos ceintures, vamos : Junior Mac Kensey vient trouver Emilio Renzi au bureau du quotidien El Mundo. Il cherche du travail et va pour le journal commencer une longue investigation sur la machine de Macedonio, une improbable invention qui à l'origine est une machine à traduire. Alors que Junior est celui qui détient déjà le plus d'informations sur celle-ci, qui par ailleurs est connue dans tout le pays (cela le rend suspect aux yeux de ses collègues), il reçoit un jour un coup de fil d'un femme mystérieuse qui lui donne un information essentielle : il doit rencontrer le Coréen Fuyita, le gardien d'un musée où se trouverait la machine, à l'hôtel Majestic. Au Majestic, chambre 223, ce n'est pas Fuyita (alias Cristo) que Junior rencontre mais une autre femme, alcoolique, jalouse, battue et abattue, ancienne danseuse de cabaret dont le nom de scène est Lucia Joyce, qui lui explique que Fuyita est au Musée, et que la machine, c'est une femme, "c'était une femme". Le nom de cette dernière est Elena et elle se trouverait dans "une boîte de conserve", "derrière une paroi de verre [...] pleine de tubes et de fils électriques". Sur la route du Musée, Junior écoute le dernier enregistrement produit par la machine, que Renzi lui a transmis avant de partir vers le Majestic. Puis, au Musée, il parcours de nombreuses pièces rousselliennes, pour arriver enfin à croiser Fuyita, qui lui dit avoir un document que Junior est censé analyser et publier dans le journal par la suite. Fuyita lui avoue de plus travailler pour l'ingénieur Richter qui a collaboré avec Macedonio depuis le début, et permet à Junior d'éclairer quelques points sombres de l'enquête, il apprend entre autre qu'Elena est la femme de Macedonio. Junior repart avec "Les Nœuds Blancs" en main, l'un des derniers récit de la machine, qui n'a pas encore été rendu public. Ensuite, réveillé en pleine nuit par un nouvel appel de la femme mystérieuse, qui dit s'appeler Julia Gandini, Junior s'en va à sa rencontre, rendez-vous qu'elle lui impose. Elle en profitera pour divulguer une quantité d'informations non négligeables, mais la police qui mettra son nez dans l'affaire remet entièrement en cause ses dires, Julia semble être une patiente complètement dérangée de l'Hôpital neuropsychiatrique d'Avellaneda, "une psychopathe [...] une prostituée qui passe des informations à la police." Elle aura cependant transmis à Junior une nouvelle enveloppe, contenant "des numérotations et des citations de différents récits, en particulier celui de Stephen Stevenson", le premier de la machine, comme nous l'a appris le narrateur bien plus tôt (qui au passage n'est ni Junior, ni Renzi...) :
 Ainsi, partons de la machine.
La machine de Macedonio est la forme technique et paranoïaque de l'archaïque Shéhérazade. Elle est conçue comme une machine à traduire, et le premier récit qu'on lui intègre est la célèbre et infernale histoire de double d'Edgar Poe, William Wilson. Comme je le précisais plus haut, dès le début, il y a une erreur. La machine traduit, répète, mais avec des variations. Ces variations, ces mélanges, ces fuites contaminent rapidement la réalité, William Wilson devenant Stephen Stevenson. Joyce se substituant à Poe tout en restant Poe superposé à Joyce.
De fait, la fiction est productrice de réel, et quelquefois même de vérité (on verra tout à l'heure que la vérité est le point central de la fiction piglienne), au détriment d'autres zones d'influence qui organisent la société, comme le politique ou le juridique ("Ils contrôlent tout, ils ont fondé l'Etat mental [...] qui est une nouvelle étape dans l'histoire des institutions."), ou la police ("la police avait toujours le dernier mot"), ou les médias ("il existe une certaine relation entre la faculté télépathique et la télévision"). L'œuvre romanesque de Piglia part de ce principe : le document (lettre, témoignage, photographie, compte-rendu, et ici symptomatiquement l'enregistrement) est ce qui produit le réel. Le langage n'est que le moyen de l'exprimer, ce qui est essentiel, c'est comment, par quel moyen il s'exprime. D'où de grandes réflexions sur l'écriture de l'Histoire, l'écriture des faits (divers ou historiques), et le contrôle du pouvoir qui la traverse (le pouvoir politique sur le peuple dans le roman, le pouvoir médiatique sur la ville et ses rumeurs, le pouvoir du romancier sur son œuvre, le pouvoir d'interprétation du lecteur sur le sens du texte...). Finalement, celui qui détient le pouvoir n'est pas celui qui détient l'information, comme on pourrait facilement le penser (Junior a dès le début toutes les informations ou presque concernant la machine) mais comment ces informations sont exprimées et ensuite, diffusées. Que ce soit à grande ou moindre échelle. Ce qui est sûr c'est qu'on ne parvient jamais à (re)trouver l'information originelle, le document, l'enregistrement premier.. Tout est pâle copie produite par la machine, mais parce qu'il y a des erreurs, des variations, des différences dans les répétitions, tout devient l'original, ou plutôt tout parvient à exprimer quelque chose d'original et donc avoir des conséquences ou des effets sur le réel.
Shéhérazade-machine en vient naturellement à automatiser sa propre histoire au sein du récit plus vaste, et le récit-cadre, qui comme j'ai essayé de le pointer chez Lafargue permet de jouer de la subversion à différents niveaux (au sein de l'histoire même, vis-à-vis du lecteur, ou dans une réflexion politique), est ici, par saturation, par automatisation, par répétition, le processus qui ôte non pas toute réalité, mais toute vérité au langage, au signifiant, sauf s'il exprime la première représentation du fait, de la passion ou de la certitude. Vaine quête toujours remise en cause par la paranoïa contenue et produite par ce système clos. Shéhérazade en mouvement perpétuelle, la machine de Macedonio est aussi folle sinon plus que l'invention de Morel, dans le roman éponyme d'un autre célèbre argentin.
Ainsi, Junior découvre avec le lecteur au fur et à mesure de son enquête différents récits de la machine, insérés concrètement par Piglia dans la trame principale, nourrissant directement celle-ci, rendant vague quelquefois - assez souvent devrais-je dire -, ce qui tient de la l'influence des récits dans le réel ou vérité du roman, ou de la manière dont le réel nourrit la machine de nouvelles fictions. Il y a dans un sens quelque chose de très spectaculaire dans le fonds des romans pigliens : l'impossibilité de faire la différence entre la poule et l'œuf (pas simplement de savoir qui était là avant !), l'impossibilité de repérer les flux d'informations, l'impossibilité, du fait de la saturation d'informations et de récits de faire émerger un récit supérieur ou une information fondamentale, tout fonctionnant circulairement, en tours, détours et retours, d'Héraclite (dont "on a inversé la maxime [...] pensa Junior") à Debord ou Baudrillard en passant par Nietzsche - regardez de près cette splendide phrase autotélique : "Encore une fois, c'était le point de départ, un anneau au centre de la narration." (p. 114)
Par ailleurs, Piglia ne perd pas de vu que cette séduisante vision du monde, cette impressionnante définition du réel, excluant toute eschatologie puisqu'à chaque instant réalisant son propre but, n'est encore qu'un récit parmi d'autres. Voilà peut-être l'une des grandeurs de cet auteur ayant la lucidité de NE PAS tomber dans le piège d'une idéologie pouvant vite surgir de ces interprétations. A la suite du premier Wittgenstein, il admet volontiers qu'il y a certaines choses dont on ne peut parler, il faut les taire. Le théoricien (double du romancier) est alors remplacé - transposé - par le romancier (retour de l'image du romancier). A l'image de romanciers gnostiques contemporains (si je peux les appeler ainsi), à l'image de Dick ou de Pynchon par exemple, il me semble qu'il projette alors l'indicible vérité dans le creuset du mensonge ou de l'illusion : "Le réel était défini par le possible (et non l'être). A l'opposition vérité/mensonge devait se substituer l'opposition possible/impossible." J'ai bien précisé que Piglia jouait sur le possible et l'impossibilité comme définition du réel. A un moment, Piglia retourne cette proposition qui définissait jusque-là son projet. Sur cette question de la vérité et du mensonge, et du possible et de l'impossible, sur la définition du réel, il faudrait étudier de près l'utilisation des temps et des modes temporels que fait Piglia. Les imparfaits, les conditionnels, les présents ne sont pas dus au hasard.
"Le langage tue" est tagué sur le plafond de la cabine d'ascenseur du Majestic (quelle place symbolique !), mais il n'a dans les faits tué personne. De fait ce que propose Macedonio en inventant la machine, c'est l'inverse, c'est la quête des « nœuds blancs », l'éternité par le langage. Même dans la plus sophistiquée des machines, celle de Macedonio, ou celle de Morel, la vérité du réel a une consistance autre que celle du langage. Ainsi, la vérité au cœur du cœur de Macedonio n'est plus le(s) possible(s) exhaustif(s) mais la réalité et l'éternité d'une passion. Elle n'est plus déterminée par le langage et ses jeux, mais par la certitude intime et sa vérité propre. Piglia fait dire à un endroit à Macedonio quelque chose d'essentiel, qui transforme son espèce de roman d'anticipation métaphysique, narratologique, théorique, critique en une pure histoire de passion et d'amour, débordant, enfin et heureusement, les limites du langage, comme une espèce de nouvelle erreur, ou panne dans la machine :
Ainsi, partons de la machine.
La machine de Macedonio est la forme technique et paranoïaque de l'archaïque Shéhérazade. Elle est conçue comme une machine à traduire, et le premier récit qu'on lui intègre est la célèbre et infernale histoire de double d'Edgar Poe, William Wilson. Comme je le précisais plus haut, dès le début, il y a une erreur. La machine traduit, répète, mais avec des variations. Ces variations, ces mélanges, ces fuites contaminent rapidement la réalité, William Wilson devenant Stephen Stevenson. Joyce se substituant à Poe tout en restant Poe superposé à Joyce.
De fait, la fiction est productrice de réel, et quelquefois même de vérité (on verra tout à l'heure que la vérité est le point central de la fiction piglienne), au détriment d'autres zones d'influence qui organisent la société, comme le politique ou le juridique ("Ils contrôlent tout, ils ont fondé l'Etat mental [...] qui est une nouvelle étape dans l'histoire des institutions."), ou la police ("la police avait toujours le dernier mot"), ou les médias ("il existe une certaine relation entre la faculté télépathique et la télévision"). L'œuvre romanesque de Piglia part de ce principe : le document (lettre, témoignage, photographie, compte-rendu, et ici symptomatiquement l'enregistrement) est ce qui produit le réel. Le langage n'est que le moyen de l'exprimer, ce qui est essentiel, c'est comment, par quel moyen il s'exprime. D'où de grandes réflexions sur l'écriture de l'Histoire, l'écriture des faits (divers ou historiques), et le contrôle du pouvoir qui la traverse (le pouvoir politique sur le peuple dans le roman, le pouvoir médiatique sur la ville et ses rumeurs, le pouvoir du romancier sur son œuvre, le pouvoir d'interprétation du lecteur sur le sens du texte...). Finalement, celui qui détient le pouvoir n'est pas celui qui détient l'information, comme on pourrait facilement le penser (Junior a dès le début toutes les informations ou presque concernant la machine) mais comment ces informations sont exprimées et ensuite, diffusées. Que ce soit à grande ou moindre échelle. Ce qui est sûr c'est qu'on ne parvient jamais à (re)trouver l'information originelle, le document, l'enregistrement premier.. Tout est pâle copie produite par la machine, mais parce qu'il y a des erreurs, des variations, des différences dans les répétitions, tout devient l'original, ou plutôt tout parvient à exprimer quelque chose d'original et donc avoir des conséquences ou des effets sur le réel.
Shéhérazade-machine en vient naturellement à automatiser sa propre histoire au sein du récit plus vaste, et le récit-cadre, qui comme j'ai essayé de le pointer chez Lafargue permet de jouer de la subversion à différents niveaux (au sein de l'histoire même, vis-à-vis du lecteur, ou dans une réflexion politique), est ici, par saturation, par automatisation, par répétition, le processus qui ôte non pas toute réalité, mais toute vérité au langage, au signifiant, sauf s'il exprime la première représentation du fait, de la passion ou de la certitude. Vaine quête toujours remise en cause par la paranoïa contenue et produite par ce système clos. Shéhérazade en mouvement perpétuelle, la machine de Macedonio est aussi folle sinon plus que l'invention de Morel, dans le roman éponyme d'un autre célèbre argentin.
Ainsi, Junior découvre avec le lecteur au fur et à mesure de son enquête différents récits de la machine, insérés concrètement par Piglia dans la trame principale, nourrissant directement celle-ci, rendant vague quelquefois - assez souvent devrais-je dire -, ce qui tient de la l'influence des récits dans le réel ou vérité du roman, ou de la manière dont le réel nourrit la machine de nouvelles fictions. Il y a dans un sens quelque chose de très spectaculaire dans le fonds des romans pigliens : l'impossibilité de faire la différence entre la poule et l'œuf (pas simplement de savoir qui était là avant !), l'impossibilité de repérer les flux d'informations, l'impossibilité, du fait de la saturation d'informations et de récits de faire émerger un récit supérieur ou une information fondamentale, tout fonctionnant circulairement, en tours, détours et retours, d'Héraclite (dont "on a inversé la maxime [...] pensa Junior") à Debord ou Baudrillard en passant par Nietzsche - regardez de près cette splendide phrase autotélique : "Encore une fois, c'était le point de départ, un anneau au centre de la narration." (p. 114)
Par ailleurs, Piglia ne perd pas de vu que cette séduisante vision du monde, cette impressionnante définition du réel, excluant toute eschatologie puisqu'à chaque instant réalisant son propre but, n'est encore qu'un récit parmi d'autres. Voilà peut-être l'une des grandeurs de cet auteur ayant la lucidité de NE PAS tomber dans le piège d'une idéologie pouvant vite surgir de ces interprétations. A la suite du premier Wittgenstein, il admet volontiers qu'il y a certaines choses dont on ne peut parler, il faut les taire. Le théoricien (double du romancier) est alors remplacé - transposé - par le romancier (retour de l'image du romancier). A l'image de romanciers gnostiques contemporains (si je peux les appeler ainsi), à l'image de Dick ou de Pynchon par exemple, il me semble qu'il projette alors l'indicible vérité dans le creuset du mensonge ou de l'illusion : "Le réel était défini par le possible (et non l'être). A l'opposition vérité/mensonge devait se substituer l'opposition possible/impossible." J'ai bien précisé que Piglia jouait sur le possible et l'impossibilité comme définition du réel. A un moment, Piglia retourne cette proposition qui définissait jusque-là son projet. Sur cette question de la vérité et du mensonge, et du possible et de l'impossible, sur la définition du réel, il faudrait étudier de près l'utilisation des temps et des modes temporels que fait Piglia. Les imparfaits, les conditionnels, les présents ne sont pas dus au hasard.
"Le langage tue" est tagué sur le plafond de la cabine d'ascenseur du Majestic (quelle place symbolique !), mais il n'a dans les faits tué personne. De fait ce que propose Macedonio en inventant la machine, c'est l'inverse, c'est la quête des « nœuds blancs », l'éternité par le langage. Même dans la plus sophistiquée des machines, celle de Macedonio, ou celle de Morel, la vérité du réel a une consistance autre que celle du langage. Ainsi, la vérité au cœur du cœur de Macedonio n'est plus le(s) possible(s) exhaustif(s) mais la réalité et l'éternité d'une passion. Elle n'est plus déterminée par le langage et ses jeux, mais par la certitude intime et sa vérité propre. Piglia fait dire à un endroit à Macedonio quelque chose d'essentiel, qui transforme son espèce de roman d'anticipation métaphysique, narratologique, théorique, critique en une pure histoire de passion et d'amour, débordant, enfin et heureusement, les limites du langage, comme une espèce de nouvelle erreur, ou panne dans la machine :
 Notes - Les images de machines, c'est Tinguely gentiment grappillées sur le net, merci à lui. - Demain, en guise de seconde partie à ce papier, nous vous proposerons un entretien avec le traducteur de la Ville absente, François-Michel Durazzo.
Notes - Les images de machines, c'est Tinguely gentiment grappillées sur le net, merci à lui. - Demain, en guise de seconde partie à ce papier, nous vous proposerons un entretien avec le traducteur de la Ville absente, François-Michel Durazzo.
