Lars Saabye CHISTENSEN

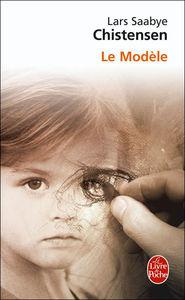
Peter Wihl est un peintre norvégien reconnu. Il prépare sa prochaine exposition qui est prévue pour le jour même de ses cinquante ans, mais se sent stressé, harcelé presque par son agent. Il a un mal fou à peindre, ses toiles n'arrivent pas à se concrétiser comme il les voudrait, il passe de l'une à l'autre, mais les douze toiles, sur leur chevalet, restent inachevées, en attente sans qu'il lui soit possible d'y mettre la touche de pinceau finale.
C'est qu'il doit se renouveler, ce peintre, car le public et la critique l'attendent au tournant, ou tout du moins c'est ainsi qu'il le ressent. Il doit faire évoluer sa peinture tout en y laissant sa "patte" et ne peut pas se permettre de faire la même chose que les corps morcelés qui avaient fait le succès de sa première exposition (Amputations), ni bien sûr moins bien.
Dans cet état d'esprit déjà fiévreux, la mini attaque dont il est victime dans son atelier, et qui le laisse inconscient sur le sol, lui fait envisager le pire, concrétisé bientôt par un diagnostic médical implacable : il va devenir aveugle, sans aucune chance de rémission ou d'arrêt du processus. Ce verdict qui est presque comme un arrêt de mort pour le peintre va réveiller les instincts les plus bas de cet homme déjà fort peu sympathique, égocentrique, mesquin, pas gentil avec ses amis ni avec sa femme... (à tel point qu'on pourrait presque se dire que c'est bien fait pour lui, ce qui lui arrive !).
La rencontre fortuite qu'il fait d'un ancien camarade de classe (détesté à l'époque) devenu ophtalmologue va faire basculer le destin de cet homme. Thomas Hammer est un être malsain et détestable mais peut-être pourrait-il procurer à Peter une solution de rémission, voire de guérison. Les yeux du peintre lui sont vitaux et il ne peut envisager une vie d'aveugle. Étant uniquement tourné vers lui-même, ses propres besoins et désirs, il n'a aucune empathie vers le monde pour imaginer vivre sans voir, pour comprendre qu'on peut aussi ressentir les choses et les gens, les humer, les écouter... Cette terreur de la cécité qui approche à grands pas réveille donc chez cet homme déjà peu attirant des facettes de son caractère plutôt sordides. Jusqu'où ira-t-il pour retarder l'échéance, qu'est-il capable d'envisager, de faire pour changer le cours des choses ? Peter repousse sans s'en rendre vraiment compte les limites morales "normales". On suit avec une curiosité et une angoisse grandissante le destin de cet homme qui va basculer à cause de la maladie, et surtout à cause de la perception qu'il a de cette maladie, de sa lâcheté face à ce mal qu'il n'est pas plus capable d'envisager que de combattre ou d'accepter avec résignation.
Ce roman est absolument passionnant, tant la dérive de l'homme, sa chute lente vers l'horreur est peinte avec précision mais par petites touches qui distillent l'angoisse montante et l'ambiance malsaine. On imagine le dénouement avant la fin, mais ce que l'on devine est tellement énorme, horrible, incroyable, qu'on se dit "non, cela ne peut pas être ça, j'ai du mal lire, mal comprendre", mais finalement on se rend compte que oui, c'est bien ça qui se passe... Ça fait froid dans le dos.

Quelques extraits :
"Six mois plus tôt, il perdait la vue.
Peter Wihl, par un après-midi d'octobre, travaillait dans son atelier, aux peintures destinées à son exposition anniversaire, douze grandes toiles. Vêtu de ses habits de travail, il était prêt pour la guerre : des pieds nus dans des sandales élimées, la longue blouse maculée, une écharpe autour du cou. Il venait de terminer la composition, le fond à proprement parler. Il ne lui restait à présent que l'art. Il se trouvait dans cet élan propice, qui surgit parfois et n'est pas sans rappeler une espèce d'effervescence dépassionnée. La main, obéissante, opérait avec des gestes sûrs. Les pensées étaient claires. Il savait où il devait aller. Il s'agissait simplement de trouver la voie. Décontracté, il évoluait de motif en motif qui, lentement mais sûrement, prenaient forme : des coupes anatomiques, des muscles, une omoplate, un tendon, une phalange. Il n'avait guère le souvenir d'avoir jamais ressenti un tel contrôle ; aujourd'hui, il maîtrisait à nouveau ses ustensiles, aujourd'hui il maîtrisait le travail, en cet instant très précis, alors que le travail était censé s'élever vers l'art, que l'ouvrage, le labeur, s'apprêtait à briller - et cela ressemblait à du bonheur, c'était le bonheur. Mais, soudain, il éprouva une violente douleur dans les yeux, comme si en eux quelque chose se brisait, se craquelait, exactement comme si ses yeux étaient remplis de parasites. Les couleurs se diluèrent les unes dans les autres, les lignes s'effacèrent, la perspective s'éclipsa, sa vue se brouilla, il fut littéralement plongé dans le noir et s'effondra sur le plancher. Cela ne dura pas. C'était déjà parti. Seul l'écho de la douleur lui parvenait, les lourds battements de son propre coeur. Peter Wihl, à genoux, garda longtemps la tête posée, reposée, entre ses mains. Il revint à lui. Tout se remit en place, aussi brusquement que tout s'était cassé en mille morceaux. Il se redressa, lentement, et lorsqu'il se tourna vers les grandes fenêtres il aperçut Hélène et Kaia au fond du jardin, enchâssées dans les encadrements et les croisillons des vitres, dans la lumière évanescente d'octobre - et ce qu'il vit le remplit d'une joie, d'un soulagement si profonds, si vastes, qu'il fut sur le point d'éclater en sanglots, lui qui avait failli franchir le seuil des ténèbres. Assise sur le banc blanc sous le pommier, Hélène, ses cheveux coupés court, ses mitaines violettes, son manteau ocre, feuilletait un texte de théâtre, jamais il ne l'avait vue avec une telle clarté, cependant que Kaia ramassait les feuilles mortes à l'aide d'un râteau beaucoup trop grand pour elle - et là, Peter Wihl songea qu'il n'avait jamais peint ces deux personnes, ni son épouse ni sa fille.
Et peut-être la raison en était-elle la suivante : elles lui étaient trop proches et il n'osait pas.
Il prit son coupe-vent et sortit les rejoindre.
Kaia ratissait toujours, le feuillage formait un cercle jaune autour d'elle.
La branche juste au-dessus de Hélène était grande, à son extrémité pendait une pomme rouge, gelée.
- Qu'est-ce que tu lis ?
- Ce que je lis ? Le Canard sauvage, bien sûr.
- Oui, bien sûr. Tout va bien ?
Hélène posa la pièce et leva les yeux sur lui.
- Qu'est-ce qu'il y a ?
- Rien.
Elle le toisa un petit moment encore.
- Qu'est-ce qu'il y a ? répéta-t-elle.
- Je suis juste un peu fatigué.
Une rafale de vent fit voler les feuilles mortes et Kaia se retrouva au milieu d'une tempête jaune. Peter s'avança vers elle et, ensemble, ils tentèrent de récupérer les feuilles, certaines tout à fait sèches au point d'être réduites en poussière puis de disparaître quand ils les prenaient entre leurs doigts, d'autres humides, qui leur échappaient pour se poser un peu plus loin dans le jardin; comme il était impossible de toutes les ramasser, il finit par s'agenouiller devant sa fille.
Elle avait les yeux verts.
Les yeux de sa mère."
"Il lui demande : si tu pouvais choisir, tu voudrais être aveugle ou sourd ? Et au même moment, Peter se réveilla, avec la réponse du rêve sur le bout de la langue : Ceci n'est pas un choix. Ceci est une menace. Et, tout aussi brusquement, il se rappela les mots singuliers et effrayants de Kaia : tu ne te ressembles pas."
"Peter fut forcé de recourir à l'adjectif dévorant, puisque c'était dévorant, comme si le qualificatif représentait en soit le fléau dans toute sa réalité, comme s'il faisait corps avec sa signification - et Peter pensa, une pensée qu'il se formulait ces derniers temps à intervalles réguliers, que l'être humain ne s'améliore pas avec les années, l'expérience ne fournit aucune garantie, on n'apprend pas de ses erreurs, on ne monte pas d'un cran, car n'était-ce pas plutôt le contraire : à savoir que le meilleur se trouvait derrière lui, qu'il avait fait de son mieux, qu'il avait dépassé les sommets, qu'il fêtait ses cinquante ans dans trois mois et que, à partir de là, il entamait lentement une pente descendante, il dégringolait cruellement vers le bas, qu'il ne lui restait plus qu'à se peinturlurer dans la médiocrité et la nébulosité, dans du réchauffé, embarrassant et sentimental, une sauce brune et épaisse ? Ne valait-il pas mieux, dés lors, s' en dispenser, prendre un congé ad vitam aeternam, dire la vérité crue : à savoir que le meilleur se trouvait derrière lui, prenez, je vous en prie, c'est là-bas que ça a lieu, derrière moi, dans le sillage de ce qu'on appelle communément le passé, le dépassé, l'imparfait, le prétérit, le trépassé ? Oui, ça c'était préférable, ça c'était décent, et pourtant il n'y arrivait pas, il ne parvenait pas à s'en dispenser, à s'empêcher d'essayer de peindre, car chaque fois qu'il plongeait son pinceau dans la couleur et qu'il levait la main, il était un maître, incontestable et souverain, il était un rêveur, branque et concret ; sauf que, voilà, dès que les poils fins et poisseux, extraits du dos d'une martre, s'approchaient de la toile, du croquis représentant Kaia, il redevenait un bouffon, tout disparaissait, tout se désagrégeait entre ses doigts, se volatilisait dans l'air, dans le néant - et c'est là qu'une autre pensée se collait aux précédentes, à ces pensées en cascades, cette réaction en chaîne, cynique, logique et blasphématoire : à savoir que devenir aveugle serait au fond une manière héroïque de ponctuer sa carrière, une telle mort comportait de multiples dimensions, avait un goût de tragédie, et si de surcroît il portait sa destinée en gardant le dos bien droit, avec dignité et style, ces ténèbres pourraient sans nul doute jeter une nouvelle lumière quasi incommensurable sur les toiles qu'il avait eu le temps de peindre et, ce faisant, apporter un contenu à la virtuosité, une humanité à la technique, ses yeux morts posséderaient en quelque sorte une force rétroactive, ils se profileraient dans son oeuvre amputée pour ainsi la magnifier, la parfaire."

