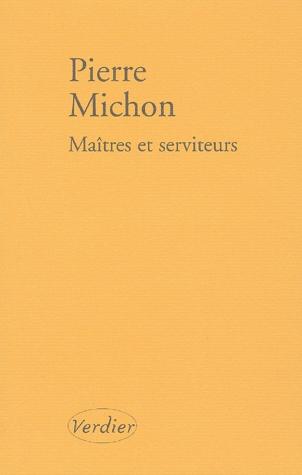
Au risque de vous surprendre, c'est le livre de Pierre Michon que j'ai eu le plus du mal à lire. Sans doute au départ parce que j'ai entamé Maîtres et serviteurs après La Grande Beune et Vies minuscules, deux récits qui ont pour toile de fond le vingtième siècle. Non pas que revenir à des temps plus anciens me rebutent, bien au contraire. En fait, et c'est l'un de ses nombreux talents, Pierre Michon réussit non seulement à se gommer lui-même dans ses écrits mais il offre aussi un récit dont le lecteur peut tout à fait s'imaginer qu'il est d'époque, qu'il est écrit par un auteur disparu de longue date.
Que Pierre Michon s'intéresse à la Révolution dans Onze et nous voilà plongés immédiatement à la fin du dix-huitième siècle français. Et il n'a pas besoin de passer par l'artifice d'un plan général, très descriptif, comme pourrait le faire un réalisateur de cinéma, pour nous signifier qu'il s'agit d'une autre époque. En fait, je pense que cela marche parce Pierre Michon réussit avant tout à entrer dans le système de pensée de l'époque. C'est là, je pense, que l'on peut mesurer le travail énorme de recherche. Mais c'est là aussi que réside pour moi, lecteur, la difficulté.
Maîtres et serviteurs est également un triptyque. Sur les trois panneaux figurent Goya, Watteau et Lorentino.
Goya, c'est l'homme qui « se posait là et attendait son heure, incertain si elle viendrait, patiemment, avec beaucoup de maladresse et autant de panique » mais qui, grâce au destin, va connaître la gloire. Ce « petit coup de dés pipés » s'appelle Francisco Bayeu, homme bien introduit dans les hautes sphères et dont Goya va épouser la sœur, Josefa dite Pepa - « Il était peut-être heureux aussi de m'épouser, moi, je ne sais pas. » -. À la suite de cette union, Goya devient peintre officiel de la Cour, « disciple favori » du peintre allemand Raphaël Mengs et « son dauphin assuré »
Je disais, en introduction à cette chronique que le lecteur est d'emblée plongé dans le siècle de Goya. Il me faut nuancer. Car il y a une narratrice qui pourrait tout à fait être une guide dans un musée. Celui du Prado par exemple. Mais cette narratrice s'efface de temps à autre pour laisser la place à l'écrivain qui reprend donc la main en faisant presque office de témoin oculaire, de contemporain de Goya, peintre à qui il manque décidément quelque chose :
« Peindre c'est travailler comme sur la mer un galérien rame, dans la fureur, l'impuissance : et quand le travail est fini, que le bagne s'ouvre un instant, que la toile est accrochée, dire à tous, princes qui le croient, peuple qui le croit, peintres qui ne le croient pas, que cela vous est venu d'un seul coup, contre votre volonté et miraculeusement en accord avec elle, sans fatigue presque comme un printemps qui vous pousserait au bout des pinceaux, que quelque chose s'est emparé de votre main. »
Plus loin :
« Il n'ignorait pas qu'il savait peindre. Non pas qu'il crût à sa peinture, comme on dit ; non pas qu'il crût désormais à la Peinture, à cela d'inaccessible dont l'absence et le guet l'avaient torturé jadis.»
On est donc ici en pleine recherche michonienne. Recherche d'une métaphysique de l'âme qui ne passe pas donc nécessairement par l'accomplissement d'une satisfaction professionnelle.
D'où cette phrase :
« Pourquoi la peinture ne serait pas une farce puisque la vie en est une. »
Ce qui pose problème à Watteau, deuxième personnage ausculté ici par Pierre Michon, c'est que la peinture ne suffit pas non plus à combler son désir le plus profond :
« Ne pas avoir toutes les femmes lui avait paru un intolérable scandale. »
Autre difficulté qui fut la mienne à la lecture de ce récit : on apprend tardivement l'identité du peintre en question. Car si, dans la première partie, le nom de Goya apparaît très tôt, il n'en est pas de même avec son confrère français. Bien sûr, le narrateur est l'abbé Carreau, curé de Nogent ; bien sûr Pierre Michon évoque les collectionneurs d'art Crozat et Julienne ; bien sûr il nous parle du célèbre tableau intitulé Pierrot...

... il n'empêche : cet effet de retardement est tout à la fois déroutant même s'il stimule encore davantage l'envie de lecture.
Dans le numéro 12 de la revue Siècle, on trouve l'analyse suivante à propos des deux figures précédentes :
« Littérature et peinture sont les partenaires d’une recherche qui s’accentue plus encore, autour du geste d’artiste et de ce qui le fonde. La fascination envers le mythe d’artiste y est déconstruite avec une manière de ramener « la vocation » à des désirs que l’on dirait triviaux : désir de posséder de belles choses, de belles femmes. »
Troisième personnage que nous rencontrons ici : Lorentino, peintre d'Arezzo. Il rencontre un paysan qui lui donnera son cochon en échange d'une toile représentant Saint-Martin.
« Peindre quand on n'est pas le meilleur, qu'il faut pourtant peindre parce qu'on a pas appris autre chose. C'est quand les cieux se déplacent pour vous donner un cochon au lieu de la chapelle du pape Sixte, dans quoi il y a un grand plafond à peindre. »
Il me semble que ce peintre est finalement le seul qui place l'art au-dessus de tout. Peut-être est-ce parce que Lorentino est conscient de ses limites.
Dans Le Roi vient quand il veut, on peut d'ailleurs lire le propos suivant de Pierre Michon :
« Piero della Francesca et Velasquez savent que les arts ne sont que du code. Lorentino s’imagine que c’est un coup de main, la force créatrice. »
Je crois qu'ici Pierre Michon pose la question de l'accomplissement. Le peintre, l'homme de lettres d'ailleurs – puisque chez lui la peinture est un moyen détourné pour parler de littérature – ne sont-ils pas de toute façon condamnés à l'insatisfaction ? Soit parce que l'envie de départ - qui n'a peut-être rien à voir avec l'ambition professionnelle - est plus forte que tout. Soit parce la prise de conscience de ses propres limites oblige à entendre raison et donc à abandonner. Dans les deux il y a en tout cas insatisfaction.
C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre les mots de Saint-Martin qui apparaît finalementà Lorentino :
« Ton tableau vaut un cochon ou la ville de Rome, c'est-à-dire rien. »

