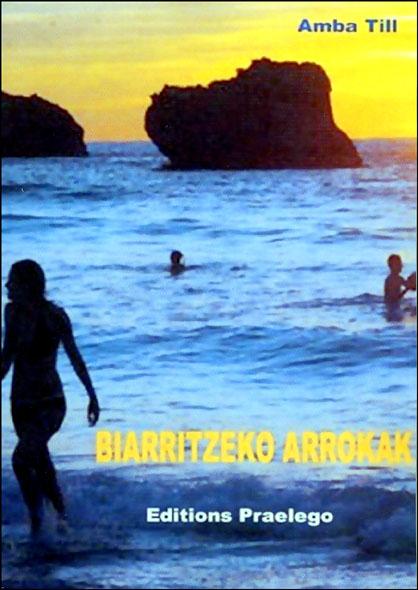 Le roman commence devant un bar pour s’achever à la porte d’une église. Entre ces deux lieux symboliques de notre société se tend en quelques mois l’itinéraire d’une petite fille de vingt ans qui cherche l’idéal pour fuir son enfance et qui ne trouve que la dure réalité mâle des jeux entre garçons. Alice, venue à Paris suivre de vagues études de théâtre, tombe raide dingue d’un militant basque, viril et couturé, assez mystérieux pour la faire rêver avant de l’inquiéter. Mais il sera alors trop tard, l’hameçon du sexe bien ancré dans la chair ; on ne se débarrasse pas impunément d’un beau chevalier qui tient à vous, même en essayant ailleurs tous les plaisirs. Si un roman réussi unit à la fois une histoire qui se tient, des caractères vraisemblables et un style à nul autre pareil, Amba Till a probablement deux points sur trois.
Le roman commence devant un bar pour s’achever à la porte d’une église. Entre ces deux lieux symboliques de notre société se tend en quelques mois l’itinéraire d’une petite fille de vingt ans qui cherche l’idéal pour fuir son enfance et qui ne trouve que la dure réalité mâle des jeux entre garçons. Alice, venue à Paris suivre de vagues études de théâtre, tombe raide dingue d’un militant basque, viril et couturé, assez mystérieux pour la faire rêver avant de l’inquiéter. Mais il sera alors trop tard, l’hameçon du sexe bien ancré dans la chair ; on ne se débarrasse pas impunément d’un beau chevalier qui tient à vous, même en essayant ailleurs tous les plaisirs. Si un roman réussi unit à la fois une histoire qui se tient, des caractères vraisemblables et un style à nul autre pareil, Amba Till a probablement deux points sur trois.
L’histoire. Amba Till aurait pu écrire une tragédie classique entre deux personnages, en jouant sur l’unité de temps et de lieux. Il aurait fallu pour cela qu’elle se décentre de son personnage pour l’objectiver, passant du « je » au « elle ». Elle ne l’a pas senti ainsi, elle n’a pas osé, elle a conservé ce côté fougue qui est certes son meilleur, mais devra être maîtrisé pour rendre toute sa force. Amba Till a choisi le drame romantique plutôt que la tragédie, le bruit et la fureur plutôt que le froid engrenage du destin. Tant de subjectivité fait que son héroïne n’apparaît pas au lecteur comme la victime d’une machine qui la dépasse, mais un choix que son immaturité l’empêche d’assumer. Entre Régis Debray et Michel Houellebecq, Alice/Amba joue du Victor Hugo. Sans le pas cadencé des vers de douze pieds. L’amour fusionnel adolescent est le grand thème du romantisme. Il ne peut durer, d’où le drame. Mais entre Txomin et Régis, le choix se trouve réduit : les filles ne sont-elles vouées qu’à être putes ou soumises ? Txomin commande, du haut de son machisme militant ; Régis consomme, du haut de son plaisir libertin. Et les filles là-dedans ? Ne peuvent-elles devenir des compagnes plutôt qu’objets ou tabernacles ? Le lecteur mâle pense irrésistiblement à ce cliché qui court les casernes : « les filles ? toutes des putes, sauf ma mère (et la Vierge Marie) ». L’histoire réduite à ce choix binaire est un peu courte. Lui manquent quelques personnages secondaires pour la mettre en perspectives : un maître des études de théâtre ? une camarade d’études ? un militant jaloux ? un rival amoureux ? le barman du chapitre premier ? le curé du chapitre dernier ?
Les caractères. « Biarritz. On y va pour s’y baigner, pour y danser », écrivait le jeune Flaubert en parodiant, dès 19 ans, les idées reçues de son temps. La ville vue par Amba Till pourrait être un personnage à part entière. Elle se résume à une plage cernée de récifs (reprise en photo de couverture) dont ‘le rocher des gosses’ représente l’espoir d’un avenir qu’on escalade. Il y a bien longtemps que Txomin se joue le no future, bras croisés lorsqu’il songe à l’avenir (signe de fermeture qui ne trompe jamais les DRH). Ce langage du corps affiche une attitude autiste de refus radical : soit l’apocalypse dans le sang, soit un pays basque pleinement indépendant et réunifié où l’on serait entre soi, parlant cette langue ancienne qui daterait de la préhistoire, reproduisant sans cesse les mêmes gènes depuis la grotte d’Izturitz… Pas de compromis ! La démocratie ? Elle privilégie la concorde dont il n’est pas question ! Même si 95% des Basques ne sont pas d’accord, seule la mort permettra l’idéal. Chiche ? D’où ces lamentations grotesques sur ces pauvres prisonniers politiques à qui l’on met des barreaux aux fenêtres, vous vous rendez compte ? Les mêmes qui viennent de faire sauter une gare en tuant, blessant et choquant des centaines de civils, hommes, femmes et enfants, qui passaient là par hasard. Mais personne n’est jamais « innocent » pour les croyants de quelque cause que ce soit. Amba Till a l’art de mettre les gens devant leurs contradictions et nous fait bien sentir le dilemme militant. Elle s’est documentée sur la cause basque, sa dédicace le prouve, elle a suffisamment maîtrisé ses connaissances pour qu’elles s’intègrent sans heurt dans l’histoire. Ce n’est jamais pesant, sauf peut-être ce cliché qu’il eût fallu dire recopié : « sa prise de conscience face à la problématique » - voilà de la plus pure langue de bois trotskiste ! En revanche, que vient faire dans cette histoire entre basques le troisième personnage, ce parisien et falot Régis, fixé sexuellement par une improbable expérience de voyeur durant sa prime adolescence ? En quoi ce partouzard vient-il faire avancer la passion d’Alice, de son mâle et de la basquitude ? L’itinéraire d’Alice lui-même est flou : pourquoi vient-elle « du Pérou » en parlant un français parfait ? Pourquoi tombe-t-elle amoureuse du pays basque en même temps que de son mec, au point d’en faire le titre ésotérique du roman, de citer Txomin sans préciser comment se prononce le « x » basque en français, et de réciter sans faute, page 21, huit vers de Xalbador sans même daigner traduire ? Y a-t-il des Basques historiques au Pérou ? Une tradition familiale conservée ? Rien de cela n’est dit malgré les détails misérabilistes fort hugoliens sur son enfance. Ecrit probablement au fil de la plume, l’histoire manque un peu de structure, l’utilité des personnages secondaires n’est pas analysée au regard du récit.
Le style. Un bravo pour le direct et l’enlevé, malgré quelques clichés qu’un bon éditeur aurait dû détecter (« respirer la vie », « arrivée au point zéro » (ben vrai ! Pascal aurait sauté de joie), « je n’avais pas de futur » (avoir ou sentir ?), « se noyant dans leur regard » (dans les yeux peut-être, c’est une surface, mais un regard est un acte), « la notion de tragique » (scolaire), « douleur qui me bouffe la vie » (l’existence peut-être, et encore), « l’armée était à feu et à sang » (sic !), « je connus le fond du néant » (quelle présomption !), « j’avais atteint mes limites »…). Quelques naïvetés aussi, comme p.146, s’extasier sur « l’intelligence de ces hommes qui taillaient des tombes en forme de roue, alors qu’ils ne connaissaient pas la roue » : qui dit qu’ils avaient « la roue » en tête plutôt que le soleil et ses rayons ? « La roue » est dans le regard moderne, pas dans le leur… puisqu’ils ne la connaissaient pas. Des incohérences de langage qu’on aurait aimé voir corrigées, telles que ce « soupir d’agacement pour décompresser » (agacement et détente sont incompatibles) ; « aux côtés de mon cercle d’amis » (alors dedans ou dehors ?) ; « charisme dont il était entouré » (le charisme émane de quelqu’un, il n’est pas une couronne plaquée) ; « la peur face à mes yeux » (la peur est un mouvement interne ou le spectacle de la peur des autres, on ne peut pas être « face » à sa propre peur, mais envahie par elle, en interne). Quoi qu’il en soit, ainsi que le disait Flaubert à ses correspondants, ces critiques montrent que je vous ai lue avec attention. Le style est, malgré ces scories de précipitation, celui d’un auteur. Dommage que les auteurs souhaitent toujours publier au plus vite. Citons particulièrement ce chapitre dix, très réussi, où le lecteur découvre une action hallucinée, sur fond de télévision médium.
L’auteur, qui est un être en devenir, devra apprendre à dompter sa cavale et ne pas tout sacrifier à sa subjectivité. « Je continuais à lire les écrivains maudits, tous ces suicidés de la société, dont les œuvres me tombaient sous la main, ils décrivaient la vie comme une blessure… » p.90. Mais non, la vie n’est pas que cela, celle entre 16 et 26 ans ne dure jamais. Je précise que je ne connais pas Amba Till, seulement via son blog, en favori sur Fugues ; contrairement à certains blogueurs, nous ne nous sommes jamais vus. Au total, vous lirez ce roman d’adolescence avec la passion mise pour l’écrire ; elle vous prend. Vous serez initiés à la cause basque, sa beauté et ses impasses, bien mieux que par les lamentations rituelles des journaux.
Amba Till, Biarritzeko arrokak (La nuit basque), édition Praelego, 2009, 175 pages.

