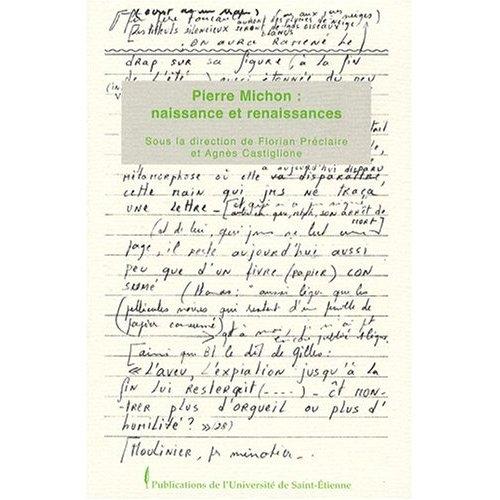Si vous êtes des lecteurs réguliers de ce blog, vous vous souviendrez certainement qu'au mois d'avril dernier j'ai consacré une série de douze chroniques à Hubert Nyssen. J'avais en effet jugé indispensable de revenir sur son œuvre avant de poster l'interview qu'il m'avait très gentiment accordé au Paradou. L'expérience fut tellement passionnante qu'elle me donna l'idée de poursuivre l'entreprise avec d'autres Hommes de Lettres.
Que les choses soient claires. Je ne prétends nullement à une quelconque objectivité dans cet exercice. Au contraire, je revendique un point de vue totalement subjectif, ce qui rend possible l'erreur de jugement.
Cette fois, c'est Pierre Michon qui s'est prêté, vendredi 24 juillet à Paris, au jeu des questions/réponses. Son dernier opus, Les Onze, paru chez Verdier, est sorti en avril.
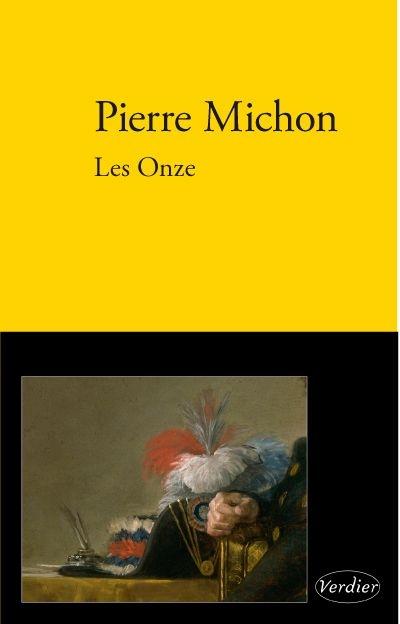
Comme pour ses précédents livres, Pierre Michon refuse de parler de roman. Il préfère parler de récit ou tout simplement de texte. On les distingue d'emblée par leur brièveté. Dans Pierre Michon : Naissance et renaissances - voir plus bas les ouvrages auxquels je me référerai souvent dans cette série de chroniques – l'auteur parle de « sorte de percolation. C'est comme pour la café : on met la poudre de café, l'eau bouillante... et tout à coup, il y a des petites gouttes ». Il s'agit là d'un acte politique – « faire du bref, c’est aussi, idéologiquement, échapper au piège de la production, de la libre entreprise, du marché » -. Le lecteur se retrouve ainsi face à un texte dense, compact, déroutant.
Déroutant, oui. Pierre Michon semble éprouver à un grand plaisir à, sinon semer son lecteur, du moins à lui faire perdre ses repères. Cela passe par une utilisation très personnelle des mots, ce que lui-même confirme d'ailleurs dans Le Roi vient quand il veut : « Bergounioux et Gracq utilisent le glossaire exact qu'à bon escient, moi je l'utilise à ma fantaisie et d'ailleurs de manière souvent métaphorique, d'un mot rare pour désigner un geste professionnel. J'utilise le mot par effraction, pour sa sonorité, parce qu'il fait image, ou parce qu'il atteindra violemment le lecteur. J'en fais un coup de poing, pas un acte intellectuel. »
Les Onze, comme tous les autres livres de Pierre Michon, se résume brièvement. Cela n'est pas très étonnant quand on sait en plus que l'intrigue est « seconde » pour l'écrivain. Il est question ici d'un peintre, François-Elie Corentin, surnommé le Tiepolo de la Terreur, qui va réaliser un tableau où figurent les onze membres du Comité de Salut Public. Le nom de Corentin peut paraître familier à des non-spécialistes du troisième art mais qui sonne parfaitement dix-huitième siècle. Et comme le lecteur n'a pas envie de se laisser impressionner par un savoir encyclopédique, fût-il celui de Pierre Michon, il entre de plain-pied dans le livre, il fait confiance au texte.
Ça commence à Wurtzbourg. Levez les yeux et regardez les plafonds de la Kaisersaal nous dit Pierre Michon dont on a souvent souligné l’intérêt pour la verticalité – j’en reparlerai dans la chronique consacrée à La Grande Beune -. Dans cette splendeur il y a, presque caché, Corentin alors âgé de vingt ans, peint par Tiepolo. On remarque d'emblée le double mouvement de focale. L'auteur embrasse tout puis resserre le champ de vision jusqu’à ce que nous « découvrions » le personnage en miniature, être « minuscule » - référence aux Vies minuscules, premier livre de Pierre Michon – qui « apparaît » aussi dans Le Serment du jeu de Paume, la célèbre toile de David.
Facétieux Pierre Michon qui aime, comme toujours, se jouer de son lecteur en multipliant les commentaires du narrateur, ce « on », indéfini, qui sonne comme un « nous » comme pour mieux faire corps avec son lecteur, mieux l'embobiner aussi :
« On peut penser qu’il ne le remarquait pas. »
Pierre Michon va même plus loin dans l’extrait suivant, en jouant avec l’authentification, la soit-disant vérité de la biographie car il s'agit ici d'un portrait :
« On sait bien que la plupart du temps François Corentin n’était pas là. Les mille biographes dont je m’inspire librement sont bien en peine de le faire paraître à Combleux ; et je n’ose pas m’inspirer des bons faiseurs de romans qui nous les montrent, en perruque et bas blancs, ayant soustrait pour quelques heures l’enfant à l’amour dévorant des femmes, le tenant par la main et s’éloignant là-bas avec lui sous des saulaires vers Chécy, lui nommant les arbres, les bateaux, les auteurs ; lui nommant les lois parmi lesquelles le Grand Être avec ses créatures s’ébattent, la mécanique d’envol des corps célestes, la chute passionnée des corps graves, qui sont inexplicablement mais admirablement la même loi ; lui évidant tout le fil blanc de la pensée de son siècle. »
On accroche d’autant mieux à cette entreprise d’authentification que le narrateur nous dit où l’on peut trouver cette toile, au Louvre. Sauf que tout cela est faux. François-Elie Corentin n’a jamais existé, il n’a jamais peint Les Onze. Tout cela relève de ce que certains critiques littéraires nomment la « mythobiographie » y compris quand, dans une sorte de « récit dans le récit » Pierre Michon fait intervenir l'historien Michelet dont la voix donne vie au tableau :
« Les douze pages de Michelet sur Les Onze, dans le chapitre III du seizième livre de L’Histoire de la Révolution française, ces douze pages extrapolées, ce roman, a été pris pour argent comptant par toute la tradition historiographique ; il traîne partout et est diversement traité par toutes les chapelles qui ont commenté, vilipendé ou célébré la Terreur. »
Il faut s’interroger sur la démarche qui consiste à écrire sur la peinture. Nous le verrons ultérieurement, ce n’est pas une première chez cet écrivain : « la peinture est une métaphore de la création littéraire », dit-il, « c'est-à-dire qui présentifie le monde et non pas qui l'abstrait, l'évacue. » La penture est donc une déviation, une « connaissance oblique » pour parler d’autre chose, à savoir la littérature. Et la littérature, chez Pierre Michon, est haute, métaphysique. Difficile à atteindre donc. En tout cas, pour y arriver, il faut d'abord accepter sa petitesse. La phrase suivante me semble être une illustration de ce rapport. L'écrivain donne en fait l'impression de parler de lui-même :
« Il arrive que les Limousins choisissent les lettres, les lettres, elles, ne choisissent pas les Limousins. »
Pourtant, dans ce livre, j'ai l'impression que Pierre Michon revient à la fois sur les vertus qu'il attribuait jusque-là à la peinture ...
« Il ne s’agissait plus d’opinions, mais de théâtre ; cela arrive souvent dans la politique ; et cela arrive toujours, dans la peinture, quand elle représente la politique sous la forme très simple d’hommes : car les opinions, cela ne se peint pas ; les rôles, si. »
... mais aussi à la littérature ...
« J'ai pensé, quand j'étais adolescent, que l'art – ce qui si longtemps on a appelé l'art – allait me servir à trouver une vérité telle que les religions proposaient d'en livrer. Et je me rends bien compte maintenant – comme la civilisation occidentale en général – que l'art, si effectivement il peut nous aider dans nos expériences individuelles, et dans la grande résonance du langage pour la littérature, ne nous amènera pas à une vérité, refusée. Aucune vérité ne naîtra des textes littéraires. »
Ailleurs :
« Jamais un portrait écrit n’atteindra, bien sûr, à l’effet d’immédiateté massive du portrait peint, à cette espèce d’assomption de l’Immanence. Mais l’écrit a aussi des avantages : par exemple, dans un texte, on peut laisser visibles ce que les peintres appellent repentirs, les ébauches, les hésitations, tout ce qui précède et fonde la version définitive. »
Pour moi – je ne sais pas d'ailleurs si Pierre Michon sera d'accord avec cette interprétation - Les Onze est avant tout une prise de conscience. Et en ce sens, il marque, à mes yeux, une très nette rupture avec les livres précédents. Comme si l'auteur cessait désormais de considérer l'art comme une figure tutélaire, paternelle, ce père qu'il n'a pas eu mais constamment introduit dans ses écrits, via le christianisme, cette religion dont le père est absent mais toujours là.
« Le père absenté donc divin ? Certainement. (...) Il y a le fait que la littérature m'a toujours paru être de la prière pure. Tous les textes que je connais par cœur, c'est de la prière; J'envisage la littérature comme un essai pour se mettre en communication avec le genre humain mais en passant par un tiers absolu qui est le divin. »
Dans Les Onze « qui vise à dire à la fois la figure du politique et la représentation du politique », il y a – je pense – un mouvement, une avancée formidable qui souligne l'accès de Pierre Michon lui-même au rang de figure tutélaire. Et cette accession est rendue possible par le fait qu'il y a eu meurtre symbolique.
Corentin « a mis la figure de son père sous la forme des onze tueurs du roi, du Père de la nation – les onze parricides, comme on appelait alors les tueurs du roi. »
L'écrivain a trouvé et perdu un père. Il a tenté de « s'équivaloir » à lui.
Il y est arrivé.