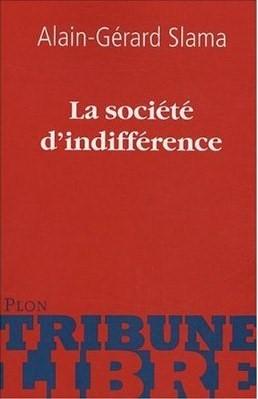 Professeur à Science-Po, politologue averti, Alain-Gérard Slama vient de signer un implacable réquisitoire contre le « reniement culturel dont souffre la société française », en d’autres termes contre l’abandon progressif des valeurs républicaines issues des Lumières. Le principal responsable de cet abandon serait Nicolas Sarkozy qui n’est jamais nommé, mais dont la figure transparaît en filigrane tout au long des pages de cet essai brillant, aux vertus pédagogiques, dont le style, en outre, ne manque pas d’élégance.
Professeur à Science-Po, politologue averti, Alain-Gérard Slama vient de signer un implacable réquisitoire contre le « reniement culturel dont souffre la société française », en d’autres termes contre l’abandon progressif des valeurs républicaines issues des Lumières. Le principal responsable de cet abandon serait Nicolas Sarkozy qui n’est jamais nommé, mais dont la figure transparaît en filigrane tout au long des pages de cet essai brillant, aux vertus pédagogiques, dont le style, en outre, ne manque pas d’élégance.
Ce livre, La Société de l’indifférence (Plon, 236 pages, 18,50 €) ne s’apparente ni à un recueil de déplorations stériles, ni à un pamphlet gratuit, encore moins à un libelle ; éditorialiste au Figaro Magazine et à France-Culture, l’auteur n’est pas un homme de gauche apte à succomber à la tentation d’un anti-sarkozysme primaire : il se définit comme « un républicain modéré, plutôt proche de la majorité au pouvoir ». La portée de son propos critique n’en est que plus grande.
Alain-Gérard Slama se livre d’abord à un constat : l’inquiétante indifférence avec laquelle l’opinion publique accueille, depuis quelques années (depuis mai 2007 surtout), les entorses de plus en plus nombreuses à « des principes considérés naguère comme inviolables » de notre modèle républicain. Cette atonie nous concerne tous, à commencer par les élites françaises et, n’hésite-t-il pas à écrire, par « les républicains modérés de droite [qui] aggravent les facteurs de crise en abandonnant aux seules minorités actives et aux formations extrêmes les manifestations de la vigilance civique. » Quelles sont ces entorses ?
Dans un premier chapitre, l’auteur dénonce une rupture du pacte constitutionnel qui régissait la répartition des rôles entre Président et Premier ministre ; rupture consacrée par une « petite phrase » significative dans laquelle celui-ci était qualifié de « collaborateur » par celui-là, surnommé, par voie de conséquence, dès le chapitre suivant, le « Prince-PDG », compte tenu de sa « conception tout entrepreneuriale de la politique. » Un développement qui intéressera autant l’amateur d’histoire constitutionnelle et politique que le simple citoyen, permet à Alain-Gérard Slama d’analyser la distribution des responsabilités des deux têtes de l’exécutif sous la Ve République (définies aux articles 5 et 20 de la Constitution). Ce faisant, il s’inquiète de l’effacement récent du chef du gouvernement au profit d’un Président concentrant tous les pouvoirs entre ses mains, jusqu’à celui de « donner son opinion sur tout, notamment sur les livres ou les spectacles qui sont bons pour le public et ceux qui ne le sont pas – comme on a pu le vérifier à l’occasion de ses déclarations sur l’inutilité de La Princesse de Clèves ou sur l’ennui du théâtre de Jean-Luc Lagarce ».
Il est vrai que le passage du septennat au quinquennat, et le choix d’un calendrier électoral faisant suivre la présidentielle par les législatives, ne pouvaient que faciliter une présidentialisation de la fonction ; pour autant, l’absence de réels contrepouvoirs tels qu’ils sont organisés dans un régime présidentiel classique, accentue nécessairement le phénomène. Certes, en matière de primauté de fait du chef de l’Etat sur son Premier ministre, on pourrait opposer à l’auteur la période gaulienne (le Général s’abstenant cependant de s’occuper de l’intendance ou de déconseiller des lectures…) On pourrait encore évoquer la démission de Jacques Chaban-Delmas, obtenue par Georges Pompidou en juillet 1972 alors que le maire de Bordeaux avait provoqué et obtenu un vote de confiance de l’Assemblée trois mois auparavant, mais il appert que ce départ était moins dû à une volonté d’hégémonie du Président qu’à une réaction contre la tentative du Premier ministre de s’imposer bon gré, mal gré.
Deux autres entorses aux principes républicains prennent leur source, selon l’auteur, en 1991, lorsque François Mitterrand, à l’occasion de la guerre du Golfe, demanda aux « hiérarchies des trois principales religions de s’accorder pour pacifier les esprits », supposant ainsi que « les Français musulmans et juifs réagissaient en tant que communautés et qu’ils privilégiaient leurs obédiences religieuses par rapport à l’intérêt de leur nation ».
De cet appel au religieux, découlent, surtout depuis deux ans, des « viols répétés » de l’intégrité laïque de la République que l’on aurait d’ailleurs pu pressentir à la lecture de l’ouvrage publié en 2004 par Nicolas Sarkozy, La République, les religions, l’espérance. Citant plusieurs extraits du livre, Alain-Gérard Slama établit un parallèle entre ceux-ci et le discours du Latran qui insistait sur le caractère « indispensable » d’une formation spirituelle - la formation appuyée sur des valeurs temporelles (celle de l’instituteur) étant jugée insuffisante. Ces noces contre nature, dans le cadre des valeurs des Lumières et de la loi de 1905, de la République et du religieux n’ont rien d’innocent ; elles pourraient même être assez lourdes d’arrière-pensées :
« […] la religion est convoquée par le pouvoir pour son utilité sociale : comme l’affirme assez cyniquement le discours du Latran, ʺun homme qui croit, c’est un homme qui espère. Et l’intérêt de la République, c’est qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes qui espèrent.ʺ
Une telle condamnation de l’insuffisance de la raison pour fonder une morale, une telle instrumentalisation de la religion, considérée comme garante de l’ordre social, correspondent à une idéologie qui porte un nom : l’ordre moral. »
Ceux, nombreux, qui demeurent attachée à laïcité à la française désespérait sans doute d’entendre cela un jour, dans un contexte où, depuis plusieurs années, s’établit dans l’indifférence générale « l’encadrement efficace des populations » et où l’on « cherche à donner un fondement moral » à « la mise en œuvre de lois sociales destinées à protéger les citoyens contre eux-mêmes en normalisant leur conduite ». Et l’auteur de nous alerter sur notre complaisante léthargie, alors que d’autres pays, confrontés aux dangers des intégrismes, cherchent une inspiration dans ce qui fut jusqu’à présent notre modèle :
« Ce qu’il [le Président] appelle ʺlaïcité positiveʺ, en conclusion de son discours, est la collaboration des Eglises et de l’Etat pour partager le magistère des consciences. Qu’une telle régression vers la philosophie d’ordre moral du XIXe siècle passe inaperçue, ou ne suscite, parfois, qu’un léger malaise, voire soit approuvée sans examen, quand elle n’est pas accueillie comme une aimable lubie, apporte au moins une certitude : s’il est incontestable que nos concitoyens souffrent d’une méconnaissance de l’histoire des religions, c’est d’abord et surtout l’histoire de la laïcité qui devrait leur être enseignée ».
Et de nous prévenir enfin du danger bien réel d’un encouragement apporté « en direction de tous les nostalgiques de l’ordre moral et des fondamentalistes de toutes les religions qui rêvent […] de prendre leur revanche sur l’héritage des Lumières » et d’un autre danger, celui de la confrontation des « vérités » : « Toute religion prétend détenir la vérité […] il n’y a, dans l’espace public, pas de place pour plusieurs vérités ensemble et mieux vaut, autant que possible, les éloigner toutes plutôt que d’assister dans l’impuissance à leur affrontement. »

« la notion d’identité est totalitaire : elle enferme le sujet dans une appartenance, une religion, une différence, qui le totalisent, qui prétendent le définir tout entier et dont à chaque instant il doit répondre. Elle est le fourrier de l’Inquisition et des procès en sorcellerie. Le thème de l’identité nationale, tel qu’il a été lancé au printemps 2007, tombe dans le même piège que ʺla laïcité positiveʺ : il transgresse la règle de séparation des ordres, qui interdit au politique de sortir de son champ de compétence pour régner sur les consciences […] ».
Plus généralement, cette notion d’identité sous ses formes les plus diverses (l’inné semblant l’emporter sur l’acquis) se trouve promue jusqu’au sommet de l’Etat. L’auteur cite à ce sujet l’entretien « assez terrifiant » entre Michel Onfray et le candidat de l’UMP à la présidence dans lequel ce dernier confiait sa conviction « qu’on nait pédophile » et que les jeunes qui se suicident chaque année avaient « génétiquement une fragilité, une douleur préalable » avant de conclure : « la part de l’inné est immense ». Cette opinion s’inscrit, précise Alain-Gérard Slama, dans l’ordre moral paternaliste qu’il dénonce : « la dichotomie des bons et des méchants, dans la vision innéiste de l’identité, divise l’ensemble de la société entre les élus et les damnés ».
Enfin, l’auteur s’attaque à la discrimination positive qui « créé des inégalités au bénéfice de quelques-uns [et] déplace l’injustice au lieu de la combattre ». Naturellement, le propre de l’ordre moral est de présenter sa face de méduse (je reprends ici un mot que Thierry Maulnier avait utilisé pour parler du communisme en 1951) dissimulée derrière le masque rassurant de l’intérêt général, mais, ainsi que l’écrit l’auteur, « une société qui viole les principes sur lesquels elle repose, même au nom de fins justes, ne peut pas être une société juste. […] Octroyer la satisfaction d’un statut particulier à un groupe, c’est en fabriquer mille. »
Pour nous faire sortir de notre torpeur, nous inciter à retrouver notre vigilance républicaine, Alain-Gérard Slama mobilise tout son talent et en appelle au primat de la liberté - un langage qui n’est (hélas!) plus très courant. Et une belle leçon de démocratie de la part d’un homme qui n’appartient précisément pas à la catégorie lassante des donneurs de leçons. Quelles que soient les opinions politiques du lecteur, celui-ci trouvera dans cet essai décapant, érudit, bien rythmé, d’où l’humour piquant n’est pas absent, matière à réflexion.
Illustrations : Alain-Gérard Slama (D.R.) - La Séparation de l’Eglise et de l’Etat (journal Le Rire, Mai 1905) - Parodie d’une affichette - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

