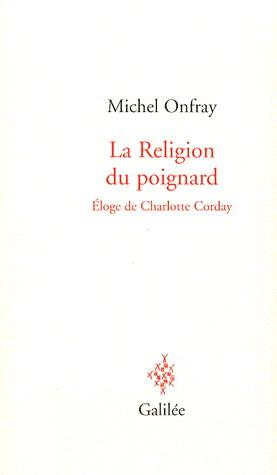 Lorsque Michel Onfray s’attaque avec talent aux excès de la Révolution française, cela saigne. Son essai, La Religion du poignard (Galilée, 80 pages, 15 €) prend résolument le contrepied du mot de Clémenceau qui avait affirmé que la Révolution était « un bloc », en d’autres termes que l’on ne pouvait dissocier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les massacres d’innocents perpétrés dans les années qui suivirent.
Lorsque Michel Onfray s’attaque avec talent aux excès de la Révolution française, cela saigne. Son essai, La Religion du poignard (Galilée, 80 pages, 15 €) prend résolument le contrepied du mot de Clémenceau qui avait affirmé que la Révolution était « un bloc », en d’autres termes que l’on ne pouvait dissocier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les massacres d’innocents perpétrés dans les années qui suivirent.
Le livre, court, mais dense et impitoyablement ciselé, s’ouvre sur une scène de cannibalisme. En mai 1789, une famine touche la paisible ville de Caen. Lucide et iconoclaste, Onfray note : « Les révolutions ne se déclenchent pas à la lecture du Contrat social de Rousseau, De l’esprit des lois de Montesquieu, encore moins de l’Ethocratie du baron d’Holbach… Elles montent des rumeurs anonymes de la rue quand les miséreux, contraints par leur état, ne peuvent plus autre chose que demander la fin de leur malheur, quel qu’en soit le prix, par n’importe quel moyen. Le peuple ne veut ni la Liberté ni la République, il souhaite manger à sa faim, sans plus. »
Les spéculateurs profitent de la situation pour s’enrichir, les autorités locales cherchent à détourner les stocks de grain à des fins personnelles, la population attaque donc le château et s’offre une victime expiatoire en la personne d’un jeune vicomte arrogant et antipathique. Le corps est dépecé, il sera grillé et mangé par un peuple chauffé à blanc, ivre de sang. Ecce homo : être humain en tant qu’individu, le phénomène de groupe le transforme en monstre incontrôlable, en fauve enragé ; le bouc-émissaire perd toute humanité, se trouve réduit à l’état de pièce de boucherie. « La Révolution française dispose de son banquet totémique », remarque l’auteur. Le rituel écœure, mais il ne constitue pas un cas si isolé qu’on pourrait le croire. Dans son récent roman, Mangez-le si vous voulez (144 pages, Julliard, 17 €) Jean Teulé raconte une affaire identique de barbarie cannibale qui s’est déroulée dans le village d’Hautefaye, en août 1870, contre une autre victime expiatoire livrée à la vindicte d’une foule déchaînée. A Caen, le peuple, devenu populace par l’atrocité de son crime, ne s’en tiendra pas au barbecue ; il plantera la tête du vicomte sur un pic et ira l’exhiber sous les fenêtres de l’Abbaye-aux-Dames, dont sa tante est l’abbesse. A l’intérieur de l’abbaye, se trouvait une certaine Charlotte Corday.
Dans son essai, Michel Onfray assassine une seconde fois Marat. La rapide biographie 

Au fil des pages, Michel Onfray dresse l’exégèse de son geste, décrit la scène – la baignoire, le poignard – évoque son procès et son exécution. Il rapporte les propos de Sanson, le bourreau, qu’elle impressionnera par son courage. Dans ses Mémoires, il la qualifiera de « martyre de la liberté » et de « Jeanne d’Arc de la démocratie ». En montant sur l’échafaud, elle n’avait que vingt-quatre ans, un âge où la mort engendre la légende.
La Religion du poignard vaut d’être lu. Le propos, la concision avec laquelle il est exprimé et la vivacité du style, donnent toute sa force au livre. On est bien loin, dans ces pages, des truismes lénifiants, des révoltes de salon, des autocongratulations et des leçons de morale que nous assènent régulièrement les philosophes germanopratins, médiatisés et cyniques. En assassinant Marat, renouant avec le symbole du tyrannicide, Charlotte Corday pensait mettre fin aux exécutions sommaires de la Terreur. Il n’en fut rien. Cependant, comme le remarque l’auteur : « son geste fut politiquement nul, mais moralement sublime. » Il voit en elle une femme libertaire, une épithète qui demanderait probablement un développement supplémentaire. Elle n’en reste pas moins une héroïne française - autant qu’universelle dans sa lutte contre la tyrannie - trop peu connue dont la mémoire méritait cette réhabilitation.
Illustrations : Jean-Paul Marat, gravure - Charlotte Corday, gravure - Barbara Schreiber, What’s on your mind, dear?, acrilique sur papier, 2004 (© DR).

