 Les clichés et autres idées reçues concernant Andy Warhol (1928-1987) le poursuivent jusqu’au XXIe siècle, au-delà de la tombe. Artiste « commercial », « cynique », « mystificateur », voire « imposteur », la liste des épithètes peu amènes est d’autant moins limitative que le peintre lui-même s’était attaché à revendiquer certains de ces qualificatifs, parfois avec sincérité, souvent pour brouiller les pistes. Comme Baudelaire avant lui, en adepte du dandysme, il savourait ce que Charles Asselineau avait nommé « l’esthétique de l’étonnement. »
Les clichés et autres idées reçues concernant Andy Warhol (1928-1987) le poursuivent jusqu’au XXIe siècle, au-delà de la tombe. Artiste « commercial », « cynique », « mystificateur », voire « imposteur », la liste des épithètes peu amènes est d’autant moins limitative que le peintre lui-même s’était attaché à revendiquer certains de ces qualificatifs, parfois avec sincérité, souvent pour brouiller les pistes. Comme Baudelaire avant lui, en adepte du dandysme, il savourait ce que Charles Asselineau avait nommé « l’esthétique de l’étonnement. »
Dans son œuvre considérable, les portraits cristallisent sans doute les critiques les plus virulentes : Warhol, peintre des célébrités du spectacle et de la politique, des têtes couronnées, des milliardaires, et surtout Warhol portraitiste de tous ceux qui étaient capables de débourser 25.000 $ ! Voilà une réputation qui n’attire guère, au premier abord, la sympathie des bien-pensants. A cela, il convient d’ajouter une source supplémentaire de suspicion : la technique qu’il avait développée, un processus mécanique qui lui permettait de produire en série, de multiplier les images à l’envie et à peu de frais. A ses « clients », il n’hésitait pas à proposer un second portrait au prix réduit de 15.000 $, suivant la méthode bien connue des marchands de meubles pour pousser à l’achat d’un second canapé pleine fleur… Tout cela ne semblait pas très sérieux.
L’exposition Le Grand monde d’Andy Warhol, organisée aux Galeries nationales du Grand-Palais jusqu’au 13 juillet, loin de confirmer ces préjugés, s’attache à réexaminer et revisiter son art du portrait, à travers 360 peintures et documents. On ne peut comprendre la démarche de Warhol sans appréhender sa technique, laquelle commençait toujours par une séance de maquillage de son modèle, suivie d’une prise de clichés photographiques obtenus à l’aide d’un Polaroïd « big shot ». Les nombreux documents préparatoires présents à l’exposition jouent donc un rôle capital ; ils permettent de suivre toutes les phases de l’élaboration de ses portraits. A partir des photographies, le peintre s’attachait à corriger, à gommer, à épurer l’image, à l’amputer de ses détails inutiles pour ne saisir que la quintessence de l’être. Suivait une seconde phase de réalisation, décrite en détail par le directeur scientifique de l’exposition, Alain Cueff, dans un essai qui vient d’être publié et constitue un complément utile au catalogue, Warhol à son image (Flammarion, 224 pages, 23 €) :
« Le processus photosérigraphique est très simple. Sur un tissu de soie imprégné d’une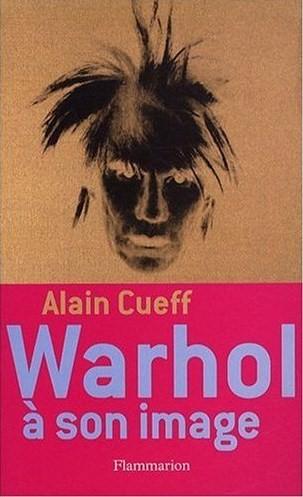
Après avoir repéré les contours de l’image sur la toile, esquisse fantomatique, Warhol peint le fond, en appliquant les couleurs correspondant à chaque zone. Ensuite seulement, il sérigraphie l’ombre. Quand l’écran est appliqué sur la toile, l’ombre apparaît au gré d’une pression plus ou moins soutenue de la règle qui force l’encre à travers la maille fine du tissu et fixe les formes encore abstraites de la peinture. Ce processus inverse celui de la peinture d’icône tel que le décrit Jean Chrysostome. »

Si l’exposition met l’accent sur les portraits, elle se destine surtout à lutter contre les réticences très répandues d’une partie de la critique qui ne voyait en eux qu’un art strictement commercial. Faut-il le rappeler, pour nombre de peintres, bien avant Warhol, le portrait ne comptait qu’à un titre alimentaire. Il s’agissait pour eux de financer par cette activité spécifique et souvent lucrative l’essentiel de leur œuvre. A titre d’exemple, en 1866, Gustave Courbet, en séjour à Deauville chez le comte de Choiseul, se félicitait de recevoir de nombreuses commandes de portraits de la part de la société dorée qui y passait ses vacances. Or, il ne viendrait à personne l’idée de voir dans le maître-peintre d’Ornans un artiste strictement mercantile.
Par ailleurs, si la technique de Warhol fait appel à la machine, elle n’en reste pas moins une technique artistique. Il suffit d’examiner attentivement les séries de portraits exposés pour se rendre compte qu’ils ne présentent qu’une uniformité de façade. De nombreux détails diffèrent, qui proviennent, contre toute attente, du procédé mécanique même, comme le souligne Alain Cueff :
« Tel est, paradoxalement, l’un des grands avantages de la machine : elle reste imprévisible dans le rendu des détails, puisque le repérage initial est approximatif, mais l’étendue de ces accidents est assez limitée pour éviter toute dérive. »
Il serait donc plus juste de parler ici de « variations sur un même thème » que de simples reproductions en série ; un travail bien plus complexe qu’on ne l’aurait imaginé.
Du « grand monde », il est certes question : Liz Taylor, Marilyn, Jackie Kennedy, Giovanni 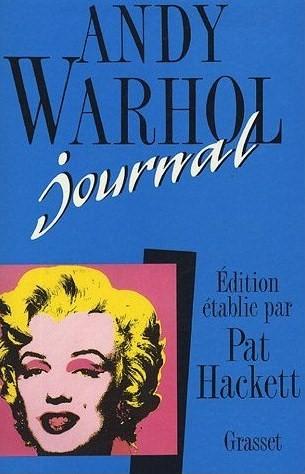
Enfin, des documents préparatoires, apparaît une autre face de Warhol : le travail de l’artiste qui ne se limitait pas à un simple procédé industriel. Dans le processus, le choix tenait la plus grande place, un choix qui revenait forcément au peintre : sélection des photos, recadrage, corrections des clichés, choix graphiques et chromatiques. De cette approche, la densité des personnages représentés se modifie considérablement. La salle dédiée aux portraits de Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie, en est la parfaite illustration.
Aux amateurs désireux de mieux connaître l’artiste, outre l’essai d’Alain Cueff et le catalogue de l’exposition (RMN, 367 pages, 45 €), je conseillerai volontiers son Journal (Grasset, 792 pages, 29,80 €). Cet étonnant document fut tenu par Warhol de novembre 1976 au 17 février 1987 – il mourra le 22 février. On y découvre une belle galerie de portraits de ses contemporains, d’inévitables commérages, un témoignage au quotidien où l’auteur se présente à la fois acteur et spectateur de sa propre vie. Un livre drôle et cruel, cynique, léger et grave, à l’image de son œuvre peint.
Illustrations : Autoportrait, 1986, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, © 2009 Andy Warhol Foundation for the visuals arts inc / Adagp - Debby Harry, collection particulière, © 2009 Andy Warhol Foundation for the visuals arts inc / Adagp.

