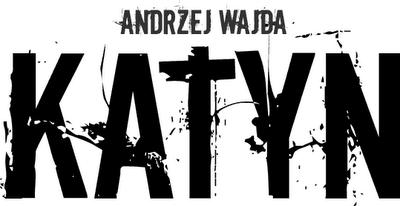
Curieux, l'accueil réservé dans la presse à Katyn, d'Andrzej Wajda. Le Monde s'incline respectueusement, avec l'air un peu forcé du gosse qui doit aller embrasser un vieux grand-père qui pique. A côté de ça, il y a les un peu moins sages, qui n'hésitent pas à râler à voix haute - Télérama par exemple, apparemment Pierre Murat n'a pas détesté, mais, attention, ça n'engage que lui, il ne répond pas de la réaction d'un lycéen de base (!). Puis il y a les carrément mauvais, qui achèveraient bien la vieille baderne (copyright Jean-Luc Mélenchon, pour cette expression dignement employée à la mort de Soljenytsine.) C'est l'Huma et les Inrock qui tiennent ce classieux rôle.
"L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part." (Alfred Jarry)
Bref, on a compris que ce devoir de mémoire-là emmerde tout le monde. Et comme c'est la Pologne, on a le droit de le dire tout haut. Jean-Baptiste Morain, inrockuptible de son état, reproche au film sa "religiosité". Supposons que le journaliste, qui n'a surement rien contre la religion des Polonais - Dieu préserve la presse d'un tel travers -, veut désigner par là un aspect pompeux de la mise en scène. Ce monsieur a cru toucher le marbre d'un monument aux morts et ça l'a refroidi. Qu'il se rassure, le marbre n'est pas encore un matériau indigne, tout juste bon pour un "académisme empesé", on en a déjà tiré de plutôt belles choses, par le passé.
Toute scandaleuse qu'elle soit, cette forme de silence sur ce qui fait l'intérêt du film (rien, il me semble, dans les Cahiers ou Positif) détient sa part de logique. Car c'est un peu ce que ça raconte: l'histoire d'une nation simplement niée pendant plusieurs décennies. La première scène représente une situation emblématique du passé de la Pologne. Une foule qui, sur un pont, fuit dans un sens les Allemands, dans l'autre les Russes. Les deux vont s'entendre, c'est l'époque du pacte, sur un partage de la Pologne, de ses prisonniers et de ses réfugiés. Au-delà de l'évidence géopolitique du pays pris entre deux grandes puissances, il y a une nation destituée de sa fierté, de son armée et, plus important encore, de sa langue.

C'est par ce biais que Wajda traite la situation, notamment dans la première partie du film. On entend le Polonais continuer timidement à se glisser entre deux phrases russes ou allemandes, mais en vain: ce sont les langues du totalitarisme qui décident. C'est-à-dire la langue de bois. Car l'Allemand et le Russe ont ceci de commun, dans Katyn, qu'elles sont là pour sommer la réalité de produire les effets voulus. Le comble, ce sont les nazis essayant de faire croire à la vérité (que les Soviétiques ont perpétré le massacre) par un film de propagande - soufflant par là la méthode aux adversaires. Même ceux des envahisseurs qui ne sont pas les assassins de ce massacre-ci, les Allemands, ne veulent pas de la vérité nue, ils veulent la vérité produite par des preuves, par de la propagande. Le Nazi et le Soviétique ne sont qu'une seule et même langue. Une langue qui s'est définitivement désintéressée de dire le vrai.
De là un culte voué à la parole et à l'écrit de vérité, chez les derniers des Polonais. Irrépressible besoin de dire ce qui est. Cela va d'une confession, dans l'église transformée en camp de transit, symboliquement dissimulée derrière un numéro de la Pravda, à la lutte d'une Antigone polonaise pour faire inscrire sur la tombe (re-voilà le marbre?) de son frère la date véritable de sa mort. Il y a enfin le carnet retrouvé, bientôt lui aussi réduit au silence, comme en témoignent les pages laissées blanches. C'est à ce moment que le massacre en lui-même nous est montré. Katyn aurait pu s'appeler Mémoire de nos pères, comme le film d'Eastwood, avec lequel il partage cette dynamique du retour à l'origine.
