Lorsque ce roman est paru, il y a trois ans, le barouf médiatique fut tel que l’idée même de le lire m’en avait alors révulsé. Trop de connivences, trop de louanges sans recul, un double prix rarissime, l’Académie Française et le Goncourt. Les congratulations croisées des semblables, puissants dans les médias, n’incitaient en rien à aller y voir. C’était trop, la pensée unique, la glorification mémorielle. Pour juger sereinement d’une œuvre il faut laisser agir le temps. La reparution en poche (plus de 700 g quand même dans son emboîtage carton) est l’occasion de vérifier si le roman tient ses promesses. Mon avis, hors du bruit de ‘ce qu’il faut penser en même temps que tout le monde’, est mitigé. Ce pavé baroque est lourd et mal ficelé mais, en tant que roman, il se laisse lire et fait quelque peu penser. Ce n’est pas aussi proche du génie qu’on l’a dit ; ce n’est pas non plus à rejeter aux poubelles de l’histoire littéraire.
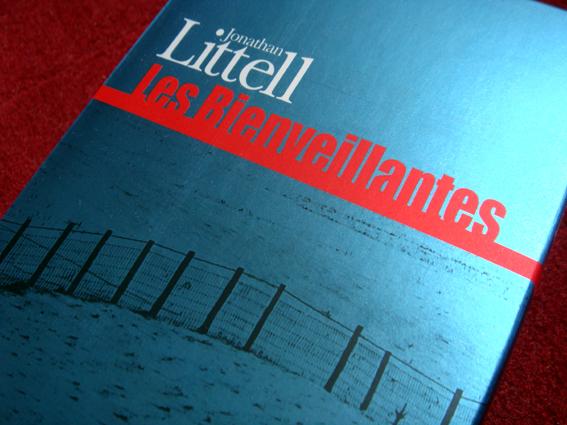
‘Les Bienveillantes’, ce sont les Erinyes (les Mouches de Sartre), ces trois Furies qui poursuivent les humains leur vie durant pour leurs crimes. Représentantes de la justice immanente du Destin, ces démones ne font aucune part au pardon ni à la grâce, termes humanistes d’origine stoïcienne et chrétienne. Elles sont archaïques comme la loi du talion, le dent pour dent talmudique. Elles ne sont donc ‘bienveillantes’ que pour un œil de victime, celui du revanchard qui poursuit ses bourreaux d’une vengeance éternelle, sur sept générations. Là est la contradiction du livre, ce qui le rend « lourd » au double sens du terme, à la fois dense comme un métal lourd et pesant comme un pensum de Hegel. Il s’agit pour Jonathan Littell, comme avant lui Robert Merle et Michel Tournier, de se mettre dans la peau d’un Allemand nazi. Or il reste irrémédiablement décalé, à la fois Juif et de la génération d’après. Son personnage principal le docteur Aue, devenu obersturmbannfürher dans la SS pour finir après guerre dans la dentelle, apparaît en carton pâte.

Déjà son nom, invraisemblable, le ‘pré’ en allemand mais oscillant en français entre le ‘hue’ qu’on doit à une cocotte pour tirer la carriole et le ‘ohé’ que renvoie l’écho. L’individu qui porte ce nom balance entre le destin d’un médiocre – suiveur de son peuple par destinée – et la propension métaphysique à préférer son semblable. Max Aue a une sœur jumelle avec qui il a roulé nu, enfant, dans de joyeuses étreintes intimes, avant d’être recadré sévèrement dans une pension de curés qui l’a converti à l’homosexualité – autre préférence miroir. Ayant une seule fois des relations adultes avec sa sœur, il lui enfourne… des jumeaux, qui seront élevés par sa mère. Ce n’est pas dit explicitement dans le roman, mais fortement suggéré (les dates du viol à Zurich et l’âge des petits correspondent). Ce sont deux flics aussi niais que les Dupont dans Tintin qui poursuivent Aue pour un crime que lesdits jumeaux ont vu.
Max et sa sœur ont été abandonnés enfants par leur père, qui a disparu à la tête d’un corps franc dans l’Allemagne vaincue de l’après-guerre (la Première). Le garçon en a souffert, manquant de modèle oedipien, et a voué pour cela une haine implacable à son beau-père, radical affairiste français – tout ce qui le poussera à choisir son extrême inverse : le national-socialisme aryen. Cet aspect lourdement psy fait beaucoup pour la caricature : on ne peut vraiment croire à un tel personnage. D’autant que faire de tout nazi un pervers sexuel est une facilité déjà usée (par Reich, Merle et Tournier entre autres). Elle n’explique rien au fond : l’auteur fait du personnage un ‘monstre’, une exception dans l’humanité courante. Or les travaux des historiens nous montrent que ce n’est pas la vérité : il n’y avait pas 60 millions de psychopathes en Allemagne pour servir Hitler et sa clique, mais une adhésion majoritaire à l’idéologie völkisch et au redressement identitaire de la nation récente, vaincue et humiliée. Les comportements de type nazi peuvent donc arriver à n’importe quelle société, pour autant que les conditions soient réunies : aux Américains du Vietnam, aux Français d’Algérie, aux islamistes afghans ou algériens, aux Palestiniens en Israël et aux Israéliens à Gaza… Il suffit de survaloriser son propre clan (race, völk, religion) pour faire de tout autre humain une vermine (étrangère, barbare, impure, infidèle). Aue n’est ni vraiment allemand, ni vraiment nazi : il apparaît comme fonctionnaire discipliné, manipulé par des amis et des parrains qui se servent politiquement de lui, sans rien de cette foi raciale ni de cette sentimentalité ‘gemütlich’ qui faisaient le fond de l’idéologie. Max déteste le blond (Hélène la fade), ne frémit pas devant les yeux bleus des petits, n’apprécie pas la forêt ou la brume qui font rêver - sauf pour s’y cacher. Il n’a rien de romantique, ce faux Allemand créé comme un Golem par un Juif américain. Sa sœur a les cheveux très noirs, plutôt de type méditerranéen, ses amants homos sont tsiganes montmartrois ou attaché roumain, ses protecteurs (anciens amis de son père), l’énorme pétomane Mandelbrod et le froid Leland, font plus parrains juifs new-yorkais qu’hommes d’affaires de la Ruhr. On n’en finit pas de ne pas croire au personnage.
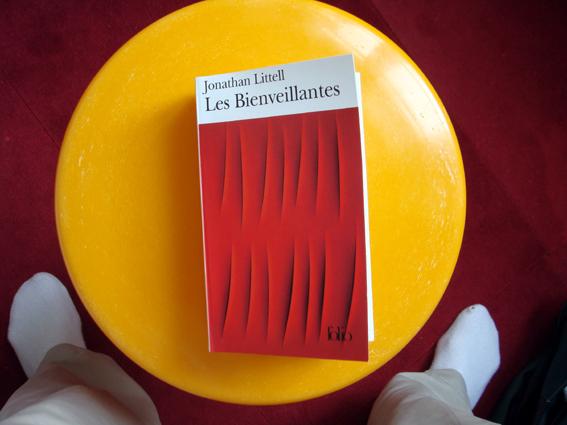
Mais c’est en lui que naît le baroque mosaïque qui est le style de l’auteur. Y participe le style mal ficelé qui rend exécrable les quelques 20 ou 30 premières pages aux phrases bourrées de ‘on’ et commençant souvent par ‘et’, ce qui est un archaïsme biblique. Lourdement drapées aussi les phrases de trois pages, sans aucun point de respiration, vers les pages 950 et 1114, comme des étouffoirs à la Proust, sans le talent de la mémoire. Pour le reste, malgré la division en parties musicales, c’est un flot continu et linéaire qui se lit plutôt bien. L’éditeur, s’il avait fait son boulot jusqu’au bout (on dit qu’il s’agit de Richard Millet chez Gallimard), aurait pu faire retrancher sans dommage un bon quart du tout. La fin surtout est ratée, divaguant entre le clownesque et le répugnant, sans intérêt ni pour le récit, ni pour le caractère du personnage. Les pages 1240 à 1303 se complaisent dans le répétitif d’une érotomanie perverse et solitaire – 60 pages ! – alors que 4 ou 5 auraient suffit. La scène où Hitler décore ses fidèles dans son bunker est du dernier grotesque, de même que celle, finale, du zoo de Berlin. Comme si l’auteur s’était si bien coulé dans la peau de son personnage nazi, durant des années de préparation, qu’il avait eu besoin de secouer sa tunique de Nessus par des cabrements de pouliche. Signe qu’il n’a pas la maturité de dominer son sujet. Nous sommes dans l’absurde newyorkais, pas dans l’Allemagne nazie.
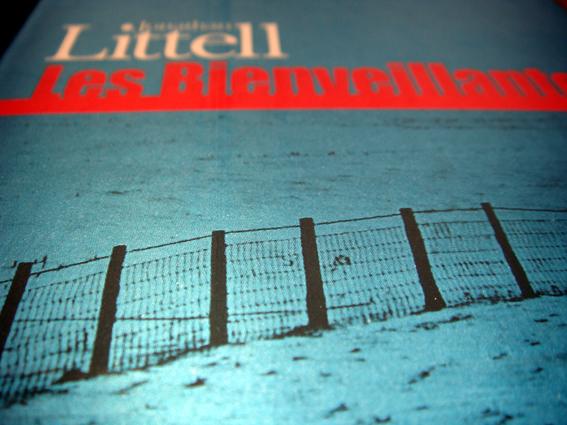
Pourtant le lecteur le suit sur le moment, traduisant nazi par naze, pari d’époque plus sentimentale qu’éprise de vrai. Ce pourquoi ce roman ne passera sans doute pas les années. Le récit lui-même coule plutôt bien, composant à longs traits un portrait. Aue est docteur, non pas en médecine ou en physique, mais en droit… ce qui, dans le système nazi fondé sur la foi dans le Chef est une dérision. Lieutenant-colonel (je vous épargne le titre en allemand, vous aurez – afféterie d’auteur - 25 mots allemands par page en moyenne dans ce roman). Aue ne combat pas, il inspecte et propose de l’organisation. Il n’aime personne, que sa sœur jumelle impossible, et n’a aucun ami – tout juste des relations utiles (avec lesquelles il rompt tout à la fin). Il est donc le parfait observateur neutre du système nazi, jamais personnellement impliqué mais allant d’un endroit intéressant à l’autre. Il n’est pas un acteur, tout comme l’auteur né bien après la guerre, et donne toute l’impasse de son projet : comment peut-on se couler dans un personnage inverse de soi ? Cela a au moins le mérite de lui donner le recul nécessaire à une réflexion qui tente de se hisser au niveau de l’humanité.
Là est sans doute le meilleur du roman. Le sadisme apparent des bourreaux viendrait de leur pitié impuissante, leur volonté de réduire l’autre à la bête pour pouvoir l’éradiquer sans remord. L’impossibilité pratique d’y réussir les rend brutaux et dépressifs (p.217 et p.892). Les ratiocinations classificatoires du dernier ridicule logique cherchent à déterminer la « bonne » origine raciale de populations mélangées par l’histoire et les conversions religieuses (p.433) – donc « la race » n’existe pas, CQFD. Les frères ennemis du bolchevisme et du nazisme sont si semblables au fond (p.563) qu’ils croient en une race/classe élue et établissent un pouvoir miroir à Berlin et à Moscou, sans cesse chancelant par des purges successives. Leur idéal commun est « un national-socialisme et le socialisme dans un seul pays » (p.563). Le mimétisme est net entre Völk allemand et Eretz Israël – pas « de Blut sans Boden » (p.650). L’Impératif kantien (allemand) du « principe de ma volonté individuelle doit être tel qu’il puisse devenir le principe de la Loi morale » s’applique indifféremment à l’humanité entière (fiction historique des Lumières) qu’au Peuple particulier représenté par son Chef (fiction historique de l’Allemagne post-1918) ; « accomplir son devoir » reste la plus haute expression de la liberté humaine (p.809). L’inhumain, donc n’existe pas : « Qu’est-ce que c’est d’autre, Döll (un gazeur de Juifs), qu’un bon père de famille qui voulait nourrir ses enfants, et qui obéissait à son gouvernement, même si en son for intérieur il n’était pas tout à fait d’accord ? » (p.842). Le langage bureaucratique camoufle la tuerie en ‘traitement spécial’, la déportation en ‘changement de domicile’ (p.902).
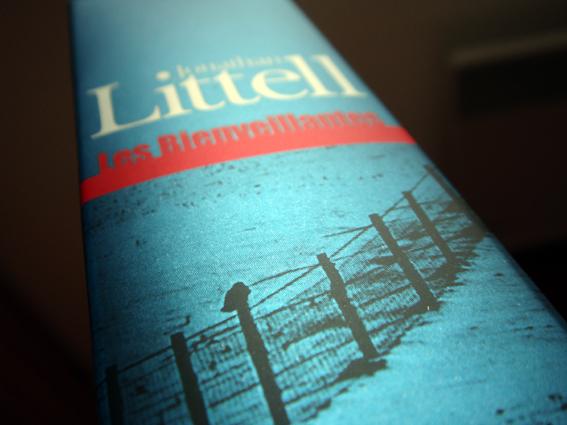
La faute originelle n’est pas d’un seul côté : « Historiquement, les Juifs se sont eux-mêmes constitués comme ‘problème’ en voulant à tout prix rester à part » (p.960). Les Allemands ne s’aimaient pas : « En tuant les Juifs, nous avons voulu (…) tuer le Juif en nous, tuer ce qui en nous ressemblait à l’idée que nous nous faisons du Juif. Tuer en nous le bourgeois pansu qui compte ses sous, qui court après les honneurs et rêve de pouvoir, (…) tuer la moralité étriquée et rassurante de la bourgeoisie, tuer l’économie, tuer l’obéissance, tuer la servitude du Knecht, tuer toutes ces belles vertus allemandes. Car nous n’avons jamais compris que ces qualités que nous attribuions aux Juifs en les nommant bassesse, veulerie, avarice, avidité, soif de domination et méchanceté facile sont des qualités foncièrement allemandes, et que si les Juifs font preuve de ces qualités, c’est parce qu’ils ont rêvé de ressembler aux Allemands, ‘d’être’ allemands, c’est parce qu’ils nous imitent servilement comme l’image même de tout ce qui est beau et bon en Haute-Bourgeoisie, le Veau d’Or de ceux qui fuient l’âpreté du désert et de la Loi » (p.1247).
Au total, voici la version mimétique du nazisme par un auteur juif, et c’est intéressant. Malgré ses graves défauts (dont le principal est qu’on n’a pas envie de relire ce pavé), une lecture unique offre des points de vue nouveaux sur un thème rebattu, trop souvent radoté. Ce n’est pas si mal, au fond, surtout après les semaines de guerre à Gaza.
Jonathan Littell, Les Bienveillantes, 2006, Folio, 1405 pages, 11.50€



LES COMMENTAIRES (1)
posté le 28 juillet à 00:04
Je te trouve cruel envers ce livre , tu affirmes qu'on ne voudra pas le relire , pourtant je connais de nombreuses personnes , et moi-même qui l'ont lu et relu , et le reliront certainement , afin de ne jamais perdre cette saveur qui disparait au fer et à mesure des livres . Enfin de compte c'est comme la nourriture , lorsque tu passes à un autre alliment le goût du précédent disparaît , dans le cas ici présent , on n'a pas envie de passé à autre chose ou de se brosser les dents de suite , car ce livre retournent de nombreuses questions , en plus d'avoir des personnages humain et débordant d'intelligence... Tu as été trop sévère...
PS: Tu dis que Maximilien n'a pas d'amis , et Thomas quand est-il ?