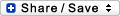Il est toujours intéressant, si l’on s’intéresse à une ville, de lire ce que les écrivains ont pu en dire. Dans le cas de Yaoundé, voici ce qu’en disait Mongo Beti dans son ouvrage La France contre l’Afrique, retour au Cameroun publié en 1993 (déjà cité dans ce précédent post) :
« La capitale se déploie sur un site montagneux, dont les visiteurs étrangers en mal de courtoisie ont coutume de dire qu’il fait son charme. S’il en est vraiment ainsi, c’est sans doute là son unique séduction. On n’imagine guère qu’un voyageur sensé rêve de venir s’installer définitivement ici, à moins d’être inspiré par l’appât du gain ou d’autres semblables considérations.
« Pas un soupçon d’espace vert aménagé, aucune avenue, aucun boulevard se prêtant à la promenade en famille. Pas un fleuve, une rivière, ni un canal offrant ses bords à la contemplation poétique ou à l’extase des amants. L’agrément des habitants ne semble pas avoir préoccupé les édiles, ni à l’époque coloniale, ni encore moins aujourd’hui.
« On observe en revanche ici toutes les tares de la démence de l’Afrique francophone. Des bâtisses abritant les ministères sont édifiés dans un style inconnu, une espèce de baroque mauresque qui frise le pur délire surréaliste. Ici un gratte-ciel jamais achevé faute d’argent dresse son gigantesque moignon vers les nuages dont le ciel équatorial est chargé en permanence, toujours au bord de l’orage, dirait-on. Des quartiers à l’apparence très urbaine sont noyés au milieu de villages africains, des bidonvilles parfois où les chaussées de terre battue, à chaque passage d’automobile, sont dévastées par le tourbillon d’une poussière rouge dont le piéton suffoque et qui colle aux vêtements, quitte à se transformer en une boue épaisse, plus collante encore, à la moindre pluie, intempérie plus que fréquente.
« Magma incohérent d’habitats, de professions, de conditions sociales, c’est un monde auquel aucun ordre ne semble présider. A l’époque coloniale du moins, on distinguait la ville blanche, interdite la nuit aux Africains, les faubourgs habités par les citadins noirs et les villages traditionnels faits de cases aux murs de torchis. Tout cela s’est dissous dans la bouillie, la ville ayant quadruplé, peut-être quintuplé d’étendue depuis mon départ.
« Les rues, hérissées de tas d’immondices jamais ramassés, mais qu’on tente sans succès de brûler, et toujours fumants, n’ont de numéro ni dans les quartiers urbanisés ni encore moins ailleurs. Il vaut mieux ne pas s’y perdre, à moins d’habiter un endroit connu, comme un grand hôtel, où le taxi vous ramènerait à coup sûr.
« On comprend pourquoi les villages des campagnes et les bourgades provinciales sont à l’abandon : tout paraît récent dans cette ville-champignon, même les bidonvilles sont en quelque sorte flambant neuf. La capitale, avec ses 700 000 habitants, absorbe l’argent du pays comme l’éponge l’eau. Non qu’elle en fasse bon usage, tant s’en faut. J’ai pu contempler un quartier de villas dont le luxe ne le cède guère à celui des résidences texanes de Dallas, le célèbre feuilleton : il paraît que l’entourage immédiat du président s’est réservé ce secteur pour y édifier ces splendeurs dont chacune a coûté des centaines de millions, peut-être des milliards.
« On m’a montré aussi un quartier de coquettes petites maisons, conçues prétendument pour les cadres africains, mais selon les normes occidentales des revenus. Le résultat est assez cocasse : ces petits bijoux, qui n’ont jamais trouvé de locataire solvable, sont vides et pourrissent au soleil.
On sent partout une frénésie de gaspillage. On me cite le cas d’officiers dont le parc automobile (privé ? de service ? cette distinction n’a pas cours ici) ne compte pas moins d’une quinzaine de marques allemande, japonaise, américaine et française quand même.
« Ville de politiciens corrompus, trop vite enrichis au détriment de l’Etat, de fonctionnaires conformistes, trop souvent véreux, et d’employés de bureau indolents, Yaoundé n’a pas d’industries. Les chômeurs diplômés déguisés en vendeurs à la sauvette pullulent, ainsi que les prostituées, déguisées en couturières ou en coiffeuses, les très jeunes vagabonds vivant de chapardages, les oisifs cyniques, tout un menu peuple presque toujours aux abois tant son existence est précaire. »