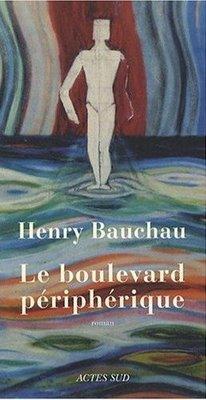
Avant d'accepter d'écrire un message sur ce livre, Prix livre-inter 2008 , il m'aura fallu du temps, de la réflexion et de la recherche.
Nombreux sont les articles et les billets que j'ai lu sur cette lecture dense et énigmatique, comme pour m'aider à trouver confiance et courage.
Comment arriver à parler de ce que moi, petite lectrice dans l'infini des lectures et des lecteurs, je peux dire de cette construction fascinante, étrange et prenante, qui vous laisse avec un sentiment d'inachevé et d'incomplétude tout en vous proposant une forme pleine, lumineuse et rassurante.
Avant de m'y mettre, j'ai aussi cherché des images ou des films, qui pouvaient faire échos aux ressentis multiples, épars, et prenant des directions anarchiques ou inattendues pour accepter de me lancer dans cet exercice.
Mais ça y est, j'y vais et adviendra ce que pourra !
Comme le dit l'auteur, ce n'est pas tant le résultat qui compte que le travail qui trace le chemin pour y arriver...
J'accepte enfin de creuser mon petit sillon autour d'une œuvre dont j'ai ressenti la puissance et la fragilité, l'une et l'autre intimement liées, entrelacées, dans un rythme régulier et finalement apaisant.
Cette écriture est une respiration tranquille posée en bouclier contre le vertige, la peur, l'effroi, la colère et la honte de notre impuissance devant l'inéluctable.
J'ai d'abord été intriguée par le leitmotiv du roman qui s'enroule dans le récit, lacet d'asphalte mouvant et gris qui enserre le territoire.
Ce boulevard périphérique symbolise la route qu'on doit mener et qui nous emprisonne autant qu'elle nous mène vers des portes de sorties aux destinations qu'on aimeraient bien parfois oublier.
Le chemin, même dur et inhospitalier, contraignant, sale et morbide autant que monotone, nous happe parfois totalement, comme pour mieux nous faire oublier que nous arriverons un jour.
J'ai été sensible à cette image forte du trajet à faire, désespérant et glauque, inhumain et fracassant, tout de bruit, de fer, de béton, de vitesse tantôt folle tantôt brutalement arrêtée.
J'ai parcouru Google vidéo pour trouver des images de cette vision d'une réalité quotidienne qui embrume nos vies urbaines déboussolées et j'en ai trouvé une assez proche de ce que j'ai pu lire dans le récit de Bauchau me semble-t-il.
"... sur la route de Paris la banalité du décor trop connu m'écrase. Ce n'est pas vraiment la laideur, la plupart des bâtiments sont assez neufs. Ce qui me frappe c'est le manque. Quelque chose fait défaut qui devrait être là, qui y était encore il y a peu d'années. Je m'efforce de me dégager, de ces regrets, de ces soupirs. Seul compte ce qui est, cela seul est vrai. Tout est lié, le passé, la nature déjà restreinte, déjà blessée, celle qu'ont vue Claude Monet et ses camarades, et ce présent d'immeubles et de station service. Tout est là et dans ce rapport universel je suis pour le moment un point mobile qui va vers un autre momentanément immobilisé et couché avant la guérison ou l'intégration dans des formes nouvelles. Me voilà à la Porte Maillot, je tourne autour du square au milieu de la place et je m'engage sur le périphérique. Pas trop de monde ce dimanche après-midi, ça roule; Il me semble faire à l'ouest et au nord de Paris une sorte de chemin de croix comme on en faisait à l'église dans mon enfance. Mais les stations, cette fois-ci sont des portes. Des portes qui s'ouvrent vers Paris, vers l'encombrement, les bouchons et de l'autre côté vers la gigantesque banlieue, les autoroutes, les routes, et la campagne ruisselante de pluie. J'égrène en roulant les noms des portes comme les grains d'un chapelet. La ville est coupée en deux par ce boulevard, tout ce qui l'environne est marqué d'une sorte de saleté grise comme les gares de mon enfance l'étaient par la suie. Tout est à la fois mesquin et gigantesque, c'est Babylone, mais le regard ne peut se fixer nulle part. Je suis poussé en avant par tous ceux qui m'entourent et qui me suivent. Les choses ne sont pas faites pour être regardées, elles ne sont d'aucune façon accordées à un regard même à quatre-vingt kilomètres à l'heure. Je suis poussé en avant, vers où ? je suis poussé ver l'hôpital et la maladie. C'est là que l'on aboutit en ce lieu et en ce temps, je le ressens avec force.
Cette image qui ne fait pas paysage parce qu'elle n'est pas faite pour être regardée est d'une puissance évocatrice brutale mais juste.
Confrontée quotidiennement au bruit et à la vision apocalyptique d'un flot de voitures incessant menant vers la ville ou la banlieue, en fonction du sens que l'on prend et prochainement confrontée à un mur anti-bruit qui rendra mon champ de vision aveugle à tout horizon tout en me protégeant du vacarme qui m'assaille et me fatigue, j'ai été particulièrement sensible à cette métaphore du passage qui mène à l'hôpital, et je rejoins en ce sens Bertrand Py dans sa lecture lorsqu'il écrit :
"Le Boulevard périphérique, dans l’imaginaire de Bauchau, symbolise aussi d’infimes et si ordinaires désastres, l’évidence de nos trajets brisés, le poids du souci, tout ce qui, dans nos existences, circonscrit et paralyse la fluidité joyeuse que l’homme rêverait d’éprouver alors même que, par l’action d’une intelligence rationnelle et organisatrice, il a édifié patiemment la gigantesque fabrique de métastases dans laquelle le monde moderne le contraint de se cancériser."
La question essentielle que se pose le narrateur devant tant de douleurs et de pesanteurs, de désastres qui n'en ont même plus le goût, est :
"Comment supporter cette vie partagée entre le doute et l'espérance ? Comment ne pas la supporter ? "
Cette question est au centre de ce livre et elle est bien évidemment posée à son lecteur. Henri Bauchau ne donne pas de réponses, il pose des questions.
L'Histoire racontée est celle de la mort de sa belle fille d'un cancer qui lui fait perdre le souffle.
C'est le récit de la disparition d'une jeune femme et d'une jeune mère. Celui de sa famille qui l'entoure et l'accompagne. Le texte de son beau père qui en est le narrateur.
Comment fait-il pour affronter ce réel insupportable ?
Il écrit ce qu'il vit et pense dans des cahiers.
Il convoque des fantômes qui deviennent figures d'une mythologie personnelle.
Ces icônes donnent un sens au combat intime entre la vie et la mort qui se joue dans le corps de la jeune femme.
L'histoire de deux héros resurgis du passé du narrateur va venir s'imbriquer dans ce présent douloureux raconté sans artefacts.
Deux spectres vont se mesurer :
L'ange léger et lumineux, image de Stéphane, resté beau, jeune, sportif et courageux pour l'éternité. Résistant de la première heure spécialisé dans les missions à haut risque et solitaire.
Le spectre de plomb et de mercure de Shadow, qui a anéanti Stéphane et a choisi le mal absolu, sans affects et sans entraves pour dominer, exister, régner.
Le combat inégal n'aura ni vainqueur ni vaincu, Henri Bauchau nous amène au delà...
Ce sont ces deux personnages célestes ressortis un moment des enfers par le narrateur qui vont construire une image acceptable du départ de la jeune femme vers la mort :
"Je tente de reprendre pied en moi-même, je n'y parviens pas. Je revois Paule mourante, à sa droite le mère pleure, à sa gauche Mykha agenouillé la tient dans ses bras. Au pied du lit, la présence de Stéphane, à la tête l'ombre immense de Shadow. Ils se font face, les yeux clos comme les grands gisants des abbayes d'autrefois. Ils protègent Paule de leurs yeux fermés, ayant vu ce que je n'ai pas su voir, ils me forcent à comprendre qu'elle était, qu'elle est un être mystérieusement éveillé à sa condition mortelle."
Ce livre est plein d'images denses et puissamment évocatrices qui parlent de la vie, de la mort et de l'amour, en entremêlant les temps de l'enfance, de le jeunesse et de la vieillesse.
C'est un livre très riche qui mérite plusieurs relectures.
Je pourrais encore recopier des passages entiers de ce texte, qui flirtent souvent avec l'allégorie poétique, mais qui ne sont jamais entachés d'emphase ou de pathos surjoué.
Je décide de mettre fin à ce billet ici, en citant la dernière phrase du livre, qui s'ouvre sur la lumière.
Mais je ne peux pas m'empêcher malgré tout de citer encore ces quelques lignes.
Elles éclairent un peu sur la mystérieuse puissance des fantômes que Bauchau convoque pour l'aider dans son travail herculéen d'introspection.
"Ce que j'ai fait de mon enfance, je n'en sais rien, je l'ai perdue en partie, mais il en reste des traces effilochées à tous les buissons, à toutes les ronces de ma vie. Peut-être que quelque chose renaîtra, ce n'est pas mon affaire maintenant. Ce que je vois dans le regard, dans la souffrance de Shadow, c'est peut-être que Stéphane avait gardé sa légèreté d'enfance, n'ayant rien eu d'autre. Ayant sans doute accepté de n'avoir rien d'autre. Alors que Shadow est mort à son enfance, qu'il est tout entier adulte, dans la terrible pesanteur de cet état. Ce qui se croise dans nos regards, c'est notre double pesanteur braquée sur le passage aérien et ferme de Stéphane. Je perçois en même temps la pesanteur effrayante de Shadow. Une pesanteur satanique où tout est puissance, métaux, lourdes matières de l'esprit. Si je pèse peu c'est par rapport à la formidable concentration d'énergie et d'esprit et d'intelligence métallique de Shadow. Moi aussi, je pèse lourd avec ma cargaison d'espoirs, de désirs, d'amours en regard de la petite barque et de la grande voile blanche de Stéphane. Tous deux sont allés bien plus loin que moi dans la réalité, Shadow dans la pesanteur, dans la dure complexité du monde, Stéphane dans l'allègement, dans une allégresse blessée par la vie, dans un soulèvement de plante qui sort de la terre sans savoir encore s'il y a un soleil."
Bertrand Py, sur Actes Sud : "Il est merveilleux qu’un livre sur l’ombre portée de la mort en soi prenne la forme d’un défi à la pesanteur comme à l’égocentrisme littéraires, qu’il éclaire ainsi d’une transparence bouleversée et d’une sérénité mystérieuse, qu’il engage un si juste conciliabule entre la souffrance et l’espérance, entre l’entrave et l’élan, entre l’effroi et l’apaisement, entre l’incertitude et la conscience de l’inconscient, entre l’impensé et l’impensable – et que, le moment venu, avec la proximité et toute la distance que lui donne son très grand âge, Henry Bauchau ait pu l’accomplir par-delà son propre vertige, dans la souriante acceptation de notre condition mortelle…"
Thomas Flamerion, sur évène
Amélie Dor sur Lire.fr
Sur BibliObs. com : F. Baletas (lecteur), Catherine David, Karine Henry (libraire), Sylvie Servoise-Vicherat (universitaire), Dominique Marie Godfard,
Aliette Armel, Le magazine littéraire
Robert Solé, Le Monde.fr
Clarie Devarrieux, Libération.fr
Marine Landrot, Télérama.fr
Bruno Frappat, La Croix
Thierry Detienne, Promotion des lettres
Cathe en parle, comme Dda, Julie,
Bellesahi a beaucoup aimé, Sylire aussi,
de très beaux billets sur des petits riens, Maglm, Marc Villemain,
un autre sur Puzzle et poussières
Maxime Durisotti :"Le roman tout entier, dont la question initiale peut être formulée ainsi ” à quoi sert d’espérer quand la mort est certaine ?” est une patiente, une sublime conversion à l’espérance et à la finitude."
Sur mémoire d'Europe : "La vie la plus ordinaire se tisse de légende, comme dans le quotidien des civilisations les plus antiques. Le roman, quand il atteint ce détachement et cette acuité, nous permet de partager un peu ce qu’éprouvent toujours ceux sur notre planète pour qui, derrière chaque visage, un dieu ou un démon tour à tour se repoussent, en attendant qu’un chaman les départagent. "
Un site consacré à son œuvre,
Un entretien avec l'auteur,
La couverture du livre est une toile d'Henri Bauchau, à lire pour aller plus loin, l'atelier spirituel.

