En pleine crise financière il peut être utile de (re)lire ce que Jean-Pierre Dupuy propose pour penser la catastrophe dans son remarquable livre « Pour un catastrophisme éclairé ».
« Quand nous disons couramment que nous « changeons l’avenir », quelle capacité nous attribuons-nous exactement ? Cel
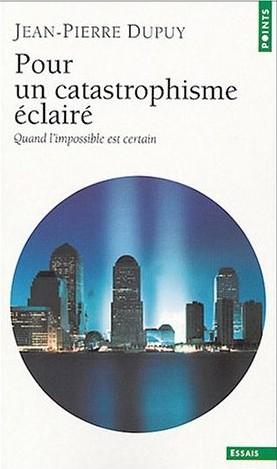
Peut-on croire à la fois que l’avenir que l’on prévoit est, d’une part, le résultat d’une fatalité, et, d’autre part, qu’on agit causalement sur lui, par le fait même qu’on le prévoit et que cette prévision est rendue publique ? La métaphysique traditionnelle du temps repose sur le causalisme qui rend ces deux types de dépendance équivalentes ce qui revient à dire que l’une entraîne l’autre et réciproquement. Nous tenons que nos actions présentes peuvent avoir un effet causal sur l’avenir, et nous en inférons que l’avenir dépend contrefactuellement du présent (avenir « ouvert »). Nous tenons par ailleurs que nos actions présentes ne peuvent avoir d’effet causal sur le passé et nous en inférons que le passé est indépendant contrefactuellement du présent (« passé fixe »). Dupuy propose d’appeler cette conception de la temporalité le temps de l’histoire. Dans le temps de l’histoire, les agents se coordonnent par convention sur le passé, tenu pour fixe. Cette convention ne paraît pas en être une, tant elle nous semble « naturelle ». C’est parce que nous tenons le passé pour fixe que des composantes fondamentales du lien social comme la promesse, l’engagement, le contrat, etc., sont possibles. Le fait que les régimes totalitaires s’efforcent toujours de « réécrire l’histoire » ne fait que renforcer l’évidence : l’histoire qu’ils racontent est tout simplement mensongère.
Dupuy soutient q’une autre conception du temps, dans lequel nous nous coordonnons autour d’un avenir tenu comme fixe ne nous est pas moins familière et que l’expérience de ce temps est facilitée, encouragée, organisée, voire imposée par maints traits des institutions de la société moderne. Les théoriciens du marché «parfait » posent que les agents économiques, prennent les prix pour des données fixes, c’est à dire indépendantes de leurs actions. Ces actions sont constituées par les offres et les demandes relatives aux biens qui composent l’économie en question. Simultanément les économistes expliquent la formation des prix par la confrontation sur le marché de ces mêmes offres et de ces mêmes demandes. On considère généralement aujourd’hui que ce que la théorie économique et la théorie des jeux désignent par « équilibre » n’a rien à voir avec ce que l’origine de ce terme en mécanique rationnelle désigne. Tout problème de décision à deux agents au moins met en scène un phénomène de spécularité, chacun devant penser à ce que l’autre pense de ce que lui même pense, etc. Un type d’équilibre correspond à une manière de couper quelque part cette régression potentiellement infinie. Avec l’hypothèse de fixité des prix, la théorie du marché pose que c’est au niveau des prix que la régression s’arrête. On doit pouvoir poser sans contradiction à la fois que les agents ont un pouvoir causal sur les prix et qu’ils tiennent ceux-ci pour fixes, non pas au sens causal, mais bien au sens technique que nous avons donné à ce terme : fixes, c’est à dire contrefactuellement indépendants de leurs actions.
C’est ce que permet le théorème de von Foerster qui décrit le rapport de causalité circulaire entre une totalité (par exemple une collectivité humaine) et ses éléments (les individus qui la composent). Les individus sont liés les uns aux autres, d’une part, et à la totalité d’autre part. Les liens entre individus peuvent être plus ou moins « rigides ». La conjecture de von Foerster dit alors ceci : plus les relations interindividuelles sont rigides (du fait de comportements mimétiques par exemple), plus le comportement de la totalité apparaîtra aux éléments individuels qui la composent comme doté d’une dynamique proche qui échappe à leur maîtrise. Cette thèse ne peut valoir que parce qu’on prend ici le point de vue, intérieur au système, des éléments sur la totalité. Pour un observateur extérieur au système la rigidité des relations entre éléments est au contraire propice à une maîtrise conceptuelle, sous forme de modélisation par exemple. L’avenir du système est prévisible mais les individus se sentent impuissants à en orienter ou réorienter la course, alors même que le comportement d’ensemble continue de n’être que la composition des réactions individuelles à la prévision de ce même comportement.
Pour en revenir à l’hypothèse de la fixité des prix, le théorème de von Foerster nous dit que, sous certaines conditions qu’il énonce rigoureusement, la situation des agents dans un système qui échappe à leur maîtrise donne un fondement objectif aux propositions contrefactuelles du type : « Si j’agissais différemment, en augmentant par exemple ma demande pour tel bien, l’ensemble des prix n’en serait pas affecté. » Cela n’est en rien incompatible avec le fait que les agents ont un pouvoir causal sur les prix et le savent. Les agents, devant se coordonner, doivent choisir une façon de mettre un terme aux jeux de miroirs potentiellement infinis, dans lesquels les plongerait le besoin de savoir ce que les autres savent de ce qu’ils savent, etc. Cet arrêt à la spécularité, c’est dans la position partagée de la fixité d’un jeu de variables qu’ils vont l’organiser. C’est lucidement, en toute conscience, qu’ils vont par convention tenir ces variables pour fixes (contrefactuellement indépendantes de leurs actions) alors qu’ils savent avoir un pouvoir causal sur elles. C’est sur cette configuration que l’on peut fonder le concept de « convention de coordination » qui a obtenu droit de cité dans la pensée économique d’aujourd’hui. Cet exemple illustre qu’une dépendance causale peut aller de pair avec une indépendance contrefactuelle.
De partout, des voix plus ou moins autorisées se font entendre qui proclament ce que sera l’avenir : le trafic sur la route le lendemain, le résultat des élections prochaines, les taux d’inflation et de croissance de l’année qui vient, l’évolution des gaz à effet de serre, etc. Les prévisionnistes et prospectivistes savent fort bien, et nous avec eux, que cet avenir qu’ils nous annoncent comme si il était inscrit dans les astres, c’est nous qui le faisons. Nous ne nous rebellons pas devant ce qui pourrait passer pour un scandale métaphysique (sauf parfois les électeurs). C’est la cohérence de ce mode de coordination par rapport à l’avenir que Dupuy tente de dégager. Supposer que l’agent tienne l’avenir pour fixe n’implique en aucune façon qu’il ne voie pas que l’avenir dépend causalement, au moins en partie, de ce qu’il fait maintenant. L’agent tient par hypothèse l’avenir pour fixe, c’est à dire contrefactuellement indépendant de son action. Maintenant, dans son raisonnement, l’avenir constant pour décider de son action présente il choisit entre plusieurs options, celle q’il juge la meilleure. Le temps que décrit Dupuy a la forme d’une boucle dans laquelle, dans laquelle le passé et le futur se déterminent réciproquement. Il a donné le nom de temps du projet à cette temporalité autre. Le temps du projet n’est pas un fatalisme parce qu’il en sait trop sur la capacité des enchaînements causaux à mimer le fatalisme, à produire des « effets de destin ».
Le temps du projet est une fiction métaphysique dont Dupuy tente d’établir la cohérence et de montrer la rationalité. Mais le temps de l’histoire, « notre » temps, n’est pas moins fictif. On ne peut faire mieux en métaphysique que de construire de telles fictions. Mais elles nous sont indispensables. Dupuy cite le meilleur exemple qu’il connaisse de l’utilisation du temps du projet, pour, en dehors de toute aliénation, mobiliser autour d’un projet commun désirable. L’exemple de la planification française telle que l’avait conçue Pierre Massé et telle que Roger Guesnerie en synthétise l’esprit dans la formule suivante : la planification, écrit-il, « visait à obtenir par la concertation et l’étude une image de l’avenir suffisamment optimiste pour être souhaitable et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui engendrent sa propre réalisation ». Cette formule ne peut trouver son sens que dans le temps du projet, dont elle décrit parfaitement la boucle reliant le passé et l’avenir. La coordination s’y réalise sur une image de l’avenir capable d’assurer le bouclage entre une production causale de l’avenir et son anticipation autoréalisatrice.
Le paradoxe de la solution catastrophiste au problème des menaces qui pèsent sur l’avenir de l’aventure humaine est maintenant en place. Il s’agit de se coordonner sur un projet négatif qui prend la forme d’un avenir fixe dont on ne veut pas. La déploration insistante de Hans Jonas est que nous n’accordons pas un poids de réalité suffisant à l’inscription de la catastrophe dans le futur. Ni cognitivement ni émotionnellement, nous ne sommes touchés par l’anticipation du malheur à venir. Seule la métaphysique du temps du projet peut, selon Dupuy, rendre compte de cette actualisation du futur, en mettant face à face le passé et l’avenir et en les rendant jumeaux l’un de l’autre. Dans le temps de l’histoire, la prévention efficace de la catastrophe fait de celle-ci un possible non réalisé, sorte de fantôme ontologique dont le poids de réalité est insuffisant pour soutenir la volonté de le maintenir hors du monde actuel. Le temps du projet, lui, inscrit fermement la catastrophe dans la réalité de l’avenir, mais au point qu’une prévention réussie ne peut que s’autoannihiler ipso facto, pour des raisons logiques cette fois, puisque la catastrophe, ne pouvant trouver place dans l’ensemble vide des possibles non réalisés, disparaît dans le non-être.
Cette description de notre aporie se trouve, dans ces termes, au cœur même du débat sur l’efficacité de la dissuasion nucléaire. Ce débat a révélé, selon Dupuy, une issue possible. Il a franchi une étape décisive lorsque les partisans les plus avisés de la stratégie de vulnérabilité mutuelle ont compris qu’il leur fallait faire l’économie complète du concept d’intention dissuasive et présenter à l’ennemi la menace, non pas comme un acte intentionnel, mais comme une fatalité, un accident. La simple existence d’arsenaux nucléaires constituant une structure de vulnérabilité mutuelle suffirait à rendre les adversaires infiniment prudents, indépendamment de toute intention ou raison d’agir. Avec cette doctrine de « dissuasion existentielle », la différence qui séparait le cas de la menace nucléaire de celui des catastrophes climatiques, sanitaires, économiques ou industrielles s’évanouit en fumée. Dans les deux cas, le mal prend la forme de la fatalité. Pour que des signaux venus du futur atteignent le passé sans déclencher cela même qui va annihiler leur source, il faut que subsiste, dans l’avenir une imperfection du bouclage. Ce que Dupuy exprime sous la forme suivante : « obtenir une image de l’avenir suffisamment catastrophiste pour être repoussante et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui empêcheraient sa réalisation, à un accident près ».
L’apocalypse est inscrite dans l’avenir, mais sa probabilité d’occurrence est extrêmement faible. En d’autres termes, ce qui a des chances de nous sauver est cela même qui nous menace. Le temps du projet piège le temps dans une boucle hermétiquement fermée sur elle-même, faisant du passé et de l’avenir comme deux doubles se renvoyant la balle. Mais cette fermeture est en même temps une ouverture. Le temps se clôt sur la catastrophe annoncée, mais le temps continue, tel un supplément de vie et d’espoir, au-delà de la clôture. L’ouverture résulte de ce que le destin a le statut d’un accident, d’une erreur qu’il nous est loisible de ne pas commettre. Nous savons que nous sommes embarqués, avec à notre bord, une bombe à retardement. Il ne tient qu’à nous que son explosion, inscrite comme une fatalité peu probable, ne se produise pas.
Nous sommes condamnés à la vigilance permanente.
éé
éé



LES COMMENTAIRES (1)
posté le 28 novembre à 17:45
sa paraissait interressant mais je n'ai rien appris!!!