Le 6 mai 2007, les Français ont élu à une confortable majorité celui qui est donc aujourd’hui notre président. Le candidat vainqueur est issu d’un courant de la droite assez jeune en France, qui assume pleinement à la fois son néo-libéralisme et son néo-conservatisme. Quand je dis assumer, c’est évidemment dans l’entre-soi. Les Français n’étant pas encore convertis au libéralisme économique, loin s’en faut, le discours politique diffusé par cette mouvance est des plus hypocrite. Mais plus encore, il joue sur l’omission.
Car en effet, l’ex maire de Neuilly a gagné la présidence sur le programme le plus à droite qu’un homme politique ait proposé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale (j’aurais pu dire seconde mais voyez-vous…). En face, c’est un électorat rongé par les peurs et les doutes nés de la mondialisation, oppressé par la nouvelle donne économique qui précarise et appauvrit (qui déclasse pour le moins, quand il n’y a pas appauvrissement réel) qui l’a porté au pouvoir. Il y a encore une dizaine d’années, le réflexe de ces gens aurait été de se tourner vers la gauche, garante de la protection des plus faibles, préceptrice d’un modèle économique moins darwinien, plus équilibré, plus durable pourrions nous dire en ces temps où l’écologie essaie tant bien que mal de se frayer un passage dans la jungle des prédateurs politiques.
Pourtant le héraut de la droite décomplexée a gagné haut la main en proposant un programme économique, qui sous quelques paravents volontaristes et populistes, s’appuyant sur une dialectique de la rupture (contre-révolutionnaire maquillée), est clairement destiné a laisser les mains libres à la classe dominante d’étendre sa puissance, au détriment de quasiment toutes les autres catégories de population : celles qui ne sont pas méritantes, qui ne veulent pas assez s’en sortir, sont coincées dans des schémas de pensée archaïques. Pour résumer la majorité de la population a voté pour instituer un ordre qui privilégiera une infime minorité parmi elle et en marginalisera une grosse partie, laissant l’entre-deux dans une situation très difficile.
Comment ce tour machiavélique a t’il pu être joué aux citoyens ? Comment peut-on amener des gens a voter avec enthousiasme contre leurs intérêts économiques et en faveur d’une destruction de leur mode de vie ?
Une bonne partie de la réponse se trouve dans le livre de Thomas Frank,Pourquoi les pauvres votent à droite : comment les conservateurs ont gagné le cœur des Etats-Unis (et celui des autres pays riches)
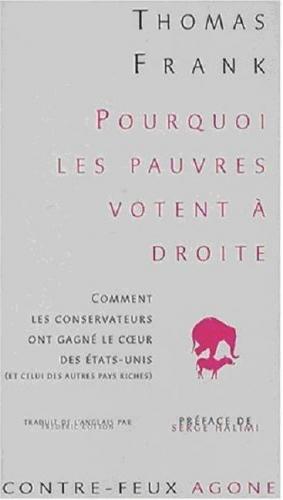
Depuis une trentaine d’années, l’avènement de la nouvelle donne économique née du consensus de Washington, ce que l’on appelle aujourd’hui plus ou moins pertinemment le néo-libéralisme a été de pair avec une révolution néo-conservatrice, les deux mouvement s’entretenant l’un-l’autre, dans une imbrication qui sent bon la convergence d’intérêts. Un phénomène assez logique dans la mesure où ce sont les mêmes qui ont lancé et l’une et l’autre. La seconde permet de faire oublier les effets économiques de la première sur les classes défavorisées et moyennes et la première alimente la grogne et le ressentiment qui va nourrir la seconde.
Thomas Frank décrit et analyse ainsi ce paradoxe assez gigantesque qui voit les américains assister « à une révolte qui ne profite qu’à ceux qu’elle est censé renverser. Les travailleurs en furie, forts de leur nombre, se soulèvent irrésistiblement contre l’arrogance des puissants. Ils brandissent leur poing au nez des fils du privilège. Ils se gaussent des affectations délicates des dandys démocrates. Ils se massent aux portes des beaux quartiers et, tandis que les millionnaires tremblent dans leurs demeures, ils crient leur terrible revendication : « laisser-nous réduire vos impôts ! » »
La dimension essentielle de cette révolution est culturelle et profite du dévoiement du parti démocrate, la « gauche » américaine qui comme son homologue française s’est peu à peu vautrée dans la notabilisation, s’est couchée face à la mondialisation néo-libérale et s’est recroquevillée dans la défense des « discriminations », c’est à dire en évacuant la question économique de son domaine d’action. La gauche est donc vue aujourd’hui comme une formation qui ne se préoccupe que des questions de mœurs.
Les conservateurs républicains ont parfaitement deviné quel profit il pouvait tirer de ce retrait de la gauche et de sa distanciation progressive des questions sociales. Force est de constater qu’ils ont réussi et qu’ils se sont attaché une grande partie des classes populaires, lassées de constater le désintérêt de la gauche pour leurs conditions de vie, excédées de ne la voir bouger que pour ce qu’ils perçoivent comme des préoccupations de riches : la culture, la défense des minorités sexuelles et raciales. Pour l’américain moyen, l’honnête travailleur est laissé en pâture, son mode de vie traditionnel est menacé par les élites cosmopolites qui entraînent inéluctablement la décadence de la grande Amérique, pieuse et laborieuse, celle des vrais hommes, qui n’aiment pas le latte et la culture française..
Bien entendu, les fondements culturels Etats-uniens sont quand même assez différents de ceux de la France, notamment dans le domaine religieux et la haine de la culture humaniste, donc largement ouverte sur le monde, n’est pas aussi développée chez le paysan des Alpes que chez celui de l’Arkansas. Pourtant, il est frappant de constater comment la droite américaine et son homologue française, par émulation pour cette dernière, ont parfaitement su se servir du profond fléchissement idéologique de la gauche, pour l’attaquer là ou sa défense est traditionnellement la moins efficace : la question culturelle, le problème des valeurs, la sécurité physique : en gros, le conservatisme politique.
C’est ainsi que pour éviter de parler des salaires, le mari de Carla Bruni a agité la valeur travail. Le travailler plus gagner plus n’était pas une solution économique aux problèmes financiers des gens, mais une approche culturelle. Si vous le voulez, si vous vous investissez alors vous gagnerez plus et vous serez plus estimable que ceux qui, glorifiant l’oisiveté, vivent de vos impôts avec les minima sociaux. Cette approche francisée s’inspire complètement de la théorie du workfare state, édictée pendant les années Reagan et se drape pour cacher son identité violemment conservatrice et réactionnaire sous les paravents de la défense de valeurs traditionnelles populaires, mises à mal par Mai 68 (les années 60 de tous les relâchements aux Etats-Unis).
Ce qui est contenu dans cette attitude politique c’est la polarisation de l’amertume des classes populaires non pas vers la minorité dominante mais vers ceux qui sont en dessous : les oisifs, les parasites, les assistés. Les responsables de votre situation, ce sont eux disent nos décomplexés de la droite, pas ceux qui créent de l’activité et de la richesse, qui ne récoltent que le fruit de leurs mérites. Car tous, vous pouvez accéder à ce statut si vous le voulez vraiment et si vous vous débarrassez des inactifs, des improductifs (dont les fonctionnaires) qui sucent vos impôts comme des sangsues gauchistes qu’ils sont. Bien entendu, pas un mot sur le système économique mis en place par les possédants, l’emploi précaire et sous-payé corollaire des systèmes de management mis en place, de la financiarisation qui d’une part pressure industriels et employés, d’autre part édifie une construction consumériste qui tient uniquement sur le crédit, avec l’instabilité que cela suppose, comme nous le montre la crise des subprimes qui menace aujourd’hui l’économie mondiale.
Bien plus, les conservateurs alliés aux fondamentalistes religieux, non contents d’évacuer les responsabilités du marché libre (qu’ils favorisent autant qu’ils le peuvent), sur les conditions de vie des classes populaires et sur le prétendu délitement moral de l’Amérique, s’ingénient à se décrire comme persécutés par une élite démocrate quasi aristocratique et contrôlant tous les rouages du pouvoir financier, industriel et culturel aux Etats-Unis. Personne ou presque ne leur fait remarquer que les Républicains ont occupé la Maison Blanche 28 ans sur 40 depuis 1969. Pas davantage pour remarquer que les pontes politiques ultra-conservateurs sont la plupart du temps riches à millions, fréquentent les mêmes lieux et ont quasiment les mêmes mœurs que leurs collègues du parti de l’âne.
C’est ainsi que les républicains se victimisent systématiquement, alimentant une théorie du complot démocrate et de l’anti-amérique, alors mêmes qu’ils tirent la majorité des ficelles aujourd’hui. Mais ils ont pour le moment gagné la bataille des idées qui les range aux côtés des plus humbles. Ces derniers censés aspirer à plus de dignité appuient donc, avec souvent une force militante assez impressionnante ceux qui les en privent toujours davantage (il suffit parmi tant d’exemples de regarder la répartition revenus du capital/revenus salariaux qui a progressé de 10% vers les premiers depuis trente ans en Amérique comme ailleurs).

Sa parole a d’autant plus de poids qu’il est allé se fondre dans ce milieu et s’entretenir avec ses différentes composantes, depuis l’ouvrier de l’usine Boeing de Wichita qui préfère fustiger l’arrêt « Roe vs Wade » de la cour suprême légalisant l’avortement plutôt que de s’en prendre à l’entreprise aéronautique qui s’est livrée à un odieux chantage à l’emploi, jusqu’aux différents candidats républicains aux élections du Kansas. C’est cet état, dont l’auteur est natif qui sert d’espace expérimental à ses propos. Lui-même ancien ultra-conservateur dans sa jeunesse des banlieues dorées de Kansas City, a fait un chemin que peu ont suivi dans le même sens à son époque, à savoir basculer à gauche (Il écrit dans le Diplo aujourd’hui). Il montre avec beaucoup de perspicacité, avec une ironie qui permet d’alléger quelque peu la démonstration, comment un état pionnier dans la défense des plus fragiles au moyen de l’action collective (le populisme de gauche au début de siècle dernier) a pu se vautrer dans un ultra-conservatisme néo-libéral pro-bushiste.
Pourquoi les pauvres votent à droite est une excellente analyse du basculement politique des classes populaires. La préface de Serge Halimi se charge de faire le parallèle avec la dernière élection présidentielle en France. L’explication de la victoire des conservateurs est très pertinente mais elle contient dans son argumentation les raisons de la défaite de la gauche : la démission.
Quel avenir a-t’elle aujourd’hui alors qu’une fois de plus mais dans des proportions inédites, la crise financière actuelle vérifie le principe néo-libéral de socialisation des pertes, que la précarité est censée être la vie, selon les dires d’une dirigeante syndicaliste patronale, qu’une majorité de la population des pays développés est menacée de déclassement pendant qu’une infime minorité dirigeante l’exploite et l’instrumentalise ? Comment peut-elle rester silencieuse alors que des sommes astronomiques vont être levées pour corriger l’impéritie d’une caste financière avide et amorale, alors que le centième de cet argent pourrait éradiquer la faim dans le monde, garantir la pérennité des services publics et des systèmes de protection sociale ? Comment ne peut-elle pas sonner la charge alors que le système néo-libéral vient une fois de trop de démontrer que ses failles sont bien trop grandes pour être acceptables ?
Peut-être parce qu’elle n’est tout simplement plus de gauche…
Nicks
