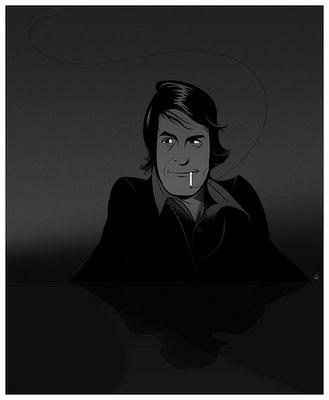
Six mois après sa sortie, prix réduit de 60% sur Amazon (80% il y a deux semaines). Il ne faut pas y voir une promotion mais l’aveu d’un échec : le livre ne se vend pas, il est temps de s’en débarrasser. Lorsque The recognitions sombra dans l’oubli à peine publié, il y avait de quoi tomber à genoux, lever les yeux au ciel et gémir de douleur. On a envie qu’il en soit pareil ici, mais la conviction n’y est pas : Laura Warholic, le nouvel Alexander Theroux, n’est pas un livre qu’on chérit. Ce qui ne veut pas dire qu’il est mauvais, mais plutôt qu’il est difficile à aimer. 878 pages. Tout le monde commencera par là. Est-ce trop ? C’est un débat que je n’aime pas mais, lorsqu’on ressort épuisé, lessivé de cette lecture, on comprend ou pour le moins on tolère. Steve Moore, qui a édité le texte, aurait jeté le gant devant l’insistance de Theroux à rajouter 300 pages à ce qui était déjà un manuscrit de 600. Cet « extra » rendait le livre moins bon, disait-il. Peut-être. J’ai surtout l’impression que Laura Warholic, bien que doté d’une très finale fin, est de ces livres infinis, qui pourraient s’étendre et s’étendre et s’étendre, bibliothèque de babel, quitte à se répéter dans un autre ordre. Il pourrait aussi se rétracter, se rétracter, se rétracter mais pas trop. En fait, passé les 250 pages, il est probable qu’on ne sache plus trop bien ou finir et si finir.
Eyestones, érudit vieille mode, vétéran du ‘Nam et journaliste improvisé écrit chaque mois une colonne très controversée sur le sexe pour le journal d’un certain Warholic, gros porc et fier de l’être. Il se prend de pitié plus qu’il s’éprend de l’ex-femme de son patron, laide, infidèle, conne, menteuse, sale. Il veut l’améliorer mais à travers ses propres défauts, c’est impossible. C’est tout ce qu’il y a là-dedans narrativement. Qui connaît Theroux sait de toute façon qu’on va chez lui surtout pour qu’il nous saoule à la dive bouteille des mots. « Faire des phrases c’est comme créer des bijoux » a dit Theroux. Et il est difficile de ne pas admirer ses joyaux.
Eugene Eyestones pourrait sortir de chez Bellow. Un Herzog qui échangerait Ramona pour un platonique amour de Rapunzel. Un Von Humboldt Fleisher, de par son incapacité à faire resplendir la culture en Amérique, un conservateur à la Sammler. Comme chez Bellow, les noms sont étranges. Et comme chez Bellow, il ne se passe rien. Rien. C’est une étude de caractère (« character is plot » selon Theroux), c’est la psychologie de Eyestones, c’est la psychologie de Warholic. Même sur la route, dans un voyage qui les fait traverser les Etats-Unis, il n’y a pas de progression narrative en tant que telle. Bellow a reçu le Nobel, Theroux ne l’aura pas. Bellow a été lu, Theroux ne le sera pas. Bellow a été cloué au pilori, accusé de réactionnite aiguë, Theroux aussi, dans une moindre mesure. Pourquoi ? la réponse est sans doute, comme bien souvent, comme trop souvent, à chercher dans la langue, dans l’écriture. Oh, Bellow était un bon styliste, ça oui ! (“I am an American, Chicago born – Chicago, that somber city – and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent.”) On sait qu’il a montré la voie à Pynchon (« on peut faire ça? »). Mais mais mais là, c’est autre chose. Theroux, c’est au-delà du style. Voyez-vous, si le styliste a quelques connaissances en matière d’élégance, s’il est capable de voir dans des éléments bizarres, nouveaux, anormaux des nouveaux assemblages prêts à former des parures qui font faire ah ! oh ! wow !, il y a d’autres plumitifs – dont Theroux – qui se foutent de l’élégance et de l’ensemble étrange mais beau. Oui, de ça ils se foutent. Ils dynamitent la langue et posent les questions ensuite. Et ce geste n’est pas nihiliste, nein, pas de destruction mais un tunnel si on veut, on creuse, on creuse, on n’assemble pas on défait et en défaisant on refait quelque chose d’autre. Et voilà ! Theroux est illisible. C’est ce qu’on vous dira. Mais par là, il faut comprendre que l’opération déstabilise les certitudes du bonhomme lecteur. Déjà Bellow, c’est parfois trop (« j’ai relu trois fois le paragraphe d’ouverture de Augie March, je n’y comprends toujours rien »). Alors Theroux ! Déstabilisation, déséquilibrage, cloche-pied au dessus de la phrase. Trop c’est trop. Donnez-moi le vocabulaire et les phrases rassurantes d’une déclaration d’impôts ! Mais déjà cette déclaration, le contribuable-lecteur – même bête que le grand’consolecteur -- ne sait la lire. Alors si on ajoute à ça, outre l’attraction-répulsion de Eyestones pour les noirs (un trait qu’il partage avec Sammler), la profonde misogynie de presque tous les personnages, l’anti-sémitisme rabique de l’un d’eux, l’homophobie latente, il ne faut plus en jeter : qui lira un machin bizarre et haineux ? N’est-ce pas en gros ce que David Bowman disait du livre dans le New York Times ? Roman réac d’un écrivain réac… Mais quand on veut bien lire, vraiment lire, quand on fait autre chose que parcourir bêtement en bêlant, on se retrouve – et peut-être est-ce effrayant – à rire, à rire aux éclats devant les blagues anti-sémites, tellement énormes, tellement trop loin de tout décence, tellement grossières que l’indignation ne leur rendrait pas justice, non, c’est par le rire qu’il faut laver ça ; et on rit, on rit encore quand il s’agit des femmes, tout ça n’est pas le rambling d’un insane macho, c’est une version au carré de tout ce que certains hommes voudraient pouvoir dire et de ce que certaines hommes voudraient ne plus entendre dit et de ce que nos compagnes elles-mêmes disent parfois des autres femmes et qu’encore une fois parfois il vaut mieux rire du mauvais goût, et on rit, on rit encore quand on évoque la langue des africains-américains, que Theroux rend avec parfois une précision diabolique, parfois en se vautrant dans le cliché, parfois dans l’authentique qui se veut faux et le faux qui se veut authentique, on rit parce que c’est juste fort, que peut-être y a-t-il là-dedans la clé du livre, hein, qu’il ne s’agit pas juste d’être bête et méchant mais d’évoquer avec ses armes une époque bête et méchante où lorsque x dit a ça va mais lorsque y dit a ça va pas, une époque qui cultive le faux comme vrai et le vrai comme impossible à dire, enfin, peut-on vraiment ne pas voir qu’il y a de ça là-dedans ? J’ai l’impression qu’on oublie ce qu’il y a de satire et puis sans doute pour Theroux le plaisir de dire exactement ce qu’il ne faut pas dire. Qu’on oublie aussi qu’il n’y a pas grand-chose – pour ne pas dire rien – de positivement dépeint là-dedans, même si on n’insiste étrangement que sur quelques points. Le réalisme est cartoonesque, ça devrait suffire à faire comprendre qu’il ne s’agit pas des thèses d’un esprit dérangé mais bien d’une vision particulière posée sur une société jugée superficielle, vulgaire et nauséabonde. Pourquoi faudrait-il devenir rouge de colère, se jeter à terre, casser tout et hurler au loup ? Parce que c’est plus facile.
Gaddis disait que la satire était ce qu’il restait quand on avait raté son projet initial et certains lecteurs auraient peut-être envie de dire ça de Laura Warholic. Moi pas. Je ne pense pas que son projet soit raté. Finalement, l’avis critique le plus juste tiens sur un paragraphe de quelques lignes, paru dans le Believer :
Ulysses, Midnight Cowboy, and Lenny Bruce’s comedy were all labeled obscene until enough time had passed that wider audiences began to see the works as brilliant. I wonder if the same will hold true of Alexander Theroux’s new novel. It is a pissed-off book, and reading its six hundred pages is as much fun as a hot August road trip with Don Imus, Ann Coulter, and Andrew Dice Clay. Yet it is also a remarkable achievement, a bombastic, squirm-inducing, and belief-rattling satire on political correctness shown through the lens of a sexless love story between two of the most unlovable (if not repulsive) characters in recent American letters. It takes an author like Theroux, who is as established as he is antiestablishment, to pull off a novel that for many other authors would be career suicide.
Eh oui, un auteur déjà mort pour la presse et les éditeurs ne saurait se suicider. Mais Laura Warholic pourrait être la lettre d’adieu d’une mise à mort qui n’aura pas lieu - et Theroux a déjà dans ses malles plusieurs livres en attente d'éditeurs.
J’ai cité Gaddis. J’ai ici un livre sur lui dont le sous titre est William Gaddis and the longing for an enlarged culture. Je crois que ce « longing » est aussi partagé par Theroux. Si tout ça me fait penser à Bellow, c’est aussi du Bill Gaddis qu’on voit, hmm, un désir d’élévation déçu et une écriture particulière, propre qui, chez l’un, prend la forme du dialogue et chez l’autre d’a peu près tout ce qu’il est possible de prendre – avec une sérieuse tendance à la liste sensée comme insensée, longue, loooongue, fabuleusement marrante ou à la pluie de références, d’anecdotes à la Markson dont on doute parfois de l’authenticité et même au dialogue parfois gaddisien, oui, oui, Laura, quand elle parle, parle comme d’autres parlaient dans 4 des 5 Bill. Ce qui fait qu’au-delà du propos, de l’histoire, auquel on trouvera le charme que l’on veut – et dans laquelle quelques personnes voudront peut-être voir une version 21ème siècle du Miss Lonelyhearts de Nathanael West --, au-delà donc il y a assez de joies, d’évènements, d’olnis qui passent sur ces 878 pages pour vous garder occupé –et heureux, nondidju ! -- pendant quelques temps. L’ineffable Bowman du NYT, bien entendu, avait mieux à faire que lire vraiment, c’est pourquoi :
after high school (Theroux) did attend a Trappist seminary and took a vow of silence for two years before calling it quits. “I could have been a saint, but I became a man of letters,” he said of his spiritual path. Thank God the Holy Roman Church was spared what undoubtedly would have been the brilliantly misanthropic cult of St. Theroux. Now what of us?
Je dois l’admettre, la fin claque. On peut s’en servir pour justifier son aversion pour un auteur qu’on n’a pas lu au cas très douteux où son nom serait évoqué en société. Ce que ça me dit à moi, c’est que Jack Green, lorsqu’il criait « Fire the bastards ! » à la publication de The Recognitions avait déjà et définitivement raison. Ce que ça me dit aussi, c’est que lorsque Theroux se lamente d’une époque du moindre effort, il tape juste. Aussi et encore.
Je ne sais pas si c’est un grand livre. On verra ça dans vingt ans. Oh, c’est magistral de plus d’une façon, mais c’est aussi complètement épuisant. Mais franchement, de jugement définitif il ne faut point attendre avant un bon bout de temps. Laura Warholic demande du temps. Pour le finir, pour en finir, pour se prononcer. Ce que je sais ou pense savoir, c’est que c’est le livre d’un homme blessé par les échecs commerciaux, les chichis des éditeurs, les frustrations personnelles. On voudrait voir dans Eyestones un Theroux qui rêve de faire partager ce qu’il aime et en Warholic le monde qui rejette l’offre. Ça prend peut-être la forme d’un grand fuck off qui par essence aura plus d’ennemis que d’amis. C’est comme ça. Je m’en fous, et vous devriez vous en foutre aussi.
« I once knew a brilliant person who wrote an unforgettable book, several actually, and his envious brother who also wrote – shallow, mediocre things that he cranked out with a minimum amount of grace or care but that were more acceptable to the Johnny nitwits out there who buy books as soporifics and not as aids to dream or to imagine or to expand their mind—could never quite forgive him. Without that one masterpiece, you see, it does not matter how much a writer does or what he says. What I’m talking about is originality, which is rooted in daring and defiance and rage and recklessness and revolution, and not about sucking up to a world of brainless, mouth-breathing inchlings and half-assed dopes and stupid and illiterate mudnuns who read their books aloud and usually line by line with the aid of a running finger.” (Laura Warholic, p.199)
Alexander Theroux est le frère de Paul Theroux, célèbre écrivain-voyageur.
-------------------------------
Dans la galaxie fric-frac, seul Otarie de Theroux a parlé. (Deux fois.)
