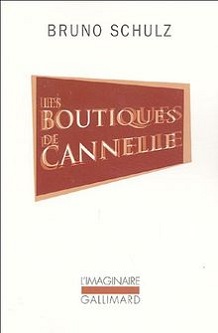
Ana-Cristina, amie et blogueuse, avait consacré en 2022 un article très élogieux et alléchant à l’écrivain polonais Bruno Schulz et cela m’a décidée à acheter son livre autobiographique le plus connu, Les Boutiques de cannelle, écrit au début des années 1930.
Cette lecture s’est avérée étonnante et même assez fascinante !
J’ai planifié cet article au mois de mars, qui était traditionnellement attaché à la littérature d’Europe de l’Est grâce à un défi de lecture aujourd’hui disparu.
Vous pouvez consulter l’article d’Ana-Cristina sur Bruno Schulz en cliquant sur ce lien ici.
L’écrivain, poète, éditeur et blogueur Etienne Ruhaud a créé le défi de lecture « Un classique par mois« , et j’essaye tant bien que mal de m’y tenir. Il s’agit de découvrir chaque mois un écrivain classique que l’on n’a encore jamais lu. Voici le lien vers son blog Page Paysage. Le présent article répond à ce défi.
Note pratique sur le livre
Editeur : Gallimard
Collection : l’Imaginaire
Date de publication initiale : 1934
Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Georges Sidre et Georges Lisowski
Nombre de pages : 198
Note sur l’écrivain
Bruno Schulz, né en juillet 1892, à Drohobycz et mort le 19 novembre 1942 dans la même ville, est un écrivain, dessinateur, peintre, graphiste, et critique littéraire polonais. Né dans une famille juive, il est le fils d’un marchand d’étoffes. Après des études d’architecture qu’il ne peut achever puis d’autres études aux Beaux-Arts, il devient professeur de dessin entre 1924 et 1941. Ce travail d’enseignement ne lui plait pas et il s’en plaint fréquemment dans ses correspondances avec ses amis les écrivains Witold Gombrowicz et Stanislaw Ignacy Witkiewicz. En 1933, il commence à publier ses œuvres. Avec l’éclatement de la Seconde Guerre Mondiale, la ville de Drohobycz est envahie successivement par l’armée soviétique puis par les nazis. C’est dans ce contexte que Bruno Schulz est assassiné par le SS Karl Günther, d’une balle dans la tête. A ce moment-là, Schulz prévoyait de fuir à Varsovie dès la nuit suivante. Il fut probablement enterré dans une fosse commune.
(Source : Wikipédia)
Quatrième de Couverture
Drohobycz, tranquille bourgade provinciale où Bruno Schulz vécut et enseigna le dessin, devient le lieu de toutes les terreurs et de toutes les merveilles : ses places, ses rues, la boutique familiale de draps et de tissus se métamorphosent. Dans une ambiance de sourde étrangeté, hantée par la figure emblématique du père, se déploient le thème obsessionnel des mannequins et le contraste, si spécifique à Bruno Schulz, entre beauté et pacotille. Entre innocence et perversité, entre cauchemar et merveilleux, les récits des Boutiques de cannelle se situent dans un » treizième mois, postiche et superfétatoire, en marge du temps réel, sur ses voies de garage.
Mon Avis
J’ai été complètement subjuguée et enthousiasmée par ce livre ! Quelle écriture exceptionnelle, mêlant la poésie et l’étrangeté, flirtant avec le fantastique ou, plutôt, nous présentant une réalité transfigurée, un univers fantasmatique, foisonnant, dans lequel tout semble mystérieux, les gens paraissent à la limite d’une folie douce, et toutes sortes d’événements incongrus et extra-ordinaires se produisent. En même temps, nous sentons bien que Bruno Schulz nous raconte ici réellement ses souvenirs d’enfance, qu’il dresse réellement le portrait de son père et des autres membres de sa famille tels qu’il les a connus, mais ces souvenirs semblent observés par le prisme d’une imagination poétique débordante.
Dans sa nouvelle « Les Cafards » (un des chapitres de ces Boutiques de cannelle) il fait un clin d’oeil appuyé à la Métamorphose de Kafka, puisqu’il nous explique qu’à la fin de sa vie, son père s’est transformé en cafard et il reprend textuellement des phrases de Kafka en les appliquant à son père. Mais j’ai eu l’impression que le monde de Bruno Schulz était plus doux, plus fantaisiste, plus souriant que le monde kafkaïen et il m’a paru beaucoup plus agréable de flâner dans ces Boutiques de cannelle que de déambuler dans Le Château ou dans Le Procès, par exemple (même si Kafka est un génie incroyable, personne ne peut le contester).
L’écrivain consacre également trois chapitres du livre aux mannequins des vitrines de mode et à une certaine conception de la matière, prisonnière de l’esprit, et j’ai trouvé le mode de pensée et les raisonnements de Bruno Schulz tout à fait subtils, insolites et beaux.
Je conseille très chaudement ce livre, je l’ai vraiment admiré et adoré !
**
Un Extrait page 73
(dans la nouvelle « Fin du traité des mannequins« )
Le soir suivant mon père revint avec un renouveau d’entrain à son sujet obscur et complexe. Le réseau de ses rides s’était enrichi et témoignait d’une ruse raffinée. Chaque courbe de son visage recelait une ironie. Mais parfois l’inspiration étendait les arcs de ses rides ; chargés d’horreur, ils fuyaient en volutes silencieuses vers les profondeurs de la nuit d’hiver.
« Figures de musée Grévin, mes chères demoiselles – commençait-il – mannequins de foire, oui ; mais même sous cette forme, gardez-vous de les traiter à la légère. La matière ne plaisante pas. Elle est toujours pleine d’un sérieux tragique. Qui oserait penser qu’on peut se jouer d’elle, qu’on peut la façonner pour plaisanter, ou qu’une telle plaisanterie ne pénètre pas, ne s’incruste pas en elle comme une fatalité ? Pressentez-vous la douleur, la souffrance obscure et prisonnière de cette idole qui ne sait pas pourquoi elle est ce qu’elle est ni pourquoi elle doit rester dans ce moule imposé et parodique ? Comprenez-vous la puissance de l’expression, de la forme, de l’apparence, l’arbitraire tyrannie avec laquelle elles se jettent sur un tronc sans défense et le maîtrisent comme si elles en devenaient l’âme, une âme autoritaire et hautaine ? Vous donnez à une quelconque tête de drap et d’étoupe une expression de colère et vous l’abandonnez avec cette colère, cette convulsion, cette tension, vous la laissez enfermée dans une méchanceté aveugle qui ne peut pas trouver d’issue. La foule rit de cette parodie. Pleurez plutôt, mesdemoiselles, sur votre propre sort, en voyant cette matière prisonnière, opprimée, qui ne sait ni qui elle est, ni pourquoi, ni à quoi mène cette attitude qu’on lui a imposée une fois pour toutes…
(…)
Un autre Extrait page 86
(dans la nouvelle « Monsieur Charles« )
Le samedi après midi, mon oncle Charles partait à pied pour la campagne, à une heure de marche de la ville, où sa femme passait l’été avec les enfants.
Depuis le départ de son épouse, l’appartement n’avait jamais été nettoyé, le lit restait toujours défait. Monsieur Charles rentrait tard, exténué par la débauche nocturne à laquelle l’incitaient des journées chaudes et vides. Les draps froissés, en désordre, étaient alors pour lui un havre, une île salutaire où il échouait sans force, naufragé ballotté depuis des jours et des nuits par une mer agitée.
À tâtons, dans l’obscurité, il s’enfonçait dans des montagnes blanchâtres, des chaînes et des amoncellements de plumes fraîches, et il s’endormait ainsi, sens dessus dessous, à l’envers, la tête en bas enfoncée dans la douce chair de l’édredon, comme s’il voulait traverser en dormant les massifs puissants de literie qui grandissaient la nuit. Il luttait avec eux dans son sommeil, nageur combattant avec l’eau ; il les malaxait de tout son corps, s’y enfonçant comme dans un grand pétrin de pâte molle, et il se réveillait dans l’aube grise, essoufflé trempé de sueur, rejeté à la lisière de cette montagne blanche qu’il n’avait pu dompter au cours des lourdes batailles nocturnes. Émergeant à demi du sommeil, il restait un moment suspendu au bord de la nuit, respirant avidement, tandis que les draps montaient autour de lui, gonflaient, fermentaient, pour le recouvrir à nouveau d’un épais éboulis de pâte lourde et blanchâtre.
(…)
**

