 Avant de commencer ce billet, laissez-moi vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Juifs et chrétiens cette année fêtent Pâques le même jour, c’est un symbole fort dans une actualité qui voit en France des gens être tués parce qu’ils sont juifs…🕊
Avant de commencer ce billet, laissez-moi vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Juifs et chrétiens cette année fêtent Pâques le même jour, c’est un symbole fort dans une actualité qui voit en France des gens être tués parce qu’ils sont juifs…🕊
Malgré ce sombre tableau, Pâques nous invite à espérer quand toute espérance semble déchue. Pâques est un mot qui signifie « Passage » en hébreu : il rappelle le passage de la Mer Rouge par le peuple d’Israël ; et l’événement incommensurable de la mort et la résurrection de Jésus pour les chrétiens. Cela prend une résonance particulière quand on a vu un homme donner sa vie pour sauver celle d’une autre. Que nous soyons croyants ou non, nous avons tous besoin de renouveau dans nos vies (surtout au terme d’un hiver bien longuet). Je crois que cette fête nous invite à franchir un seuil pour nous rapprocher de (au choix) : Dieu – nos proches – le mendiant du métro – le collègue ch**** comme la pluie – les victimes de catastrophe et de guerre – nos potes blogueurs (tant qu’à faire), etc, afin de faire grandir la paix, la joie et l’amour dans ce monde plus que tourmenté.
Et non, pas de poisson d’avril aujourd’hui, mais de l’agneau au menu ! 😋
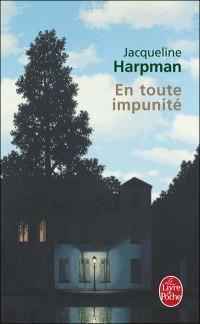
Son intrigue puise à la source des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Et franchement, quel meilleur patronage que « Le Bonheur dans le crime » cité dans le roman pour parler de femmes exquises qui parviennent à trouver le plus parfait bonheur sur terre en employant des moyens… pas très catholiques ? (La vache, je viens d’apprendre qu’il est de tradition, en Norvège, de lire des histoires de crimes à Pâques… Tant d’à-propos de ma part me sidère).
Un homme (le narrateur) tombe en panne la nuit en rase campagne belge. Obligé de demander l’hospitalité aux plus proches voisins, il fait la connaissance de cinq femmes d’une même famille vivant dans une gentilhommière du XVIIIe siècle magnifique mais très délabrée et dépouillée de son mobilier, vendu au fil des ans. Au cours des jours suivants, il s’éprend du charme naturel mais raffiné de ces femmes qui tiennent à bout de bras et au prix d’efforts surhumains le domaine de la Diguière qu’elles ont hérité de leurs ancêtres. Au point d’échafauder un plan insensé pour trouver l’argent qui réparera la toiture…
« Elles ne mentaient pas du tout : elles peaufinaient le piège que cet homme qu’elles n’avaient jamais vu avait ouvert lui-même sous ses pas. Je prenais une honnêteté inhabituelle pour du cynisme parce que j’avais été élevé dans la bienséance, donc l’hypocrisie ordinaire. Je n’avais jamais eu à défendre que moi-même : elles défendaient leur héritage. Je suis un homme sans passé et sans descendance : elles sont au milieu des siècles, deux à l’arrière et mille devant et ne veulent pas quitter l’étroit sentier où elles cheminent. » (p. 104)
J’ai découvert Jacqueline Harpman grâce aux précédents mois belges, je leur dois reconnaissance éternelle. Son écriture est un régal de précision et d’élégance classique, les imparfaits du subjonctifs alignés comme des majordomes au garde-à-vous, les références littéraires du meilleur goût, l’humour cristallin. Cet habillement de la langue n’étouffe pas la vie des personnages et ne fait pas (trop) anachronique. J’ai tout de suite été conquise par Albertine, Sarah, Charlotte, Clémence et Adèle (sans oublier la brave Madeleine), leur courage effronté, leur mépris des conventions, leur solidarité à toute épreuve et leur attachement sans bornes pour leur maison. Elles sont au centre du récit, petites reines soleil aux pieds nus qui se passent des hommes, lesquels ne peuvent s’empêcher de graviter autour d’elles, fascinés.
« Charlotte et Sarah n’eurent jamais les exigences propres à l’adolescence. Par une bienheureuse occurence, la mode était aux jeans déchirés et à ce que l’on nommait les chemises grand-père, qui s’achetaient pour trois sous aux Puces : à l’école, on les envia d’avoir une mère qui permettait une vêture jugée choquante par les dames de la paroisse ! Elles prenaient des airs supérieurs et se tordaient de rire en rapportant ces propos à Albertine et Madeleine. Elles ne connurent pas les cours de danse classique, les leçons de tennis ou d’équitation de leurs compagnes et s’en moquèrent : elles avaient la Diguière. Princesses déguenillées couronnées de liseron, elles régnaient sur les orties, changeaient les citrouilles en Rolls-Royce, les chats en princes et la pauvreté en fantaisie. » (p. 55)
L’auteure aborde finement la question des liens qui lient certains êtres à un passé incarné en vieilles pierres et quelques arpents de terre, à travers les yeux d’un narrateur qui est lui, dépourvu de liens transgénérationnels. La transmission familiale peut être pesante dans un monde qui favorise le bonheur immédiat sans entrave… à moins de posséder de l’imagination pour concilier goût du présent et continuité. Et les femmes de la Diguière n’en manquent pas, de l’imagination, et vont s’y entendre pour transformer le conte de princesse en fable picaresque !
« Je pensais à la joyeuse tablée de la veille, aux plaisanteries, aux rires, et me dis qu’elles pratiquaient la gaité comme on s’exerce à l’escrime, pour être prêtes au moment de la bataille, dures combattantes qui ignoraient tout de la reddition, mais aussi que ce domaine était leur bonheur, comme l’amant est le bonheur de l’amante, qu’elles riaient car elles étaient heureuses d’être là, entre les bras de l’objet aimé, dans les murs de leur maison, si dénudée qu’elle fût, parcourant la cour pavée comme avaient fait leurs ancêtres, les pas dans leurs pas, sentant dans leur poitrine battre le coeur des générations, elles étaient chez elles comme on est chez soi dans son corps, l’unique bien que l’on puisse posséder jusqu’à ce que mort s’ensuive, et que leurs enfants, et les enfants de leurs enfants y vivent à leur tour. » (p. 63)
J’ai presque été déçue du mince volume du roman (220 pages). Le contexte et les personnages fouillés permettaient de commettre un gros pavé sur les aventures d’une drôle de famille. Mais Jacqueline Harpman a semble-t-il préféré s’en tenir à son intention de départ, écrire une fable. Et le livre se referme sur une vision idyllique, que même la conscience du forfait accompli ne viendra pas entacher…
Pour finir, ces quelques lignes sur le bonheur d’écrire à la main (ça ne vous donne pas envie de lâcher votre clavier pour empoigner votre écritoire et votre plus belle plume ??)
« C’est là que je pris mes premières notes. Je suis grand écriveur – terme sorti d’usage, mais que mon vieux Larousse de 1906 définit encore : qui écrit beaucoup, qui aime écrire -, j’aime à jouer avec la syntaxe et la grammaire, mais j’aime aussi le mouvement de la plume sur le papier, le plaisir sensuel de former les lettres, bien alignées, arrondies, reliées. » (p. 37)
C’est grâce aux fameuses notes à la plume du narrateur que nous saurons tout sur les dessous de cette famille, dans la grande tradition de Barbey ou Maupassant…
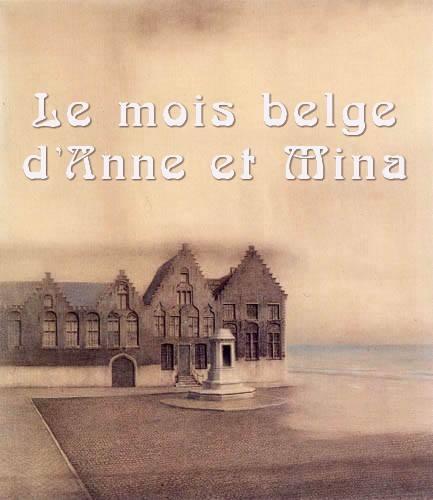
« En toute impunité », de Jacqueline Harpman, Grasset, Le Livre de poche, 2005.
Publicités &b; &b;
