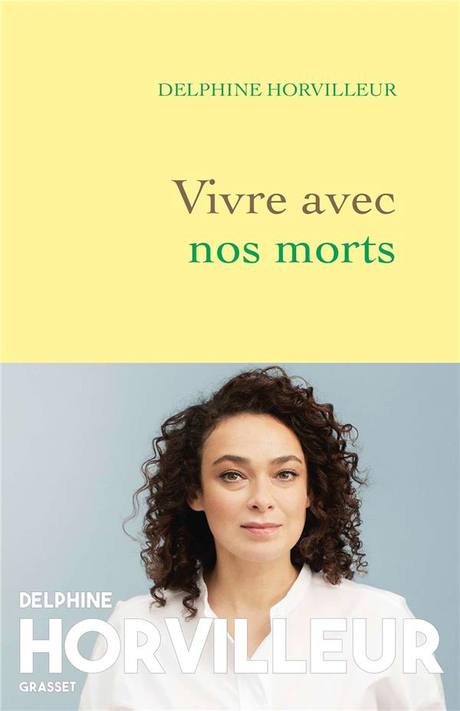
Présentation de l’éditeur :
« Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis… »
Etre rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. »
A travers onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession. Le récit d’ une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et l’évocation d’une blessure intime ou la remémoration d’un épisode autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli.
Nous vivons tous avec des fantômes : « Ceux de nos histoires personnelles, familiales ou collectives, ceux des nations qui nous ont vu naître, des cultures qui nous abritent, des histoires qu’on nous a racontées ou tues, et parfois des langues que nous parlons. » Les récits sacrés ouvrent un passage entre les vivants et les morts. « Le rôle d’un conteur est de se tenir à la porte pour s’assurer qu’elle reste ouverte » et de permettre à chacun de faire la paix avec ses fantômes…
Je précise tout d’abord que ma lecture, ma compréhension et mon appréciation de ce livre n’engagent que moi, c’est un avis tout personnel.
Derrière ce titre en forme d’oxymore, Delphine Horvilleur parle de la mort, de sa vie de femme et de rabbin confrontée à des morts diverses et variées et à ceux et celles qu’elle accompagne dans sa fonction de rabbine. Et ce n’est pas parce qu’elle est « habituée » comme on le lui dit souvent qu’elle apprivoiserait la mort sans aucune crainte.
Les différentes histoires qu’elle nous raconte ont des liens avec sa vie personnelle de femme, d’étudiante, de rabbine. Elle commence par les funérailles d’Elsa Cayat, assassinée le 7 janvier 2015, plusieurs mois après, celles de Marc, son correspondant avec qui la psychanalyste de Charlie Hebdo allait écrire un livre. Elle nous parle avec chaleur et respect des deux amies, Marceline Loridan-Ivens et de Simone Veil, les filles de Birkenau devenues des icônes des droits des femmes. Elle évoque son amie Ariane, emportée bien trop tôt par une tumeur au cerveau, dont elle a accompagné la fin de vie sur le fil étroit entre amie et rabbin. Elle raconte Myriam, rencontrée quand Delphine Horvilleur étudiait à New York, une vieille juive américaine obsédée par la préparation de ses funérailles. Elle nous parle de son oncle Edgar, enterré en Alsace. Elle raconte aussi des figures bibliques, Isaac, Ismaël, Jacob, et le grand Moïse qui vécut jusqu’à 120 ans, mourut, nous dit la Torah, en pleine force de l’âge et dont personne ne connaît la tombe.
Autant de récits, bibliques ou non, qui disent la vie, la mort, la peur de la mort, l’incompréhension, le chagrin, qui tissent des liens entre le visible et l’invisible, entre ce que l’on vit et ce que l’on croit de l’au-delà. Des extraits de la Torah éclairent avec à-propos les histoires individuelles, ils sont particulièrement intéressants (à mon sens) parce que les traductions apportent une fraîcheur, un éclairage nouveau et qu’elles sont intimement mêlées aux interprétations proposées au long des temps par le Talmud, entre autres. Les histoires rencontrées interpellent donc la rabbine dans sa vie personnelle et tissent des liens précieux. L’humour n’est pas exclu et j’y ai goûté d’excellentes blagues juives.
A la fin du livre, Delphine Horvilleur évoque l’assassinat d’Itzhak Rabin en 1995. On comprend entre les lignes que l’auteure défend un sionisme ouvert, un sionisme qui laisse la place à l’autre, qui reconnaît qu’il n’est pas seul sur le terrain. Lire cela m’a fait du bien en ce moment où la « Terre sainte » résonne de violence, d’horreur et de prises de pouvoir insensées au détriment des populations civiles israéliennes et palestiniennes. Lire Delphine Horvilleur, c’est entendre sa voix musicale, souvent sollicitée dans les médias, c’est entendre une voix ouverte, chaleureuse, attentive à tous. Une voix qui dit que la religion peut être une source de vie, de bon vivre ensemble. Une voix libre.
« Personne ne sait parler de la mort, et c’est peut-être la définition la plus exacte que l’on puisse en donner. Elle échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole. Celle de celui qui part, mais aussi celle de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, feront toujours de la langue un mauvais usage. Car les mots dans le deuil ont cessé de signifier. Ils ne servent souvent qu’à dire combien plus rien n’a de sens. »
« Dans cette légende, se tient presque tout ce que le judaïsme pourrait enseigner sur la mort. Est-il possible d’apprendre à mourir ? Oui, à condition de ne pas refuser la peur, d’être prêt, comme Moïse, à se retourner pour voir l’avenir. L’avenir n’est pas devant nous mais derrière, dans les traces de nos pas sur le sol d’une montagne que l’on vient de gravir, des traces dans lesquelles ceux qui nous suivent et nous survivent liront ce qu’il ne nous est pas encore donné d’y voir. »
« La laïcité dit que l’espace de nos vies n’est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitudes. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l’espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu’il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance, qui peut accueillir celle d’un autre venu y respirer. «
« Deux rescapés des camps font de l’humour noir sur la Shoah. Dieu, qui passe par là, les interrompt : « Mais comment osez-vous plaisanter sur cette catastrophe ? », et les survivants de lui répondre : « Toi, tu ne peux pas comprendre, tu n’étais pas là ! »
« Dans les contes pour enfant, il y a souvent une ou plusieurs fées qui se penchent sur le berceau d’un nouveau-né pour y placer un souhait ou offrir un talent. J’ai souvent pensé que Simone [Veil, bien sûr] avait été l’une de ces fées pour les femmes de ma génération, et qu’elle s’était penchée sur nos berceaux en murmurant une puissante promesse. Je suis née en novembre 1974, au moment même où sa voix portait à l’Assemblée nationale un engagement solennel.
« Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme », avait-elle dit, avant d’ajouter : « Je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes. »
Il était une fois une femme qui interpellait des parlementaires en leur présentant de prétendues excuses, mais, nous le savions bien, c’était à nous toutes qu’elle s’adressait. «
« J’ai souvent eu le sentiment que le judaïsme porte, en ses langages, quelque chose qui résonne avec cette idée. L’identité juive repose elle aussi sur une vacance. Tout d’abord parce qu’elle n’est pas prosélyte et ne cherche pas à convaincre l’autre qu’elle détient l’unique vérité. Ensuite, parce qu’elle peine à formuler ce qui la fonde. Nul ne sais vraiment ce qui fait un juif et encore moins un « bon juif ». Est-ce une origine, une pratique, une croyance, une tradition culinaire ? L’identité juive est toujours au-delà de ce qu’on pourrait en dire, et ne se laisse jamais emmurer dans une définition unique qui réduirait ses possibles.
Pour le dire autrement : « le » judaïsme est toujours plus grand que le « mien ». Il préserve un espace libre pour une autre conception que la mienne, et donc une transcendance infinie : celle de la définition qu’en donnera un autre.
Le judaïsme garantit en son sein la place d’Elsa (Cayat) et la mienne, celle d’une juive non croyante et celle d’un rabbin, sans qu’aune de nous puisse se revendiquer plus légitime. Aucune ne peut s’affirmer « plus » ou « meilleure » juive que l’autre. »
Delphine HORVILLEUR, Vivre avec nos morts, Grasset, 2021
